IGIHE : Pourquoi le titre « Sans ciel ni terre » ?
Dumas : Ce titre s’appuie sur la traduction d’une expression souvent employée par les auteurs des cahiers, « impfubyi zitagira epfo na ruguru » et qui témoigne de la perte de repères, du néant, du passage dans un monde irrémédiablement étranger qu’a provoqué pour eux l’expérience du génocide.
Le titre même du livre est un indice de la volonté de placer au cœur de la narration la parole des jeunes scripteurs, de lui accorder toute sa dignité de source historique. La parole des victimes et des survivants du génocide des Tutsi ne peut être comptable des seuls discours de la déploration ou de la commisération.
En effet, même si on ne peut manquer d’être saisi par l’expression de la douleur et de la souffrance, les textes sont aussi informatifs sur les mécanismes locaux de mise en œuvre des politiques génocide qui requiert la mobilisation de toutes les échelles du pouvoir et qui s’appuie sur la profonde interconnaissance sociale sur les collines.
Contrairement à un cliché issu d’une lecture judiciaire de l’événement, les victimes n’ont pas été uniformément confinées dans des cachettes sans rien voir ni entendre de ce qui se produisait autour d’elles. Ce que montrent les récits des orphelins avec tant de force c’est bien les constantes interactions entre les victimes et les tueurs.
Les descriptions si minutieuses du « temps du génocide » donnent une image terrifiante de précision de la gestuelle et du discours meurtrier, structurés par un imaginaire raciste. À l’inverse de certaines analyses exclusivement fondées sur la parole des tueurs qui postulent l’absence de tout système de croyance raciste et expliquent l’engagement dans les massacres par la peur ou l’opportunisme, les cahiers rédigés par les jeunes orphelins permettent un décryptage fin des gestes et des mots de la haine et de la cruauté.
Refuser de voir les manières de tuer, c’est s’interdire de comprendre l’irradiation puissante du génocide dans le temps long de l’après-coup. Pour les rescapés, il a fallu revenir à la vie avec cette mémoire-là, cette expérience radicale de l’humiliation et de la mort des siens.
IGIHE : Pourquoi avez-vous fait le choix sur cette tranche d’âge ?
Dumas : L’homogénéité d’âge tout comme de l’origine géographique des scripteurs procède du choix opéré par Avega de réunir dans l’atelier d’écriture en avril 2006 des jeunes rescapés résidant dans la Province de l’Est, formée des anciennes préfectures de Kigali-Ngali, Kibungo et Byumba. La plupart des auteurs avaient entre 8 et 12 ans en 1994 et ils appartenaient avec leurs familles au monde rural des collines. C’est une grande chance d’avoir eu accès à un corpus de témoignages aussi homogène puisque cela permet de croiser les récits et de construire une narration étayée par plusieurs voix.
Ainsi, par exemple, plusieurs survivants de Nyarubuye décrivent le geste secourable d’un homme bravant la menace des ibitero et l’odeur atroce du charnier pour apporter du jus et quelques courgettes à la maigre cohorte des rescapés. L’écho d’un événement porté d’un texte à l’autre autorise, très simplement, l’exercice de la critique historienne des sources.
Par ailleurs, l’homogénéité géographique du corpus offre l’opportunité d’approcher l’histoire du génocide dans une région encore relativement peu étudiée – à l’exception des travaux de Paul Rutayisire et Privat Rutazibwa puis de la CNLG – où les massacres sont exécutés avec une rapidité et une efficacité extrême.
IGIHE : Qu’est-ce que vous avez constaté ou découvert chez cette tranche d’âge en termes de vérité historique ?
Dumas : Avec ces récits, on entre dans l’atome du génocide, au plus près de la mise en œuvre de l’utopie exterminatrice. Comme pour les autres génocides du XXème siècle, les enfants représentent la cible privilégiée des tueurs afin de rompre à jamais la filiation du groupe voué à l’extermination. Regarder ce qui se joue dans les expériences enfantines du génocide, c’est approcher le cœur de la politique génocide puisque le sort des enfants est intimement lié à la volonté éradicatrice.
Plus encore que la rupture de la filiation, on voit avec quelle inventivité cruelle les tueurs ont organisé le saccage de celle-ci. La récurrence des descriptions des mises en scène cruelles, des « théâtres de la cruauté » pour reprendre les mots de l’historien Denis Crouzet, interdit toute analyse en termes de déviances individuelles. Les tueurs n’étaient pas fous et les formes de violence infligées ne sont pas anomiques. Elles révèlent au contraire l’inscription du racisme sur les corps.
Un racisme dont les enfants racontent qu’ils font l’expérience très concrète dès leur scolarité quand ont lieu les « recensements ethniques » dans les classes et qu’ils se voient assignés une identité raciale, demeurée tapie dans le silence familial jusqu’alors.
IGIHE : J’aimerais savoir en quoi leurs témoignages sont très forts et particulièrement efficaces ou convaincants ?
Dumas : Les jeunes scripteurs reviennent par l’écriture au présent du génocide. En lisant les récits, ils ont de nouveau l’âge qui était le leur en 1994. Gaël Faye parle du
« regard microscopique » de l’enfance, une expression qui me parait très juste au regard de la minutie avec laquelle les faits sont décrits. La singularité d’une expression enfantine sans filtre avait d’ailleurs été soulignée lors des entreprises de collectes de témoignages engagées auprès des survivants de la Shoah, avec « l’idée que la parole de l’enfant était plus “authentique” que celles des adultes, car elle n’était pas médiatisée par les conventions sociales . »
Le même constat peut être dressé pour le génocide des Tutsi. Leur écriture concrète et détaillée fait revivre sous les yeux du lecteur les scènes atroces auxquelles ils ont assisté. Le génocide nous est donné à voir dans sa brutale matérialité, avec toute la gamme de ses acteurs, depuis les bourgmestres jusqu’au voisin en passant par le milicien interahamwe.
Les récits rendent transparente la violence qu’ils décrivent permettant dès lors une analyse de ses formes et des moyens par lesquels les tueurs la justifient à leurs propres yeux et aux yeux des victimes.
Les cahiers des orphelins ouvrent également la réflexion sur un après-coup infini du génocide. Pour bien des jeunes rescapés, l’effondrement du monde des adultes ancre pour longtemps une défiance envers un monde désormais dépeuplé de ses figures familières et protectrices. Défiance redoublée par le prolongement du « temps du génocide », notamment pour les fillettes prisonnières des camps de réfugiés au Zaïre, exploitées comme esclaves domestiques.
Défiance également accentuée par diverses formes de maltraitance endurées dans les familles recomposées et qui explique parfois la constitution de familles d’orphelins, dépourvues d’adultes. Rédigés douze ans après le génocide, les cahiers ménagent un espace d’écriture très précieux à la narration de cette temporalité subjectivée du génocide, vécue dans un étirement infini. Il me semble essentiel de porter l’investigation historique sur le génocide à des échelles différentes, sans négliger les plus petites, celles des familles et des individualités.
Comme chercheuse, comme historienne, je considère que ce type de corpus revêt une valeur inestimable.
IGIHE :Comment ces enfants vivent la perpétuation du génocide par le négationnisme, après les trois phases du génocide : Planification, exécution et négation ?
Dumas : S’ils sont peu nombreux à évoquer de manière explicite les discours de négation ¬– ils écrivent à un moment où cette question n’a pas encore pris toute sa place dans le débat public – ils expriment très souvent la volonté d’imprimer une trace dans l’histoire afin que leur expérience soit connue de leur descendance future et de « la terre entière » comme l’écrivent certains.
À l’évidence toutefois, ces textes extraient l’histoire du génocide des polémiques lassantes comme celle qui fit rage sur les responsabilités dans l’attentat du 6 avril. Certes, un basculement s’opère dans les récits à partir de cette date, mais les enfants racontent de quelle manière la violence régnait sur la vie quotidienne de leur famille bien avant l’attentat.
Il me semble qu’il ne faut pas se laisser enfermer dans les « débats » imposés par les négateurs. Pierre Vidal-Naquet, l’auteur des Assassins de la mémoire sur la négation de la Shoah écrivait en conclusion : « Il ne suffit pas dans cette affaire d’avoir globalement raison, il faut inlassablement travailler, c’est-à-dire établir les faits non pour ceux qui les connaissent et vont disparaître, mais pour ceux qui seront légitiment exigeants quant à la qualité de la preuve. »
Ce travail c’est celui de l’histoire, des sciences sociales de manière générale, qui ne peut demeurer otage de la polémique et de l’agitation médiatique. Enquêter à partir de sources identifiables, ouvertes, c’est-à-dire soumises à la critique des pairs, en s’appuyant sur une méthodologie clairement exposée, c’est l’enfance de l’art mais ces principes ont été trop souvent négligés.
IGIHE : Que pensez-vous des journalistes ou des chercheurs qui se présentent comme spécialistes du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda sans avoir même mis les pieds sur le sol du Rwanda ?
Dumas : Votre question est liée à la précédente car les négateurs enferment l’histoire du génocide dans l’abstraction de leurs grandes théories. En écrivant ce livre, j’étais accompagnée par la lecture du dernier ouvrage de Rithy Panh , cinéaste et rescapé du génocide au Cambodge.
Il donne la définition la plus incisive du négationnisme à partir du cas cambodgien : « L’entrée du négationnisme, ce n’est pas le doute, ce n’est pas le mensonge, ce n’est pas l’ignorance : c’est l’abstraction. » Des échos très forts résonnaient entre ce qu’écrit Rithy Panh et la manière dont je conçois la manière d’enquêter sur l’histoire du génocide des Tutsi au Rwanda. Il invite en particulier à « déposer ses concepts dans le paysage humain. »
« Le paysage humain » évoqué ici à pour ma part toujours été au fondement de l’élaboration de l’analyse. Sans l’intimité avec les paysages, la botanique, la langue et les Rwandais, je ne pourrais pas exercer mon métier. Ce besoin presque charnel d’être en relation constante avec le Rwanda vient sans doute de ma première rencontre avec les traces encore très vivantes du génocide lors de la dixième commémoration en avril 2004.
L’entrée dans la chair de l’événement, au sens propre, a bouleversé ma vie et a forgé ma détermination à comprendre comment un tel paroxysme de violence avait été rendu possible. La commotion affective ressentie alors s’est accompagnée d’une quête intellectuelle. Depuis, jamais cette parenté profonde entre ouverture à l’émotion des rencontres et effort de compréhension ne m’a quittée.
La fréquentation assidue du pays depuis ce mois d’avril 2004 conforte cette conviction qu’il est impossible de prétendre travailler sur l’histoire du génocide hors sol, sans sillonner les paysages ou plonger dans la poussière des archives. Cette volonté d’enquêter au plus près du terrain est d’ailleurs parfaitement admise chez une nouvelle génération de jeunes chercheuses et chercheurs ayant également choisi de porter son intérêt sur cet événement majeur de notre contemporain.
Il me semble que ces efforts conjoints enrichiront l’historiographie et finiront par contenir les discours de négation dans le mépris et l’indifférence. L’importance du travail historique exige me semble-t-il que l’on ne perde pas un temps précieux à discuter de ces théories négationnistes.
IGIHE : Comment avez-vous procédé pour recueillir ces témoignages d’enfants ?
Dumas : Je dois ici reconnaître la dette contractée auprès de la CNLG qui m’a laissé toute liberté de fouiller ses cartons, ses tiroirs et ses étagères dans lesquelles reposaient les cahiers. Sans la confiance de l’institution, ce travail n’aurait pas été possible.
J’ai ensuite photographié les deux mille feuillets que contenaient les 105 cahiers avant d’en entamer la traduction avec deux personnes de confiance elles-mêmes rescapées, capables de décrypter cette langue du génocide qui dit la haine, les coups, l’humiliation, les courses effrénées sur les collines, l’angoisse des cachettes dans les marais et les champs de sorgho.
Il m’a semblé essentiel de participer à la traduction afin de poser des questions à la langue, aux mots posés par les jeunes scripteurs sur cette expérience extrême. Puis, il s’agissait également de veiller scrupuleusement à la restitution en français de ce « grain de l’enfance » marquant l’écriture. De retour en France, j’ai procédé à un travail d’édition de l’ensemble des textes dans un constant va et vient avec la version originale en kinyarwanda. J’espère que les kinyarwandophones qui liront le livre dans sa version française y trouveront la teinte originelle de leur langue.
Je souhaiterais beaucoup poursuivre ce travail pour pouvoir, à terme, établir une édition complète de chacun des cahiers dans une version bilingue. Pour cela, il me faut retourner au Rwanda dès que cela possible pour en retrouver les auteurs et recueillir auprès d’eux leur décision sur l’anonymisation des textes. En effet, il me paraîtrait d’une grande violence d’anonymiser le nom des disparus que les jeunes scripteurs ont pris tant de soin à inscrire dans leurs linceuls de papier. Puis, bien sûr j’aimerais les rencontrer près de quinze ans après la rédaction de leurs récits, savoir quelle fut leur existence depuis 2006.
IGIHE : Vous avez fait des recherches au Rwanda, y a-t-il une différence entre les rescapés adultes et les enfants dans la manière de témoigner ? Si oui laquelle ?
Dumas : Pour répondre de manière précise à cette question, il faudrait disposer d’un corpus identique rédigé par des survivants adultes. Je ne sais pas si l’on y retrouverait ces mêmes descriptions si terrifiantes de minutie. Ce qui constitue la singularité des expériences enfantines, c’est bien l’effondrement du monde des adultes, que celui-ci ait été impuissant à protéger ou qu’il se soit transformé en menace mortelle.
IGIHE : Est-ce plus facile pour un enfant de témoigner ? Comment l’historienne appréhende la parole d’un enfant rescapé ?
Dumas : À l’évidence, la prise d’écriture n’a pas été aisée. On lit la difficulté de raconter dans la graphie, parfois décousue et rendue presqu’illisible par l’extrême dureté de ce qui est raconté. Par ailleurs, il arrive que les scripteurs expriment leur douleur à écrire certains épisodes. L’écriture est souvent syncopée. Elle s’arrête puis reprend sans progression chronologique évidente. Mais ce chaos agitant certains cahiers, visible dans la matérialité même de l’archive, doit être considéré avec sérieux. La souffrance morale se dit aussi dans la forme, les manières de tracer les lignes sur la page.
C’est avec le même sérieux et la même attention qu’il s’agit de lire ces paroles enfantines, sans leur imposer une grille de lecture surplombante, celle de la psychologie par exemple. Les enfants sont des acteurs sociaux et des sujets doués de volonté au même titre que les adultes. Plus encore, dans le contexte précis du génocide des Tutsi, ils sont à la fois des acteurs centraux de la politique d’extermination comme cible privilégiée des tueurs mais également de l’après-coup survivant puisqu’on les retrouve dans des proportions importantes au sein de la population des rescapés.
IGIHE : Où et comment peut-on se procurer votre livre ?
Dumas : Le livre est paru en France le 1er octobre et j’espère qu’il sera rapidement disponible dans les librairies de Kigali. Il est également possible d’en obtenir une version numérique sur les sites des éditions La Découverte.
Propos recueillis par Karirima Ngarambe Aimable
















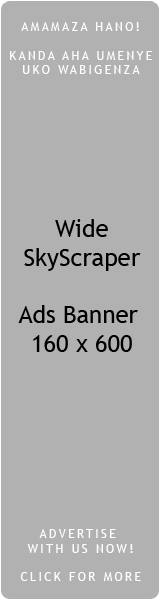
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!