L’entrée des FARDC et des Wazalendo dans la ville d’Uvira relève de cette catégorie tragique : non un épisode isolé, mais l’illustration achevée d’une dérive structurelle, ancienne, tolérée et désormais assumée.
Car ce qui s’est donné à voir n’a rien d’un dérapage conjoncturel ni d’une bavure accidentelle. Il s’agit d’un mode opératoire, d’une grammaire de la prédation où l’arme ne sert plus à protéger, mais à intimider, où l’uniforme ne garantit plus la loi, mais suspend toute norme.
Le pillage des biens privés et publics, la profanation des lieux de culte, la destruction des institutions elles-mêmes jusqu’au palais censé incarner l’État de droit ne constituent pas des excès marginaux : ils forment un système cohérent, presque ritualisé, dans lequel la force armée se mue en licence de spoliation.
La violence exercée contre les populations banyamulenge, loin d’être un dommage collatéral, s’inscrit dans une logique plus sombre : celle de la déshumanisation préalable, condition nécessaire à toute entreprise d’anéantissement moral et social.
Lorsqu’une armé nationale cesse de distinguer le civil du butin, le sacré du profane, la loi de la rapine, il abdique toute prétention à la légitimité républicaine.
Face à cette réalité brute, le contraste apparaît avec une netteté presque pédagogique. Tandis que les forces de l’AFC/M23, vouées aux gémonies par le discours officiel, revendiquent une posture fondée sur la sécurisation des espaces conquis, la discipline des troupes et la protection des populations civiles, les forces gouvernementales, elles, laissent derrière elles un paysage de dévastation morale et matérielle. Cette différence n’est ni rhétorique ni subjective : elle se mesure à l’aune des faits observables, des comportements répétés et de la relation entretenue avec les civils.
Là où l’AFC/M23 cherche à instaurer un ordre, fût-il contesté, imparfait ou politiquement décrié les troupes gouvernementales ne produisent que la dissolution de toute norme, transformant leur passage en synonyme de prédation, de peur et d’arbitraire.
Cette opposition, que l’on aurait souhaité ne jamais avoir à formuler, s’impose désormais avec la force de l’évidence. Elle est inscrite dans les traces laissées au sol, dans les institutions profanées, dans les vies brisées et dans la mémoire collective des populations.
D’un côté, un ordre revendiqué, structuré, assumé comme instrument de contrôle et de légitimation ; de l’autre, un chaos toléré, voire encouragé, érigé en mode de gouvernance par la violence. L’histoire, toujours impitoyable envers les impostures et les narrations mensongères, ne retiendra ni les communiqués officiels ni les proclamations martiales : elle consignera ce que les hommes ont fait, et non ce qu’ils ont prétendu être.
Les donneurs d’ordre ou la responsabilité supérieure dans la fabrique de l’horreur dans Uvira
Aucune violence collective ne surgit ex nihilo. Elle est toujours précédée d’un silence complice, d’une indulgence hiérarchique, d’une parole politique ambiguë ou d’une instruction tacite. En ce sens, la question essentielle n’est pas seulement qui a pillé, qui a détruit, qui a frappé, mais bien qui a permis, qui a couvert, qui a ordonné.
Les soldats et miliciens visibles ne sont que l’extrémité la plus brutale d’une chaîne de commandement dont les maillons supérieurs se réfugient dans l’ombre feutrée des bureaux, des états-majors et des cabinets politiques. Là où l’impunité est systémique, la violence devient rationnelle. Là où aucun compte n’est jamais exigé, le crime se transforme en stratégie.
Les donneurs d’ordre portent une responsabilité d’autant plus lourde qu’ils savent et qu’ils persistent.
Le pillage du palais de justice d’Uvira revêt à cet égard une portée symbolique accablante. Il ne s’agit pas seulement du vol d’objets matériels, mais de la mise à sac du principe même de justice. Lorsque ceux qui prétendent incarner l’État laissent détruire ses temples, ils proclament, sans discours, la faillite morale du pouvoir qu’ils exercent.
Dans un tel contexte, la banalisation du vol, présenté comme une fatalité nationale, n’est qu’un alibi commode. Ce n’est pas « tout le monde » qui vole : ce sont des structures qui organisent, tolèrent et récompensent la prédation. La responsabilité n’est donc ni diffuse ni abstraite ; elle est identifiable, hiérarchique et politique.
L’histoire des nations enseigne que les États ne s’effondrent pas d’abord par la défaite militaire, mais par la corruption de leurs propres forces. Quand l’armée cesse d’être un bouclier pour devenir un fléau, elle prépare elle-même le procès implacable que le temps, tôt ou tard, instruit sans appel.


















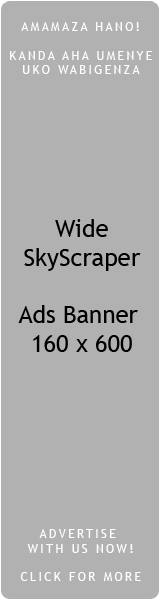
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!