Le chef ultra-radical de l’Etat islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, proclamé calife par ses partisans, a fait une première apparition publique, vendredi 4 juillet, dans la grande mosquée de Mossoul, au nord de l’Irak, occupée par ses combattants depuis début juin.

Vêtu d’une abaya et d’un turban noirs, ce redoutable chef jihadiste, qui inspire effroi et admiration, a appelé tous les musulmans à lui prêter allégeance et à lui « obéir, tant [qu’il] obéit à Dieu ». Portrait.
Une vidéo mise en ligne par l’institution al-Furqan, qui diffuse les messages de l’EI sur Internet et les réseaux sociaux, montre des fidèles écoutant avec attention Abou Bakr al-Baghdadi prononçant son prêche sur le minbar de la mosquée. On y distingue aussi des gardes du corps, reconnaissables à leurs tenues noires.
Une apparition « nécessaire »
Cette apparition publique rompt avec la stratégie de l’organisation de protéger son chef, qui n’a jamais montré son vrai visage, de peur de connaître le sort de ses trois prédécesseurs, assassinés par les forces américaines entre 2006 et 2010. Des spécialistes expliquent que cette apparition est plus une nécessité qu’un choix. En effet, selon la tradition, pour asseoir sa légitimité et être reconnu comme « commandeur des croyants », un calife doit prononcer un prêche dans une mosquée pour y recueillir l’allégeance de la communauté des musulmans et prêter serment de fidélité aux préceptes de la religion.
Le prêche du vendredi s’inscrit donc dans le cadre de la bataille pour la construction d’une légitimité en tant qu’unique et authentique représentant de « l’islam jihadiste », surtout qu’un grand nombre d’organisations et de personnalités se disputent ce titre. Toutefois, Abou Bakr al-Baghdadi et son « Etat islamique » semblent s’imposer face aux autres prétendants, et la proclamation du califat est une décision certes controversée, mais qui illustre la détermination et la puissance de cette organisation. D’ailleurs, de nombreux médias et experts qualifient désormais al-Baghdadi de « véritable héritier de Ben Laden ».
Pourtant, il y a quelques mois à peine, Abou Bakr al-Baghdadi, de son vrai nom Ibrahim ben Awwad ben Ibrahim al-Badri al-Samarraï, était peu connu du grand public et de certains experts.
Un descendant du Prophète ?
Né à Samarra, au nord de Bagdad en 1971, il est issu du clan des Badrites, installé entre Diyala, à l’est de la capitale irakienne, et Samarra, qui abrite les tombes des dixième et onzième imams chiites, Hassan al-Askari et Ali al-Hadi.
Les biographies diffusées par les partisans d’al-Baghdadi le présentent comme un descendant direct de l’imam Ali ben Abi Taleb, cousin et gendre du prophète de l’islam. Ce lignage prestigieux lui attribue des origines remontant à Quraiche, la tribu de Mahomet, une condition indispensable pour prétendre au titre de calife.
Michael Knights, expert de l’Irak à l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, affirme qu’Ibrahim al-Samarraï « était un salafiste (une branche rigoriste de l’islam) avant l’invasion américaine de l’Irak, en 2003, et le régime de Saddam Hussein aurait déjà gardé un œil sur lui ».
Les biographies qui circulent indiquent qu’Ibrahim aurait obtenu, au début des années 90, un doctorat en études islamiques à l’université de Bagdad, d’où lui vient le titre de « docteur ». Il est ensuite devenu prédicateur salafiste et a enseigné la charia dans plusieurs mosquées d’Irak.
Un homme brutal et sans pitié
Après l’invasion américaine, le jeune militant prend un nom de guerre, Abou Duaa, et crée, à l’est de Bagdad, un groupe armé appelé Jaiche al-Sunna wal Jamaa, qui ne jouera jamais un rôle de premier plan dans l’insurrection anti-américaine.
Vers 2004, on le retrouve dans la ville de Qaïm, à la frontière irako-syrienne, où il dirige la branche locale d’al-Qaïda, commandée à l’époque par le Jordanien Abou Missaab al-Zarkaoui. Il se forge rapidement la réputation d’un homme brutal et sans pitié, qui n’hésite pas à juger ses ennemis selon la loi islamique et à les exécuter en public, comme l’indique un rapport du Pentagone, cité par Colin Freeman, du Telegraph.
Quatre années de prison
Après avoir échappé à plusieurs tentatives d’assassinat, Abou Duaa est finalement arrêté par les Américains en 2005, et incarcéré dans le camp Bucca, dans le sud du pays. Il y passera quatre ans, au cours desquels il se rapprochera des chefs d’al-Qaïda rencontrés en prison.
Bien que qualifié de « dangereux » par les services de renseignement américains et irakiens, il sera relaxé en 2009, dans le cadre de la libération de milliers de détenus en prévision du retrait américain.
Alors qu’il était en détention, Abou Duaa apprend que le chef d’al-Qaïda en Irak, Abou Missaab al-Zarkaoui et son successeur, l’Egyptien Abou Hamza al-Mouhajer, ont été tués par les Américains. A sa sortie, il rejoint l’organisation, qui avait pris entretemps le nom d’Etat islamique en Irak (EII), et se rapproche du nouvel émir, Abou Omar al-Baghdadi. Quelques mois, plus tard, ce dernier est tué dans une attaque de drone. Selon les sources jihadistes, il aurait recommandé, avant sa mort, de choisir comme successeur Ibrahim al-Samarraï.

Washington offre 10 millions de dollars pour sa capture.REUTERS/Rewards For Justice/Handout via Reuters
Venger la mort de Ben Laden
C’est ainsi qu’en 2010, Abou Duaa se choisit un nouveau nom de guerre, Abou Bakr al-Baghdadi, et devient « émir » d’une organisation très affaiblie et en perte de vitesse. Les grandes tribus sunnites, coalisées par les Américains dans le cadre du « Mouvement du réveil » (Sahwat), se sont retournées contre elle. Le nouveau chef décide alors de procéder à un « retrait tactique » pour ressouder les rangs de ses troupes et restructurer l’organisation.
Il utilise les réseaux de financement d’al-Qaïda, sans passer par la direction de l’organisation, ce qui lui permet de préserver une large indépendance. Il met aussi en place son propre financement, basé sur le rançonnage, le racket et le pillage des biens des chrétiens et des chiites. Avec l’argent récolté, il achète des armes sur le marché noir et s’offre l’allégeance de chefs de tribus et de clans.
L’EII abandonne la stratégie d’occupation de vastes territoires et des villes pour les opérations ciblées contre le pouvoir irakien et les chiites en général. Il jurera de venger la mort d’Oussama ben Laden, tué en mai 2011, par 100 attaques suicides, un serment qui sera largement tenu.
Ambitieux et fin stratège
Les ambitions d’Abou Bakr al-Baghdadi apparaîtront dans son refus de prêter serment d’allégeance au successeur de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri. Petit à petit, il applique sa stratégie de conquête. Il trouvera dans la crise syrienne une occasion en or pour étendre son autorité. Vers la mi-2011, l’Etat islamique en Irak dépêche, en Syrie, l’un de ses lieutenants, Abou Mohammed al-Joulani, pour y fonder une branche locale, le Front al-Nosra, qui deviendra, en quelques mois, l’un des plus puissants groupes rebelles.
Al-Joulani prend alors ses distances avec son chef et se rapproche d’Ayman al-Zawahiri, qui le désigne représentant officiel d’al-Qaïda en Syrie. Abou Bakr al-Baghdadi riposte et décide de fusionner al-Nosra et l’EII et crée une nouvelle entité, l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL). Al-Joulani refuse d’obtempérer et préfère s’allier aux groupes rebelles syriens. Les combats fratricides, qui durent depuis huit mois, ont déjà fait 7000 morts.
La guerre sur le front syrien contre les rebelles et le régime ne l’empêche pas de préparer une vaste offensive en Irak, contre le pouvoir du Premier ministre chiite, Nouri al-Maliki.
De nombreux succès militaires
Soutenu par des tribus sunnites et d’anciens officiers de Saddam Hussein, l’EIIL occupe, début juin, la deuxième ville d’Irak, Mossoul, et la province de Ninive, une partie de celle de Salaheddine, de larges portions de la région d’Al-Anbar et de la frontière avec la Syrie. Ses combattants se rapprochent de Bagdad à partir du Nord, de l’Est et de l’Ouest.
Fort de ces succès militaires, Abou Bakr al-Baghdadi s’impose comme un chef de premier plan auprès des jihadistes du monde entier. Dans les rangs de son organisation, on retrouve des combattants de près de 60 nationalités, et son chef militaire, Abou Omar al-Chichani, est d’origine tchétchène. Il contrôle une quinzaine de puits de pétrole, sur un territoire de près de 70 000 kilomètres carrés, à cheval entre la Syrie et l’Irak, où ses tribunaux religieux appliquent une vision extrémiste et intolérante de l’islam.
A ce stade, l’Etat islamique (nouvelle appellation de l’EIIL) pense avoir réuni les conditions politiques, militaires et religieuses nécessaires pour rétablir le califat, qui sera proclamé le 29 juin. Mais pour le calife Ibrahim, le « combat pour faire régner la loi de Dieu » ne fait que commencer.






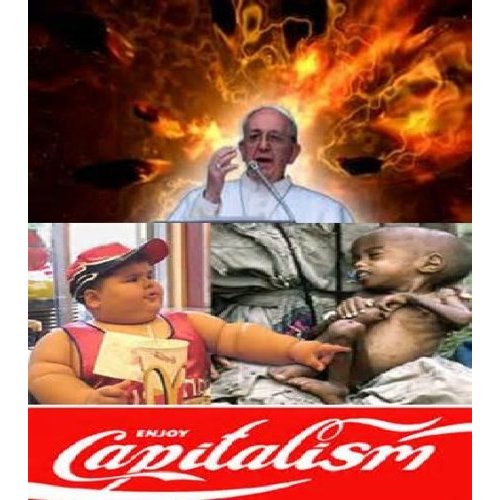






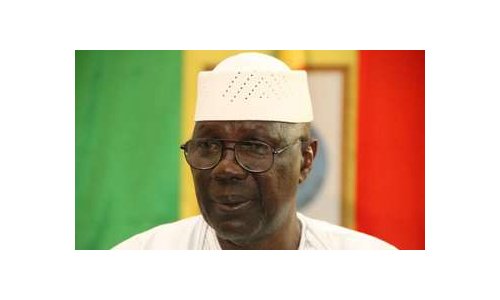



AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!