Le génocide qui est survenu au Rwanda entre avril et juillet 1994 ne cesse de questionner l’histoire pour savoir qui sont les véritables acteurs dans cette triste entreprise et comment circonscrire l’étendue de leurs rôle funeste. Et puis comment démêler la dimension des relations diplomatiques de coopération bilatérale entre les deux Etats rwandais et Français et l’intervention funeste et criminelle de la coopération française au moment de l’irruption de ce génocide ? Autant de questions auxquelles l’auteur de ce texte ci-après tente de donner une lumière.

L’auteur Guillaume, Henri-Michel, Marie Ancel, né le 3 décembre 1965 à La Croix-Rousse (Lyon), est un manager général. Après un parcours d’officier dans l’Armée de terre, il est recruté par la SNCF comme general manager pour porter de la transformation en particulier dans le domaine du management et de l’entreprise apprenante. En 2013, il rejoint le groupe Humanis, référence dans le monde de la protection sociale.
Il fait partie en 1994 de l’Opération Turquoise au Rwanda ; un passage qui le questionne à chaque minute de sa vie. Un traumatisme qu’il tente de se vacciner
Note de la Rédaction
Le Rwanda est un pays d’Afrique centrale, de la région des Grands Lacs. Le 13 Août 1993, après des années de conflits entre Hutus et Tutsis, des accords de paix (dits d’Arusha) sont signés et le pays semble s’apaiser. Mais l’avion du président Juvénal Habyarimana est abattu en avril 1994, déclenchant un massacre systématique des Tutsis et des opposants hutus.
Ce massacre a fait plusieurs centaines de milliers de victimes. Un million d’après les statistiques gouvernementales rwandaises.
Ce massacre est qualifié de génocide par l’ONU et s’est révélé avoir été organisé et impitoyablement conduit par le gouvernement intérimaire rwandais (GIR) qui a pris le pouvoir dans la foulée de l’assassinat du président.
La France, qui avait soutenu le gouvernement Habyarimana, décide d’intervenir militairement, sous couvert d’un mandat de l’ONU, et déclenche l’opération Turquoise en juin 1994, c’est une des plus importantes interventions militaires françaises en Afrique depuis des décennies et sans doute une des plus controversées.
La France a soutenu de fait ce gouvernement intérimaire au moins jusqu’à son renversement par les soldats de Paul Kagamé, redoutable chef de guerre, qui monopolise le pouvoir depuis cette date.
L’opération Turquoise s’est déroulée de juin à août 1994, elle est officiellement affichée comme ayant poursuivi un "but strictement humanitaire", largement en contradiction avec une partie des missions qui nous ont été confiées sur place.
Cette opération a surtout clôturé 4 ans d’intervention française au Rwanda achevées par un drame sans égal, un génocide.
Pourquoi je n’ai pas parlé à l’époque ? Le devoir de réserve
En 1994, j’avais 28 ans et j’ai participé à cette opération en tant que capitaine du 68° régiment d’artillerie d’Afrique, unité d’artillerie qui était dédiée à la légion étrangère. Cela faisait déjà 5 ans que j’étais en unité de combat, et je revenais d’une mission au Cambodge que je qualifierais d’éprouvante.
Dans ce régiment d’artillerie professionnel, j’avais acquis une spécialité de guidage des frappes aériennes, comme FAC (Forward Air Controller, soit en français Officier Contrôleur Avancé).
Un bombardement, une frappe aérienne dans le jargon militaire, est très difficile s’il n’y pas de guidage. Le guidage sur la bonne cible nécessite d’être à proximité, pas toujours en terrain maîtrisé, et avec une espérance de vie limitée si l’on considère qu’il est nettement plus facile de flinguer un TACP (l’équipe de guidage), que d’abattre un avion à 900 km/h...nous recevions donc dans ce régiment un entraînement spécial pour la recherche et la destruction de cibles, avec des frappes aériennes ou terrestres. Cela développe une grande capacité d’observation, de rapidité de prise de décision et d’autonomie ...
Le 22 juin 1994, j’ai été détaché pour l’opération Turquoise comme FAC d’une compagnie de combat du 2°REI (Régiment étranger d’infanterie, Nîmes) avec laquelle je suis parti le 23 juin.
J’insiste sur le fait que je n’assistais pas aux discussions politico-militaires et que je n’avais aucun accès aux cercles de décision qui décidèrent cette intervention. Par contre je sais plutôt bien ce que j’ai fait la-bas, entre le Zaïre et le Rwanda, avec quelques centaines d’hommes dont l’horizon était assez immédiat et les actions pour le moins concrètes.
Je suis rentré le 05 août, pour me préparer à la mission suivante, Sarajevo.
En revenant de cette opération, j’étais très interrogatif sur le rôle qu’on nous avait fait jouer, sur le soutien apporté au gouvernement intérimaire (GIR dont j’ignorais encore le rôle central dans le génocide) et aux forces armées rwandaises (FAR) dont nous n’avions pu que constater la déliquescence face au FPR de Paul Kagame.
J’étais interrogatif, mais en faire état publiquement m’était interdit par le devoir de réserve imposé par le statut général des militaires. On reproche souvent aux Armées cette culture du silence, cette pression constante qu’exercerait l’environnement militaire. En réalité c’est surtout une culture du non-écrit. Vous disposez en effet d’une grande liberté de parole en interne, je ne me souviens pas qu’une seule fois un militaire m’ait demandé de me taire, dans nos cercles "fermés". Ce qui est proscrit en réalité, c’est de s’exprimer publiquement et donc d’écrire.
Par exemple, mes différents patrons en unités opérationnelles m’ont toujours demandé d’effacer, de mes rapports de retour de mission, les parties qui questionnaient autrement que sur l’aspect technique de nos interventions, alors même qu’ils en discutaient ouvertement avec moi.
Bien peu de militaires écrivent donc, et leur rare production est trop souvent une autobiographie fastidieuse ou un hommage à leur capacité de ne pas s’exprimer. C’est particulièrement vrai pour le Rwanda où les quelques ouvrages d’origine militaire sont affligeants, des larmes de crocodile plus que d’honneur...
Comment cette histoire n’a cessé de m’occuper l’esprit
Ai-je été silencieux pendant 20 ans ? Je crois n’avoir jamais cessé d’en parler lors de "discussions privées", dîners entre amis qui font vite comprendre qu’ils ne comprennent pas forcément ce débat et discussions universitaires pendant des cycles de formation où l’on vous écoute avec intérêt mais sans que cela n’ait plus de suite. Il ne me semble pas que c’était du désintérêt de ceux qui m’écoutaient, souvent avec attention, mais cela ne dépassait jamais la sphère du privé et n’était jamais relayé ou étendu à un débat, tout cela restait de simples discussions privées.
Je dois ajouter aussi que, quelques mois après le Rwanda, je suis parti pour une autre mission compliquée, comme chef de TACP (en charge des frappes aériennes) du 1° REC (Régiment Étranger de Cavalerie, Orange) à Sarajevo. Et puis j’ai enchainé d’autres missions et le Rwanda s’éloignait...
Cependant je continuais à gamberger sur ce sujet d’autant que j’ai quelques amis rwandais dont les plaies ne se refermeront jamais et dont le simple contact me rappelle inexorablement le drame de 1994. Ce sont des Tutsis et des Hutus, ce sont des Rwandais dont le point commun n’est pas l’esprit de revanche ou de vengeance, mais d’avoir "connu" un génocide. N’allez pas croire pour autant qu’ils m’aient demandé une seule fois de témoigner, en réalité il leur est impossible d’en parler. Si le sujet est évoqué, leurs yeux restent ouverts mais leurs regards se vident, enfermés dans un monde des ténèbres, l’indicible. Ces Rwandais ne m’ont jamais demandé de témoigner, mais ils m’ont tous remercié de l’avoir fait, quelles que soient leurs convictions.
Pourquoi je n’ai pas été entendu par la Mission d’information parlementaire
1997, j’entends à la radio le débat parlementaire en Belgique, sévère investigation sur leur rôle et leurs responsabilités, je m’attends à un débat français, qui arrive enfin en 1998 avec la création de la mission d’information parlementaire sur le Rwanda, présidée par Paul Quilès. Je pense qu’enfin je vais être interrogé et que je vais pouvoir informer nos parlementaires des sujets qui continuaient de m’interroger : les missions de combat avec lesquelles nous sommes parties dans une opération "humanitaire", la bienveillance dont nous avons fait preuve à l’égard du GIR et des FAR dont l’implication dans le génocide s’éclairait un peu plus chaque jour, et surtout ce convoi d’armes vers le Zaïre...
je vais demander d’être auditionné quand un ami, que je crois particulièrement bien intentionné, vient m’avertir que la MIP n’est surtout pas une commission d’enquête et que mes interrogations y seraient très mal venues. Et puis je lis dans le Monde le compte rendu d’audition de Jean Christophe Mitterrand, dont les Rwandais parlaient beaucoup...
Une audition ?
– Bonjour cher monsieur comment allez-vous ?
– Vous avez quelque chose à voir avec le drame rwandais dans lequel il vaudrait mieux que vous n’eussiez rien à voir ?
– Non, à la bonne heure, merci et à bientôt.
Mon conseiller avait donc raison, cette mission n’enquête point, elle s’informe, recouvre et protège.
Je ravale ma déception et une certaine amertume. Je suis, mais de plus en plus loin, les débats du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les quelques mises en accusation en Belgique et surtout en Suisse, ce refuge historique qui pour une fois refuse d’être le paradis des bourreaux. Et je continue à parler dans le désert d’un événement de plus en plus ancien... Je parle mais je ne suis pas entendu.
Comment j’ai parlé à la presse...dans le vide
2005, je quitte l’armée de terre,
ce sujet est toujours tapi dans l’ombre de ma mémoire, j’en discute régulièrement avec un ami suisse, diplomate engagé, j’aimerais que mon témoignage ne soit pas enterré dans les eaux sombres et sans fond de l’oubli... Lui, qui m’a accompagné pour la mission d’extraction de rescapés la plus difficile que nous ayons dû réaliser pendant l’opération Turquoise, s’exprime à travers les informations qu’il diffuse habilement pour que les génocidaires ne soient jamais en paix. J’aimerais en faire autant mais je n’ai jamais eu l’âme, ni les réseaux d’un enquêteur.
2008, je dirige maintenant, pour le groupe SNCF, les lignes Transilien de Paris Saint Lazare, et en lisant un très grand quotidien français, je récupère les coordonnées d’un reporter international pour lui proposer d’évoquer le sujet rwandais. Nous déjeunons ensemble tout près de Saint Lazare, terminus des illusions. Ce reporter, qui connaît très bien l’Afrique, m’écoute avec intérêt. "Intéressant, mais tout cela est connu..." Je tombe un peu de l’armoire, alors ce que j’essayais de dire depuis des années est enfin connu, analysé, expliqué ? Il n’est pas aussi affirmatif, mais ne voit pas comment il pourrait utiliser ma matière. Retour au fond du lac.
2009, je récidive avec un autre grand reporter du même grand journal, un autre spécialiste de l’Afrique, il m’écoute avec le même intérêt et me fait à peu près la même réponse, "intéressant mais déjà connu". Et là je me range à l’évidence, mes questions sur le rôle de la France dans le drame rwandais sont "publiques" et il faut maintenant laisser les historiens démêler les fils de l’écheveau. Je suis rassuré et presque un peu déçu, de n’avoir rien fait pour aider à temps ce débat salutaire.
Pourquoi j’ai commencé à écrire
2012, revers de fortune, je suis au chômage, pardon en "transition professionnelle" et je m’ennuie. J’ai l’habitude de grosses journées de travail, mais même avec 3 à 4 rendez-vous par jour, je dispose d’un temps libre auquel je ne suis pas habitué. Mes proches s’inquiètent de me voir tourner comme un lion en cage. Ma fille aînée, qui travaille depuis plusieurs années dans l’édition, me propose d’écrire un livre, pour m’occuper. J’ai besoin d’une matière originale et qu’en même temps je connaisse suffisamment, je choisis d’abord le Cambodge et puis finalement le Rwanda pour écrire...un polar ethnologique. Mais impossible de construire une trame policière qui tienne la route, autrement qu’en plagiant ce que j’ai lu chez de bons auteurs.
Alors je prends un autre parti, raconter comment se passe une opération militaire, vue de l’intérieur de l’opération, par ses acteurs mêmes. Je veux donner une image de ce qu’est en réalité une intervention militaire, non pas une analyse stratégico-politique, non plus un témoignage poignant de victime ou horrifiant de bourreau. Et je m’aperçois qu’il existe très peu de ce type de récit, je me mets donc au travail avec ma fille comme (redoutable) conseillère de rédaction qui me fait réécrire intégralement deux fois mon manuscrit.
Elle veut que je sorte de l’autobiographie, "qui n’intéressera personne et oblige à se justifier à toutes la pages", j’invente donc un personnage féminin comme observatrice en même temps qu’actrice de l’action à laquelle elle participe. Ma fille m’oblige aussi à effacer mon point de vue dans le récit pour laisser le lecteur seul juge de ce que je décris. Un exercice difficile, auquel je me plie sous sa pression.
Comment mon roman fait voler en éclats la version officielle de l’opération Turquoise
2013, je termine enfin ce livre, Vents sombres sur le lac Kivu,dont le titre initial était Carnet d’opération de la capitaine Victoire Guillaumin. C’est un roman, j’ai modifié tous les noms mais je raconte avec précision ce dont je me souviens du déroulement et des enchaînements de cette opération, de la mise en alerte à la dernière extraction vraiment compliquée de rescapés tutsis. J’essaie de respecter aussi les dates, mais sans y apporter plus d’attention, ce n’est pas un document historique mais un roman "autrement" sur un drame historique.
J’ai conscience de ne donner qu’un éclairage partiel et limité à mon expérience concrète, mais je ne veux pas inventer d’histoires, à l’exception de celle de la dernière famille sauvée, comme une trame parallèle à notre rencontre.
J’ai peur que ma mémoire me trahisse, 20 ans après, alors je m’oblige à reconstituer
l’enchaînement des faits, sans jamais regarder le carnet d’opération que je tenais à cette époque. C’est seulement une fois le premier manuscrit achevé que je l’ai ouvert, et je n’y ai trouvé aucune contradiction, quelques inversions de dates et d’événements qui expliquent les décalages qui existent entre mes témoignages et le roman, mais surtout deux aspects troublants : les noms que je croyais avoir inventés existent tous, ce sont en général les prénoms de ceux dont je voulais garder l’anonymat. Et surtout, les mots que j’ai utilisé pour décrire les faits 20 ans auparavant sont les mêmes...curieuse fonction que la mémoire.
2014, je publie en février Vents sombres sur le lac Kivu, après avoir essuyé pendant un an les refus polis des éditeurs frileux.
C’est la publication de ce roman qui va déclencher mon témoignage public.
Très rapidement, il apparaît que mon récit, que je considérais comme une matière connue, est en réalité incompatible avec la version officielle de l’opération Turquoise. Je l’ai compris lors d’un colloque privé en mars, qui réunissait des historiens, des hommes politiques et des diplomates pour examiner justement le rôle de la France dans le drame rwandais. J’étais invité du fait de la publication de mon roman, mais comme témoin direct de l’intervention française. J’ai raconté, devant l’assemblée qui pensait bien connaître le sujet, ce que j’avais fait pendant l’opération Turquoise, à mon niveau modeste mais très opérationnel... et j’ai vu 24 mâchoires se décrocher. Je croyais avoir publié une matière connue et depuis longtemps intégrée dans les travaux des historiens, j’ai vu leur stupéfaction en m’entendant.
Bien sûr, certains m’ont assuré par la suite qu’ils "connaissaient" une grande
partie de ce que je racontais, mais ils n’en avaient jamais eu la confirmation par un acteur opérationnel de cette intervention, ni un récit cohérent et argumenté. J’ai dû faire face à quelques réactions surprenantes. D’abord, et je crois être resté très poli, un des intervenants, plus politique qu’historien, a tenté de m’expliquer devant l’assemblée effarée qu’en fait je n’avais pas bien compris les missions qui m’avaient été confiées et que tout cela n’était que malentendu, puisque lui savait quels ordres avaient été donnés...
Beaucoup plus subtile fut la réaction du président du colloque : "c’est une question d’interprétation de faits qui doivent être resitués dans un contexte plus global et dont vous ignorez certains aspects." Et de conclure naturellement qu’il serait mieux que je m’adapte à l’édifice plutôt que d’en perturber l’agencement.
Certes, mais son changement de couleur quand j’ai parlé des premières missions de combat qui nous avaient été confiées, du soutien apporté au gouvernement intérimaire et surtout de la livraison d’armes en pleine mission humanitaire, en disait plus long que son discours et montrait sans ambiguïté les lacunes de la mission d’informations parlementaire qu’il connaissait mieux que personne.
Cela me choque beaucoup, car comment comprendre ce qui s’est passé et s’assurer qu’un tel drame ne puisse se reproduire si on ne connaît même pas les pièces du puzzle ? C’est un défi à l’intelligence collective que je ne peux accepter : la version officielle est terriblement éloignée de la réalité opérationnelle, dont je ne connais encore une fois qu’une infime partie, mais tragiquement incompatible. Comment comprendre si on ne sait pas ?
Pourquoi j’ai accepté de témoigner publiquement
Avril 2014, 20 ans après les faits, j’ai souhaité témoigner publiquement sur les quelques pièces de puzzle que je possède, pour qu’on arrête d’endormir les Français avec une version officielle qui est un déni du rôle de notre nation dans le drame rwandais et un affront à l’intelligence de nos citoyens, "dormez en paix, il ne s’est rien passé".
Le monde entier commémore les 20 ans du génocide rwandais, et je n’ai eu aucun mal à trouver des journalistes sérieux, qui travaillent depuis des années sur le sujet et ont souvent eux-mêmes publié, pour s’intéresser à mon témoignage et le diffuser au public.
En 2014, nous ne savons toujours pas quel a été le rôle réel de la France dans le drame rwandais, parce que des zones d’ombre sont soigneusement gardées pour masquer de graves erreurs.
Pour ceux qui se demanderaient si mon témoignage public n’est pas une habile promotion du livre, les éditeurs expliquent mieux que moi qu’une polémique détourne de la lecture. Concrètement ceux qui parlent aujourd’hui de cette controverse n’ont jamais lu mon roman et se contentent en réalité des trois paragraphes d’un article.
Je le regrette, parce que je crois que ce livre constitue aujourd’hui une des images plus réalistes de l’opération Turquoise. Il montre en particulier le grand professionnalisme de mes compagnons d’armes, l’immense chaos auquel il fallait faire face au quotidien et enfin la confusion dans laquelle nous avions été consciencieusement laissés sur les responsabilités effrayantes de ceux que nous avons soutenus de fait.
Pourquoi ce débat doit avoir lieu
Que ma démarche soit claire, en tant que citoyen, j’aimerais savoir quelles décisions d’intervention de la France au Rwanda ont été prises, qui en a décidé, avec quels objectifs et sur les conseils de qui. En tant qu’ancien militaire, j’aimerais que cela ne consiste pas à demander des comptes à mes compagnons d’armes qui ont mené cette opération de manière très professionnelle, comme on l’attendait d’eux, et dont je suis solidaire.
Je veux que ce débat ait lieu, et sans attendre que les protagonistes aient disparu comme nous l’avons fait si courageusement après la guerre d’Algérie.
Un mot enfin sur tous ceux qui m’ont "conseillé" de me taire, ils sont nombreux, ils ont tous de bonnes raisons : je fais polémique, ce n’est pas à moi de porter ce débat, je pourrais compromettre ma carrière professionnelle, je ne respecte pas l’obligation de réserve qui devrait s’étendre même au delà du service actif, je brise la culture du silence, mes propos pourraient être compris comme une critique de mes compagnons d’armes, j’alimente une polémique internationale, je questionne l’image de la France, je mets en difficulté des décideurs politiques encore (très) influents qui me neutraliseront, j’attire l’attention sur des opérations financières qui ne doivent pas être dévoilées, je me mets inutilement en avant, je ne me protège pas assez, je n’épargne pas les miens, je ne peux pas partir en croisade, je serai seul, je gêne...
Et bien s’il me fallait une seule raison pour parler, ce serait justement celle-ci : qu’on me conseille de me taire. Je me tairais quand ceux qui devraient parler se mettront à témoigner et que nous pourrons rendre hommage, dignement, aux centaines de milliers de victimes que, peut être, nous aurions pu empêcher.
Je publierai, dans les semaines qui viennent, quelques articles sur des événements clefs du rôle de la France au Rwanda dont j’ai été témoin.
Ces articles sont destinés à ceux qui s’intéressent à la reconstitution intelligente du puzzle des événements qui doivent permettre de comprendre et aussi de juger par soi-même...







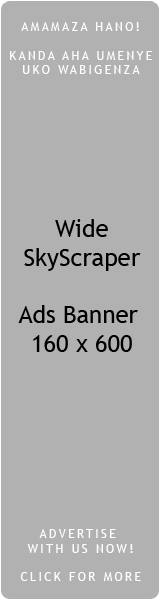
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!