Républicaine ou démocrate, une administration américaine a grand besoin de bras et d’idées, qui lui sont fournis par le Congrès, mais aussi par les think tanks et les organisations politiques à but non lucratif.

Barack Obama et Chuck Hagel lors de l’annonce de la nomination du dernier nommé au poste de secrétaire d’Etat, le 7 janvier 2013. REUTERS/Kevin Lamarque. -
La période nommée « transition » entre la fin d’une présidence américaine et la suivante est un véritable défi pour les organisations et les institutions, qui porte sur plus de 1.000 nominations à faire entériner par le Sénat, la sélection d’environ 800 postes de responsables de haut niveau et, en moyenne, 1.400 postes politiques.
Pour les universitaires James Pfiffner, de la George Mason University (Virginie), et Martha Joynt Kumar, de la Towson University (Maryland), qui dirigent tous deux des projets étudiant les transitions présidentielles américaines, à la fin d’un premier mandat, un grand renouvellement s’observe traditionnellement : celle entre Obama I et Obama II n’a pas échappé à la règle.
Un tel défi se prépare longtemps à l’avance. Mitt Romney avait ainsi, dès 2010, chargé des membres de son équipe de préparer la gestion des suites de sa possible élection. Le rapport nommé « Readiness Project » posait les priorités à suivre, définissait un agenda en sériant les procédures.
publicité
L’équipe d’Obama a commencé dès l’été dernier à travailler dans une perspective identique en cherchant à identifier les personnalités susceptibles de servir durant le second mandat de la présidence démocrate. Certains choix, très emblématiques, peuvent définir les lignes politiques du mandat qui a officiellement débuté dimanche 20 janvier.
Il s’agit en effet à la fois d’envoyer un signal politique fort tout en disposant d’une administration dynamique. Dans un tel cadre, certaines structures jouent un rôle particulièrement significatif en fournissant des experts, des projets et des idées.
Poids considérable des think tanks
Washington D.C., comme capitale politique des Etats-Unis, constitue le creuset des think tanks, qui possèdent un poids considérable dans certains domaines, à commencer par celui de l’information. En 2005, par exemple, plus de 411 millions de dollars furent dépensés par les think tanks américains (selon les chiffres révélés par les services fiscaux américains et fournis par le chercheur Murray L. Weidenbaum dans The Competition of Ideas), afin de gagner l’attention des décideurs politiques à travers des tribunes dans les journaux, des événements, des colloques, etc. Sur cette somme, 140 millions de dollars sont dépensés par cinq acteurs majeurs, surnommés du côté du Capitole les DC-5.
Les deux plus anciennes structures de Washington, The Brooking Institution (libérale, fondée en 1927) et son pendant conservateur, l’American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI, fondée en 1943) ont été rejoints par The Center for Strategic and International Studies (CSIS, bipartisan, autonome de l’université de Georgetown depuis 1986), le Cato Institute (qui se présente comme libertarien, un conservatisme essentiellement fondé sur la liberté personnelle, et a été fondé en 1977) et l’Heritage Foundation (conservateur, fondé en 1973).
L’histoire récente montre qu’ils ont également pesé sur les élections présidentielles et les programmes des candidats.
A la suite de la dissémination des idées libérales (comme l’attestent les projets, en partie hérité du New Deal de Franklin D. Roosevelt, de Kennedy avec les « nouvelles frontières », puis de Lyndon B Johnson avec la « Grande Société »), les années 1970 voient l’espace politique conservateur se structurer à travers la création du Cato Institute ou de l’Heritage Foundation, participant d’un véritable effort de créer une « contre-intelligentsia conservatrice ».
La révolution Reagan illustre l’important succès de cet effort politique et consacre tout particulièrement le succès de l’Heritage Foundation.
En 1980, celle-ci publie le livre “Mandate for Leadership”, un recueil d’idées, de principes et de valeurs qui constitueront la base sur laquelle s’appuiera la présidence de Ronald Reagan. Selon un article publié par la revue Public Administration Times en 1985, les deux tiers des idées proposées par les membres de l’Heritage Foundation ont été adoptées par l’administration Reagan lors de son premier mandat (dérégulation, réforme fiscale…).
Le PNAC, paroxysme des revolving doors
De manière plus spectaculaire encore, le Project for the New American Century (Pnac) eut une influence décisive sur la politique américaine récente, ce qui eut des répercussions mondiales. Il a été créé en 1997 par des néoconservateurs reconnus (William Kristol, Robert Kagan, Paul Wolfowitz et surtout Dick Cheney, ancien secrétaire à la Défense sous George H.W. Bush, et Donald Rumsfeld, ancien secrétaire à la Défense sous Gerald Ford) qui entendaient apporter des réponses stratégiques aux questions nées de la fin de la Guerre froide et développer des outils accordant aux Etats-Unis un leadership unique.
Le Pnac écrivit dès 1998 au président Clinton pour l’avertir du danger que représentait l’Irak. En 2000, il publiait un rapport, Rebuilding America’s Defenses : Strategy, Forces, and Resources for a New Century [PDF], qui prônait un développement très important de la puissance militaire américaine. Ce rapport a servi de modèle à des parties significatives du rapport National Security Strategy (NSS) de Bush Jr., développé entre 2002 et 2006. Il est significatif, par exemple, d’observer que la demande de l’administration Bush d’une augmentation du budget des armées de 3 à 3,8% du PIB correspondait très exactement à la proposition du rapport Pnac.
Un grand nombre de membres du Pnac intégreront l’administration Bush, au point que des observateurs de la vie politique américaine parleront de « Pnac-White House complex ». Les exemples les plus célèbres sont les suivants :
Dick Cheney, vice-président de George W. Bush de 2001 à 2009
Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense de 2001 à 2006
Lewis Libby, assistant pour les affaires de sécurité nationale de 2001 à 2005
Eliot Abrams, conseiller pour la sécurité nationale sur les stratégies de démocratie globale de 2005 à 2009,
Richard Perle, président de la commission de la politique de défense de 2001 à 2003
John Bolton, chargé des questions de désarmement au Département d’Etat de 2001 à 2005.
La relation très étroite entre le Pnac et l’administration de George W. Bush illustra de manière paroxystique le phénomène de revolving doors entre le militaire, les entreprises de Défense et le Congrès, poussant à la création du concept d’un military-industrial-think tanks complex.
En effet, Dick Cheney était par ailleurs patron de l’énorme entreprise pétrolière Halliburton, qui signa pour plus de 17,8 millions de dollars de contrats en Irak pour la période 2003-2006.
Une telle intrication permet de comprendre pourquoi l’administration Obama a pris soin de ne pas se lier trop fortement avec un think tank particulier (et spécifiquement le Centre for American Progress, créé par Clinton à la fin de son second mandat). Pourtant, la technicité des dossiers et le besoin de connaître finement les arcanes de Washington rendent certaines personnalités sans doute incontournables.
C’est pourquoi on retrouve un think tank à travers le succès d’un concept de politique étrangère, le smart power, dont Hillary Clinton s’était fait l’écho en le citant plus de sept fois lors de son audition de confirmation devant le Congrès comme secrétaire d’Etat en 2009.
Ce concept a été affiné et adapté par le CSIS à partir de l’expertise et de la renommée de Joseph Nye, qui avait déjà « inventé » les concepts de soft et de hard power dans son ouvrage Bound to Lead. Il s’est ensuite déplacé de la sphère des idées à celle du monde politique jusqu’à devenir, en 2007, la ligne directrice de la future politique en matière d’affaires étrangères de l’administration Obama.
Trajectoires personnelles
La circulation du concept et la manière dont des outils ont été développés afin de le polir et de convaincre les médias et les décideurs est révélatrice du pouvoir d’attraction des think tanks aux Etats-Unis. Toutefois, le concept de smart diplomacy semble avoir disparu des médias presque aussi rapidement qu’il n’a émergé. Et certaines trajectoires personnelles, d’un think tank à un autre, permettent sans doute d’en comprendre les raisons.
L’ancien chef de cabinet de Bill Clinton, John Podesta, fondateur du Centre for American Progress, fut en effet mandé par Obama pour diriger la transition entre son administration et celle de Bush.
Podesta était également membre du directoire du Center for a New American Security (CNAS), un petit think tank (30 membres pour un budget de 6 millions de dollars en 2009) créé en 2007 et dirigé par une ancienne de l’administration Clinton et du CSIS, Michèle Flournoy.
Cette dernière fut nommée par Obama Under Secretary of Defense for Policy, devenant de fait la plus puissante des femmes du Pentagone.
Le second fondateur du CNAS, Kurt Campbell –ancien membre du National Security Council sous Bill Clinton– a lui été nommé Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs.
Tous deux publièrent en 2007 un article remarqué prônant le pragmatisme en matière de relations internationales, « The Inheritance and the Way Forward ».
Il est à noter que l’Under Secretary for Political Affairs d’Obama I, Wendy Sherman, qui pourrait garder son poste dans la nouvelle administration, est également membre du CNAS. Toutes ces personnalités étaient par conséquent en mesure de nourrir la pensée stratégique américaine sans utiliser l’appareil théorique et rhétorique d’un autre think tank.
Obama doit cependant faire face à un certain nombre de turbulences politiques et plusieurs ont modifié les pronostics portants sur sa seconde administration. Le général Petraeus était jusqu’il y a peu considéré comme un responsable ayant une forte carte politique à jouer. Sa démission a ouvert un véritable jeu de chaises musicales et permit également de laisser poindre quelques observations et révélations sur le rôle de facilitateur qu’il joua auprès de plusieurs think tanks pour qu’ils se rendent enquêter en Afghanistan.
En effet, de même que le général porta une attention soutenue aux médias, il permit à des chercheurs (parmi lesquels Fred Kagan, de l’American Entreprise Institute, qui passa près de 270 jours en Afghanistan) de bénéficier de bureaux à Kaboul dans son quartier général et de se déplacer sur les terrains d’opérations aux moyens d’hélicoptères, parfois à la surprise et à l’agacement de ses propres généraux.
Trois ténors du Sénat
En nommant John Kerry pour remplacer Hillary Clinton, Obama a donc choisi de ne pas soutenir Susan Rice, ambassadrice à l’ONU et attaquée par les sénateurs républicains, qui exigeaient des éclaircissements sur la manière dont elle avait présenté dans un entretien l’attaque de l’ambassade américaine de Bengazhi, où l’ambassadeur américain Christopher Stevens trouva la mort.
Le retrait de cette ancienne chercheuse de la Brookings n’a pas non plus profité à Michèle Flournoy, pourtant longtemps annoncée au Pentagone et qui a prouvé lors de la dernière campagne sa réactivité en fournissant à Obama notes et rapports pour contrer Romney sur chacune des interventions en matière de politique étrangère.
Obama, en nommant Kerry, offre aux Républicains la possibilité de récupérer son siège au Sénat, ce qui est politiquement habile pour négocier la suite des accords budgétaires, mais compose également son administration avec trois ténors du Sénat, tous membres du Foreign Relations Committee : Joe Biden, John Kerry et Chuck Hagel à la Défense. Aussi, aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent déjà sur ces choix qui privilégient des professionnels de la politique plutôt que des personnalités originaires de différents horizons professionnels.
C’est d’ailleurs avec en mémoire la manière dont Susan Rice a été attaquée et finalement ne put accéder au poste de Hillary Clinton, et en prévention des attaques toutes aussi féroces qui me manqueront pas, qu’une structure à but non lucratif nommée « Americans For Strategic Leadership » est actuellement créée : sa mission sera de défendre les points de vue et propositions au Pentagone de Chuck Hagel, qui, comme Républicain modéré et membre de l’administration Obama, aura sans nul doute de nombreux détracteurs.
On le voit, sur le principe du revolving door, les principaux think tanks américains ont longtemps constitué des viviers pour les administrations. Et alors qu’Obama semble pour son second mandat privilégier une garde rapprochée constituée différemment, de nouvelles structures émergent afin d’appuyer celle-ci.
De leur côté, les Républicains se préparent également : près de 60 nouveaux membres du Congrès ont ainsi pu suivre un séminaire de deux jours organisé par Heritage Foundation afin de mieux appréhender les grands enjeux politiques depuis le Capitole.
Ce programme, nommé « New Members Orientation », est organisé tous les deux ans depuis 1992 et a pour enjeu de structurer et d’organiser les nouveaux élus en une force de frappe cohérente. Une nouvelle preuve que les think tanks sont indissociables du fonctionnement de la démocratie américaine.















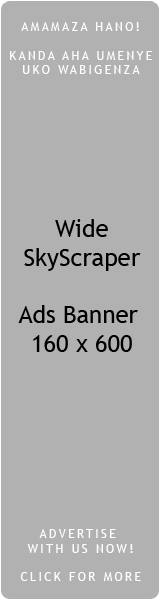
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!