Le procès - historique - doit s’ouvrir mardi devant lacour d’assises de Paris. Octavien Ngenzi, 58 ans, et Tito Barahira, 64 ans, sont poursuivis pour génocide et crime contre l’humanité. Les deux hommes sont jugés pour leur rôle dans le massacre de centaines de Tutsi tués lors du génocide rwandais d’avril 1994. Il s’agit là du deuxième procès du Rwanda à se tenir à Paris après celui de Pascal Simbikangwa, un ex du renseignement, condamné en 2014 à 25 ans de prison. L’homme a déclaré faire appel.
Ce procès est fondamental pour la justice française. Non seulement elle signifie ici que le jeu politique ne suffit plus à protéger un certain nombre de criminels. Mais elle montre en plus sa pleine capacité à juger des personnes qui ne sont pas françaises et n’ayant pas commis leurs méfaits en France. Une compétence universelle découlant des conventions internationales, qui lui permet de traduire en justice des personnes dès lors qu’elles posent ne serait-ce qu’un orteil sur le territoire. Octavien Ngenzi a été interpellé après une cavale de deux décennies alors qu’il tentait de se procurer de nouveaux papiers à Mayotte. Tito Barahira a été arrêté à Toulouse en 2013 où il vivait depuis des années dans la plus parfaite impunité.
Exacerbation des tensions ethniques
Comme toujours dans ce type d’affaires, le temps est l’ennemi de la justice. Les personnes auditionnées ne sont pas toujours précises, la mémoire leur faisant défaut. Aussi les juges d’instruction ont-ils tenu à prévenir la cour : « Les récits portés par les témoignages peuvent conserver une réelle authenticité, malgré des imprécisions ou des contradictions mineures », écrivent-ils. Comprendre : que la défense ne se fatigue pas à déstabiliser les témoins sous prétexte de quelques incohérences. Tout cela est parfaitement normal.
Les enquêteurs sont tout de même parvenus à restituer avec précision une semaine d’horreur dans la province de Karabondo, une ville de l’Est rwandais dont Tito Barahira puis Octavien Ngenzi ont été les bourgmestres successifs. Quelques mois avant que n’éclate le massacre en 1994, la localité est déjà gagnée par la bipolarisation politique et « l’exacerbation des tensions ethniques », selon un témoin. Des politiques de ségrégation apparaissent à l’école, des meurtres restent sans réponse, la population assiste à des arrestations arbitraires. La ville est sous le contrôle des forces hutu-power et les milices Interahamwe se pressent sur le territoire, attendant leur entrée en scène. Tout est en place pour que la région s’embrase.
Arcs, machettes et gourdins
Lorsque les massacres éclatent le 7 avril au matin, Octave Ngenzi sillonne les routes de sa commune, souvent accompagné de policiers municipaux. Apportant son aide aux blessés, selon les premiers témoignages ; les regroupant au même endroit en vue de les exterminer plus tard, selon les autres. Des habitants le décrivent hébété au volant de son véhicule, incapable de donner clairement des ordres pour faire arrêter les tueries. Incapable aussi de reprendre le dessus sur ses hommes. Comme abasourdi par ce qui est en train de se passer. Pas vraiment surpris non plus.
Tito Barahira, quant à lui, aurait participé directement aux attaques dès les premiers jours du massacre. En tant qu’ancien bourgmestre, sa parole est une voix qui compte. Il jouit d’une autorité certaine. Les témoignages, dont certains sont contradictoires, le décrivent successivement comme l’organisateur des tueries - il est accusé de répartir les bandes - ou comme simple spectateur passif du carnage. Une chose est sûre, Tito Barahira est bel et bien armé et se promène aux côtés des milices. Tantôt équipé d’une lance, tantôt d’une machette.
« On ne voyait plus rien »
Les témoins se font beaucoup plus précis à partir du 13 avril. Ce jour-là, ils sont nombreux à se souvenir s’être retrouvés au terrain de football autour de Barahira, leur ordonnant d’aller traquer les Tutsi à tel ou tel endroit. Les habitants savent où chercher : les Tutsi se sont entassés par centaines dans l’église de Karabondo, se croyant sous la protection de Dieu. Elles sont 3 500 personnes à avoir été recensées par l’abbé sur un petit cahier. Appâtés sur la place marché pour une soi-disant réunion sur la sécurité publique, les réfugiés seront assaillis par les miliciens en embuscade aussitôt sortis de l’église. Frappés à mort à coup de gourdins, de massues cloutées, de lances et d’arcs. Achevés au sol par des machettes après qu’une grenade a été lancée dans la foule.
La deuxième vague d’attaques sera encore plus terrible, les miliciens utilisant des armes lourdes et des mortiers contre l’église. « Certains avaient les membres arrachés, on ne voyait plus rien », confie un témoin de la scène. Des survivants se cacheront des heures durant parmi les morts, n’hésitant pas à se recouvrir des viscères des victimes, se laissant piller leurs effets personnels par les charognards. Obligés pour certains de s’enfuir dans la bananeraie toute proche en « glissant sur le sang » de leurs femmes et enfants inertes sur le sol.
Selon plusieurs témoignages, Tito Barahira se chargera lui-même de la sélection ethnique à la sortie de l’église, désignant ceux à abattre. Octavien Ngenzi, qui s’était montré plutôt attentiste jusqu’ici, est soupçonné d’avoir ordonné aux derniers survivants de sortir de l’église, juste avant que les Interahamwe ne les achèvent, incitant même la population à se joindre aux milices. Les corps seront entassés dans une fosse commune, un « trou très profond » derrière l’église. Les Tutsi blessés regroupés au centre de santé seront tués dans les jours suivants, d’autres seront pourchassés jusque dans leur domicile. Il faut « nettoyer », disait Ngenzi, sans jamais demander clairement leur mort. Ultime voile de pudeur de celui qui organise l’indicible, mais qui n’a pas le courage de le voir. Ngenzi partira en cavale.
Une magistrate fait jouer sa clause de conscience
Déjà, l’audience s’annonce rude, Barahira et Ngenzi ayant décidé de nier et de contester farouchement de nombreux témoignages. Au palais, on jure que le procès sera exemplaire. Il en va de la crédibilité de cette justice, qui aura peut-être à juger un jour quelques dictateurs passés par Paris, et dont le pouvoir politique refuse pour le moment de nous laisser entrevoir leurs crimes. Selon Libération, une magistrate a pourtant d’ores et déjà fait jouer sa clause de conscience et ne siégera pas au procès. Il s’agit d’Aurélia Devos, chef du pôle crimes contre l’humanité au parquet de Paris. Aucune raison officielle n’a été donnée à cette défection, mais il se murmure, selon Libération, que la magistrate aurait désapprouvé le duo qu’elle devait former avec un certain Philippe Courroye, avocat général, désigné pour représenter le ministère public.
Philippe Courroye a défrayé la chronique ses dernières années pour ses liens avec Nicolas Sarkozy et son rôle dans l’espionnage de deux journalistes duMonde dans l’affaire Bettencourt. Or, l’avocat de Philippe Courroye est également le défenseur de plusieurs Rwandais accusés de génocide, ainsi que des enfants de la veuve de l’ancien président du Rwanda, Juvénal Habyarimana, elle aussi visée par une plainte. Un mélange des genres que la magistrate pourrait ne pas avoir goûté.
Avec Le Point
















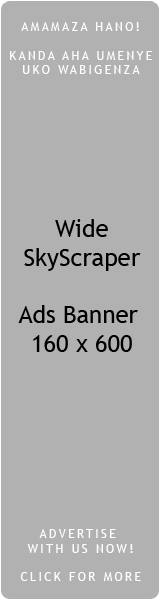
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!