
Rucibigango Jean Baptiste
Cet article s’inspire d’un album photo, intitulé Paul Kagame et la résilience d’un peuple , paru pour la première fois en France, aux Editions du Jaguar, à Paris, au 1er trimestre 2010. Il est le produit d’une fructueuse collaboration, pour les photos et les textes qui les accompagnent, de plus importantes agences de presse internationales dont on peut citer parmi elles : Jeune Afrique ; AP-SIPA Press ; RIEPA ; AKG ; Rapho-Eyedea ; Gamma-Eyedea ; AFP et Cosmos.
D’allure biographique, le livre qui, en introduction, parle de « l’histoire d’un miracle » s’étale sur trois principaux chapitres :- La libération, pp. 15-48 ; la reconstruction, pp. 49-94 et un dernier chapitre qui porte le titre de « l’homme de la renaissance », pp. 95-123. Jusqu’à ce jour, cet album n’avait connu qu’une diffusion restreinte au Rwanda et en Afrique. Au sujet du miracle, les co-auteurs écrivent ceci :
Comment, en 15 ans, un pays exsangue, ravagé, ensanglanté, pillé, au sortir d’un génocide qui fit un million de morts et presque autant de coupables jetés sur les routes d’exil, est devenu un modèle d’ordre, de sécurité et de développement pour toute l’Afrique. Comment, pendant ce même laps de temps, le PNB a triplé alors même que la population augmentait de 25%.
Comment un Etat néant s’est mué en une ruche et en un chantier permanent, où les lotissements, les nouveaux quartiers, les hôtels, les dispensaires, les écoles, les centres commerciaux, les routes, les connexions à l’internet, les champs de manioc, de haricots et de sorgho ne cessent de se multiplier sur fond de propreté, de culte de l’excellence, de respect de la discipline et de corruption quasi zéro. Comment un pays où des centaines de milliers de citoyens qui prirent part au génocide contre les Tutsi peuvent, 15ans plus tard, se permettre de vivre en toute tranquillité après avoir simplement demandé pardon aux familles de leurs victimes. Comment tout un peuple qui, de mémoire d’homme, n’a jamais connu que le malheur, a enfin appris le sens du mot espoir…
Les 5475 jours du courage et de l’effort
Les co-auteurs poursuivent, op.cit., p.7 : Ces miracles quotidiens depuis 5475 jours-depuis la libération du 4 juillet 1994- les 10 millions de Rwandais les doivent avant tout à l’un des leurs : Paul Kagame. La victoire sur le mal, la reconstruction, l’idée géniale de confier la réparation et la réconciliation à ces instances de justice et de catharsis que sont les tribunaux gacaca, c’est à lui. Tout comme émane de ce leader hors du commun la vision selon laquelle la paix est plus exigeante à gagner que la guerre et que le fatalisme est un ennemi plus formidable encore que les machettes des génocidaires.
Pour le chef de l’Etat rwandais, il n’y a plus de distinction entre Hutu et Tutsi. Et l’aide extérieure, dont son pays dépend encore pour près de 50% de son budget, est, à ses yeux, le plus grand des obstacles au développement et à l’indépendance de l’Afrique post-coloniale.
Lorsqu’il parcourt le monde à la recherche d’investisseurs ou lorsqu’il arpente son pays pour enseigner à chacun-ministre, fonctionnaire, paysan…˗ ce que sont le travail, la performance, la compétition, la solidarité, l’honnêteté, ainsi que les récompenses et les sanctions qui vont (ou ne vont pas) avec, le PDG de Rwanda Inc. continue sa lutte de libération sur d’autres voies et par d’autres moyens. Conscient qu’il s’agit là du plus bel hommage à rendre aux victimes du génocide.
Qui est Paul Kagame ?
Même si les circonstances qui ont amené ce Rwandais né en 1957 à devenir le héros de la libération de son peuple sont à proprement parler extra-ordinaires, lui-même n’aime pas être considéré comme un héros. Au contraire, il aime à se définir lui-même comme « un homme fondamentalement ordinaire, qui a su s’adapter à des conditions extraordinaires ».
Il estime, plus simplement, qu’il n’y a pas de fatalité de l’échec : « Pourquoi, ne cesse-t-il de demander, ne pourrions- nous réussir là où d’autres ont réussi ? Par quelle loi divine serions- nous condamnés à la pauvreté et au massacre mutuel ? ». Op. cit. , p.95.
Titulaire de plusieurs médailles et prix internationaux, Paul Kagame ne supporte pas, dans son propre pays, le culte de sa personnalité. Aucune rue ne porte son nom et son effigie ne figure sur aucun billet émis par la Banque Nationale du Rwanda- BNR. Et c’est à peine qu’on trouve son nom figurant sur quelques plaques commémoratives d’inauguration de l’un ou l’autre nouveau bâtiment public. Mais le Malawi lui a dédié un long boulevard.

Rencontre des présidents Madiba Mandela et Paul Kagame à la Fondation Nelson Mandela, à Johannesburg, le 20 mars 2009. Il existe une affiliation idéologique entre Madiba et Kagame. Tous deux ont lutté pour l’unité et la libération de leurs peuples respectifs, malgré les séquelles du passé, et se posent aujourd’hui en modèles pour le Continent.
Durant la première partie de son enfance, rien ne lui prédisposait un destin hors du commun. Il est né le 23 octobre 1957 dans l’ex-commune de Tambwe [Gitarama]. Il n’avait que 2 ans lorsqu’il a échappé à la mort d’extrême justesse, le 6 novembre 1959, lors du premier épisode du génocide contre les Tutsi. Les massacreurs et les incendiaires étaient parvenus sur la colline voisine de celle de son origine située dans l’actuel district de Ruhango, en province du Sud, lorsque sa famille prit la fuite vers l’Uganda, où elle connut, dans les camps de réfugiés misérables et sordides, à l’instar des dizaines de milliers d’autres familles des réfugiés, une longue existence de privations, d’oppression et d’indignités.

En novembre 1957, ce bébé que l’on baptise 7 jours après sa naissance, c’est Paul Kagame. On le voit ici dans les bras de sa marraine, elle-même à la droite de la maman de l’enfant.
Dès sa plus tendre enfance, Paul Kagame prit ainsi la mesure concrète de ce qu’étaient la misère, l’humiliation et, surtout, l’injustice. Cependant, lié d’amitié avec un jeune garçon de son âge, Fred Rwigema, il alla jusqu’au bout de ses études secondaires, dans l’une des prestigieuses écoles ugandaises, Ntare School, tout en cultivant un esprit critique, rebelle et agressif contre l’oppression sous toutes les formes, l’extrême dénuement et la discrimination dont les réfugiés tutsi étaient victimes en Uganda.
Un exemple :
En 1977, il réussit un examen qui lui ouvrait les portes de l’école supérieure de pilotage d’East African Airlines. Mais il n’a pas été retenu à cause de son statut de réfugié rwandais, alors qu’il ne s’était pas encore rendu à la dite école, portant à son comble son sentiment de révolte contre les régimes en place à Kigali et à Kampala.

Kagame, élève à Ntare School (Uganda)
Dès lors, un rêve obsessionnel s’empara de lui, pour ne plus le quitter : celui du retour au pays natal, par n’importe quel moyen. Peu à peu, la nécessité d’agir s’imposait à lui. Mais agir comment ?
L’expérience du jeune guérillero « freedom fighter »
En 1979, les exilés ugandais en Tanzanie, regroupés au sein de FRONASA, dirigé par un leader charismatique, Yoweri Kaguta Museveni, et appuyés par Feu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere et l’armée tanzanienne, firent tomber le régime négro-fasciste du Maréchal Idi Amin Dada et installèrent Milton Obote au pouvoir à Kampala. Fred Rwigema se trouvait parmi les tombeurs du régime déchu.
A la fin de cette année- là, les autorités tanzaniennes offrirent à 60 militaires ugandais un stage de formation d’officiers de renseignement. Paul Kagame, à cette occasion, se fit enrôler dans la nouvelle armée nationale ugandaise, pour se faire inscrire sur une liste où il se trouvait être le seul ressortissant rwandais au milieu de 59 Ugandais à suivre ce stage de contre-espionnage, surveillance, détection et collecte d’information qui faisait de lui, à l’âge de 22 ans, un professionnel du renseignement. Et lorsque Museveni prit le maquis contre le régime oppressif de Milton Obote, Fred Rwigema et Paul Kagame le rejoignirent.
Pour les réfugiés rwandais, Museveni était alors leur figure emblématique, « à la fois héros, protecteur et modèle du leader révolutionnaire, socialiste et panafricaniste. » Ibidem, p. 95. Celui-ci, au début de 1981, organisa un noyau actif de 40 guérilleros à Kabamba- dont 27 seulement étaient équipés de fusils, comptant 38 Ugandais et 2 jeunes volontaires rwandais, Fred Rwigema et Paul Kagame. La NRA- The National Resistance Army - était née. Son objectif politique stratégique était d’abattre la dictature sanguinaire de Milton Obote.
La première attaque fut lancée le 26 février 1981 à Kabamba Military Training Wing. Dès lors, tout au long de 5 années du maquis [« bush »], Paul Kagame allait faire du renseignement sa spécialité. Il apprendrait à observer et analyser, à marcher à pied sur des centaines de kilomètres, à vivre seul, isolé ou presque, dans les opérations de commando, durant des semaines, à souffrir de la faim et des maladies, au point de manquer de succomber à la malaria en 1983. Il acquit la connaissance pratique des principes de la guérilla et de lutte clandestine ainsi que l’expérience du champ de bataille. Op.cit., p.96.
La colonne conduite par le « Commander » Fred Rwigema s’illustra notamment dans de très durs combats à l’Ouest et Sud-Ouest d’Uganda, autour de Fort Portal, Masindi, Mubende et sur l’axe Mbarara, Masaka-Kampala et, plus tard, dans l’extrême Nord-Est, au Karamojong. Tandis que les volontaires rwandais s’illustraient ainsi dans les combats acharnés, leurs compatriotes d’inoffensifs réfugiés étaient impitoyablement, massivement massacrés, par la soldatesque et les miliciens d’UPC- parti politique d’Obote- notamment dans la région dite « du Triangle de Luwero » où des milliers des restes des cadavres des réfugiés jonchèrent la brousse pendant plusieurs années longtemps après la guerre, sans sépulture.
Personnellement, en 1996, lorsque je me suis rendu en mission à Kampala, quelqu’un m’a fait le récit de ce maudit « Triangle », je n’ai pas pu étouffer un sentiment de très lourd chagrin et j’ai fait miennes ces terribles paroles du poète martiniquais Aimé Césaire : « Que de sang dans ma mémoire ! Dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de morts. Elles ne sont pas couvertes de têtes de nénuphars […] Sur leurs rives ne sont pas étendus des pagnes de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres ! ».
Mais, en même temps que je sentais le dégoût et la haine monter en moi, une voix intérieure semblait murmurer à voix basse ces vers contradictoires de Césaire : « […] Mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine, ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n’ai que haine. » L’invocation de Césaire ne couvrait pas toute la réalité d’effroyables massacres de Luwero.
Le 26 janvier 1986, enfin, la guérilla de la NRA entra triomphalement à Kampala. Yoweri K. Museveni fut proclamé président de la république, Fred Rwigema et Paul Kagame, devenus respectivement major général et major, se virent confiés des rôles secondaires de chef adjoint de la NRA et d’officier supérieur de renseignement. Peu de temps après, Paul Kagame, à la tête d’une unité de 67 officiers de la NRA, fut envoyé en stage à Cuba, où il affina davantage encore sa connaissance de la guerre de guérilla. Il y comprit notamment l’importance de la formation idéologique et politique du guérillero et la nécessité pour celui-ci de bien comprendre pourquoi et contre qui il se bat-car les actions politique et militaire sont étroitement liées dans la guérilla – ainsi que la panoplie des combats à mener. Au total, à Cuba, il y apprit de leçons d’une révolution populaire approfondie.
Pour compléter sa formation militaire et politique, Paul Kagame, de retour de Cuba, a été envoyé aussi, par Museveni, en stage aux USA, à Fort Leavenworth, au Kansas, « une pépinière d’officiers d’Etat- major venus du monde entier, où il reçut une instruction de haut niveau. » Op.cit., p.96.
« Le Rwanda est plein, comme un verre d’eau, rempli à ras bord » [ex-président Juvénal Habyarimana]
Pendant ce temps, les Rwandais réfugiés en Uganda s’étaient organisés en un mouvement de libération réputé rassembleur- le Front Patriotique Rwandais [FPR]. Il tint son premier congrès en 1987 à Kampala, avec la participation de la plupart des délégués de la vaste Diaspora rwandaise, qui réitéra la réclamation des réfugiés au rapatriement et l’instauration d’un Etat démocratique, sans discrimination, entre autres des 8 points de son programme politique.
Du point de vue de la critique historique, il est ahurissant que le gouvernement en place à Kigali et ses forces armées n’aient senti, à cette époque, que le vent avait définitivement tourné. Le programme politique du FPR auquel on a ajouté seulement deux points reste encore, aujourd’hui, en vigueur et est d’actualité, et attire plusieurs nouveaux adhérents au Rwanda même et dans la Diaspora, qui vident les rangs des partis politiques d’opposition.
L’idéologie fondamentale du FPR s’inspirait du centralisme démocratique. Très rapidement, le FPR mit en place une structure pyramidale remarquablement cloisonnée, garantissant une sécurité maximale à ses membres et une très efficace capacité de mobilisation des masses- le programme de mobilisation des masses [PMM].
A la base, les cellules clandestines, animées par un responsable, regroupaient entre 10 et 20 membres, en moyenne, d’une même localité, village ou quartier, appelés « Inkotanyi »- combattants acharnés- ou « Abanyamuryango »- les solidaires, littéralement. Au- dessus œuvraient les comités des Secteurs, des Branches et des Régions.
Puis venaient le Comité Central [CE] et le Bureau Politique qui contrôlaient non seulement les Régions, mais aussi toutes les activités du « Front », de la base au sommet de la structure pyramidale.
A tous les échelons, les mesures de sécurité étaient draconiennes : les membres des cellules ne connaissaient, au début, que leurs camarades de cellule et le pseudonyme de l’agent de liaison de l’instance supérieure. Le code de communication entre les différentes instances changeait souvent. Chacun des membres du FPR s’abritait derrière un nom de code d’emprunt. Aucune infiltration ennemie n’était possible. La suspicion mutuelle, la discipline et la solidarité agissante, étaient de rigueur. Ce fut probablement à ce prix que le FPR put se réorganiser après sa défaite provisoire d’octobre 1990 [lire le détail ci- après] et espérer atteindre la victoire finale, le 4 juillet 1994.
Au cours de la même année 1987, l’ex- président Juvénal Habyarimana, lors d’une visite officielle qu’il effectua à Kampala, déclara, assez malencontreusement que « Le Rwanda est plein, comme un verre d’eau, rempli à ras bord », en rejetant ainsi, définitivement, le retour pacifique des réfugiés dans leur mère- patrie, dont la plupart avaient été exclus depuis 1959. En fait, par ces propos d’une ineptie totale, l’ex-président Juvénal Habyarimana ne faisait que répéter la déclaration du MRND de 1985, qui « trouvait le pays trop petit pour accueillir tous ses enfants » [sic], consacrant l’exclusion d’une partie importante du peuple rwandais de sa mère-patrie. Le Comité Central du Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement- MRND, parti unique au pouvoir de 1975 à 1991, avait décrété, en 1985, après un débat qui fut une simple formalité, puisque seules 3 voix sur des dizaines se firent discordantes, que le Rwanda, étant trop petit et pauvre, n’était pas en mesure d’accueillir ses réfugiés s’ils rentraient en masse.
Certains des membres de cet organe s’étaient également opposés, trois ans plus tôt, à l’accueil des Rwandophones d’Uganda fuyant la terreur déchaînée contre eux par le régime du président Milton Obote, son armée et ses miliciens. Devant le refus complet qui leur fut opposé à leur entrée sur le territoire rwandais, la plupart de ces Rwandophones ugandais ont préféré se suicider dans le « no man’s land » séparant les frontières des deux pays. Et leur bétail fut décimé par les animaux sauvages du parc national de l’Akagera. Une seule dérogation fut portée par le CC du MRND aux réfugiés rwandais d’Uganda : des visites symboliques furent programmées pour que quelques représentants de ces réfugiés se rendent compte des réalités du pays et, au retour, en informent leurs compagnons d’exil. Ajouter que ces mesures étaient discriminatoires ; elles ne concernaient pas les réfugiés rwandais du Burundi, d’ex-Zaïre et de Tanzanie, de loin plus nombreux.
Cinq ans plus tard, en décembre 1990, avec « Les Dix commandements des Bahutu », au début de la guerre de libération, on n’était guère plus avancé idéologiquement ; ils venaient pour rivaliser avec la stupidité de la déclaration antérieure du MRND et justifier « l’option Z » du FPR ; c’est-à-dire le déclenchement de la lutte armée. Les deux déclarations fracassantes firent le tour du monde et mobilisèrent davantage bien des partisans prêts à en découdre avec le régime d’oppression, quel que soit le prix à payer.
Au même moment, le président Museveni, sur lequel s’accentuaient les pressions, en réaction à l’influence grandissante des Rwandais enrôlés dans la NRA, finit par céder : à la fin de 1989, il releva Fred Rwigema et Paul Kagame, en particulier, de leurs fonctions au sein du commandement de la NRA. Peu après, Paul Kagame épousa une jeune fille née en exil au Burundi et vivant alors, également en exil, à Nairobi au Kenya, Jeannette Nyiramongi. Ce fut pratiquement le seul moment de répit heureux pour ce jeune couple pendant toute cette longue période, ponctuée par des luttes incessantes, âpres et difficiles, contre l’oppression et les tourments d’exil.
Le « back home » du FPR
Le 30 septembre 1990, le général Fred Rwigema et environ ses 2000 hommes arrachèrent les insignes ugandais de leurs uniformes et marchèrent en armes sur la frontière nord du Rwanda qu’ils franchirent au poste douanier de Kagitumba. Le 1er octobre 1990, selon une source d’information bien documentée, aux environs de dix heures, l’operateur de la station-radio militaire de Kagitumba, sur la pointe nord-est à 250 km de Kigali, en face de la douane ugandaise de Merama Hill, lance un signal d’alarme : « Nous sommes attaqués… ! »
Le chef d’état-major Adjoint, le colonel Laurent Serubuga, relaie le message et en réfère au secrétaire particulier du président de la république- ce dernier se trouvant à New York au Sommet de l’Enfance, en évitant le colonel Pierre-Célestin Rwagafilita, le chef d’état-major en titre. Des rumeurs de coup d’Etat circulaient souvent à la veille des voyages du président. Il fallait laisser quelqu’un de confiance sur place pour les dissuader ou, le cas échéant, les contrecarrer. C’est dans cette atmosphère de fin de règne que prit le départ la guerre de libération du Rwanda. Jusque là, selon Carl Von Clausewitz, revu par le maréchal Rommel et le général Giap, le plan d’attaque de « Fred » était parfait. L’effet de surprise semblait être presque total.
De nombreux volontaires venus de partout, surtout du Burundi, de la République Unie de Tanzanie, du Kenya et d’ex-Zaïre, rejoignirent par vagues successives, quelques fois en prenant des risque inouïs,- comme les traversées du parc national de Rurigi hanté par les fauves en Tanzanie ou des cours d’eau et des marécages du bassin méridional du fleuve Nil,- la tête de pont du FPR. Ce sont là quelques scènes des premières heures merveilleuses, exaltantes du « back home » armé des plus anciens réfugiés d’Afrique et peut-être de la planète. Mais que s’est-il passé après ?
Le 2 octobre 1990, au sommet d’une colline surplombant Kagitumba, au cours d’une courte bataille, un malheur tomba comme la foudre sur les assaillants : Fred fut tué au combat. Pour la jeune armée patriotique rebelle, ce fut un désastre. Désespérés, des centaines des combattants, harcelés par des avions de reconnaissance, les artilleurs et les tirs des hélicoptères de combat français, qui appuyaient des ex-FAR et des bataillons de la Division Spéciale Présidentielle [DSP] du maréchal Mobutu, désertèrent et se replièrent en masse vers l’Uganda et la Tanzanie, où la plupart furent mis en arrestation ou se noyèrent dans la rivière Akagera.
Voici comment le général Maurice Schmitt, chef d’état-major des armées françaises de 1987 à 1991, rappelle les circonstances de l’Opération Noroît »- la première intervention militaire française au Rwanda : début octobre 1990, le président François Mitterrand accompagné par une forte délégation, se trouvait en voyage au Moyen-Orient.
Le 4 octobre, après une nuit à Abu Dhabi, l’ensemble de la délégation est arrivé à Djeddah en Arabie Saoudite où elle fut reçue à déjeuner par le Roi Fahd. C’est peu avant ce déjeuner que Mitterrand reçut de Kigali un message d’ex-président Juvénal appelant au secours. Un Conseil de défense restreint, très bref, s’est tenu sur l’heure à Riyad, à la suite duquel l’ordre a été donné d’envoyer au plus vite des troupes françaises au Rwanda sous le prétexte de protéger les ressortissants européens ; mais en réalité de maintenir le régime d’Habyarimana.
Cf. notamment Le Monde du 18 mars 2005. C’est ainsi que, dans quelques minutes, au bout d’un voyage touristique, l’irréparable et l’extermination de la majeure partie de la population tutsi ont été, nuitamment, décidés- comme on le verra.
Dès le lendemain, le 5 octobre 1990, plus de 10.000 personnes ont été arbitrairement arrêtées et emprisonnées à Kigali, la plupart en raison de leur supposée appartenance ethnique tutsi ou parce qu’elles avaient des sympathies ou des communautés d’intérêt avec les Tutsi- les Ibyitso. Parquées dans le stade Régional de Nyamirambo, pour survivre, elles furent réduites à l’état animal, broutant le gazon ou buvant des eaux des flaques de pluie puisées dans les creux de leurs mains ou avec leurs chaussures, et pendant des mois que dura leur détention. Sans aucun approvisionnement et sous la menace des armes des ex-FAR appuyées par le contingent français. Ce n’est que par la pression de l’opinion internationale, et en particulier belge, qu’on a pu éviter ce prélude du génocide contre les Tutsi remis à plus tard.
Le FPR, à l’issue des batailles homériques, parfois au corps à corps, autour notamment de la base stratégique de Gabiro, sur l’axe routier Kabarondo-Kagitumba et dans la savane d’Umutara, venait d’essuyer une cuisante défaite militaire initiale et dut ressentir le besoin urgent d’un nouveau commandant en chef endurant et méthodique.
Quelques jours avant l’irruption du FPR au Rwanda, Paul Kagame, avait pu s’entretenir avec Fred, par téléphone, de la date d’une offensive. Sans la nouvelle de ce qui était arrivé à son ami et camarade, avec un mauvais pressentiment, précise-t-il, Paul Kagame abandonna précipitamment son stage au Kansas, le 8 octobre 1990, à la surprise générale. En transit à New York, Bruxelles, Addis Abéba et Nairobi, il dut affronter bien des périls mortels car partout, dans les grandes métropoles, des agents des services secrets du gouvernement en place à Kigali et de ceux de ses alliés objectifs pullulaient et se trouvaient en alerte maximale. Il parvint néanmoins à arriver au front juste à temps pour reprendre en main une armée rebelle passablement défaite et dispersée.
Paul Kagame, remarquable stratège et brillant diplomate
En moins de trois semaines, l’offensive du FPR avait été stoppée par des interventions étrangères,- en particulier par l’intervention française.
L’option retenue par Fred et ses principaux adjoints, les majors Peter Bayingana et Chris Bunyenyezi- attaquer en force et foncer sur la capitale Kigali- avait été une erreur stratégique, qu’il fallait corriger. A nouveau, à la surprise générale, Paul Kagame fit transférer le reste de ses troupes épuisées vers la région inhospitalière des Volcans.
Elles allaient y souffrir, en premier temps, de terribles épidémies, de la faim et du froid, avant de s’adapter au climat glacial et d’être ravitaillées par l’arrière- base sociale du FPR, et de se reconstituer en véritables unités combattantes. Au début de 1991, la nouvelle armée, renforcée par des recrues plus récentes, comptait environ 5000 guérilleros capables de se battre, éduqués et instruits idéologiquement et politiquement, comme c’était dans le vœu intime de leur chef.
C’est dans cette situation que, le 22 janvier 1991, un raid spectaculaire fut lancé avec succès sur la ville de Ruhengeri et permit de libérer tous les prisonniers politiques. Mais, entretemps, des opérations de type hit and run- frapper et se retirer rapidement, en emportant des armes et des munitions pris sur l’ennemi, s’étaient multipliées dans l’Hinterland du Nord du Rwanda, en bordure de la frontière rwando-ugandaise et provoquèrent des effets médiatiques et politiques peut-être plus importants que l’attaque sur Ruhengeri.
A Kigali, où le réveil fut brutal, les pressions et les passions extrêmes se déchaînent : l’ « Akazu »- la petite maison, selon la traduction littérale, la clique extrémiste politico-militaire du régime, prétendit se dresser, au nom de tous les Hutu, contre la tentative expansionniste des Hamites Tutsi contre les Bantous Hutu du pays et des Grands Lacs, en général, le renversement de l’Histoire, la restauration féodale-monarchiste, de la corvée forcée [« ubuhake ]et du retour de la servitude des Hutu par les Tutsi, tout en globalisant [sic].
Les ex-FAR multiplièrent par cinq leurs effectifs des recrutements et des avions cargos français déversèrent sur l’aéroport international de Kanombe des dizaines des milliers des tonnes des armes et des munitions de tous les calibres. Le conflit changea de face, il devint l’extermination totale de l’ « ethnie tutsi » [resic] et de tous ceux qui se réclamaient de l’opposition politique, démocratique, légale ou des modérés. Mais en réalité, les ex-FAR ne tenaient le terrain que grâce aux tireurs français des fameux canons de 105 mm, qui participaient directement aux combats, des pilotes des hélicoptères Puma français qui pilonnaient des colonnes des guérilleros ou manœuvraient des redoutables blindés légers de type Panhard, livrés officiellement par l’armée et le gouvernement français. L’escalade d’agression néocoloniale et impérialiste atteint le point vertigineux de non-retour. Paul Kagame comprit que le maintien de l’influence française en Afrique exigeait que Paris soutînt jusqu’au bout les extrémistes du régime.
En 1992, la rébellion contrôlait environ 5% du territoire national, incluant une vaste plantation de thé de Mulindi, dont l’Armée Patriotique Rwandaise [APR] transforma en QG. Pendant des mois, le FPR travaillant à produire sur place ses propres moyens d’auto- subsistance, les combats furent provisoirement suspendus.
Paul Kagame estimait d’ailleurs qu’une victoire militaire immédiate risquait de dégénérer en guerre civile chaotique, anormalement trop prolongée dans un petit pays déjà exsangue, sans ressources naturelles importantes, en proie aux massacres ethniques chroniques visant souvent les Tutsi, et dont le peuple globalement paraissait plus démuni encore du fait du programme d’ajustement structurel [PAS] imposé par les institutions financières internationales de Bretton Woods, alors en cours d’exécution.
Il considérait surtout, contrairement à certains de ses officiers supérieurs, dont, parmi eux, les futurs dissidents du FPR, que, si l’ennemi prétendait vouloir discuter, il ne pourrait pas se dérober. « Il ne s’agissait, concluait-il sa réflexion, ni de confiance ni de méfiance, mais d’une absolue nécessité diplomatique ».
En accord avec cette réflexion, bien des cadres politiques du FPR considéraient la tenue des pourparlers comme étant la condition pour l’établissement de la paix civile durable au Rwanda et la proclamation d’un gouvernement d’union nationale réellement démocratique. Sans négociations bilatérales, pas de reconnaissance internationale.
Et sans reconnaissance internationale, la guérilla serait renvoyée dans les épaisses forêts de bambous aux pieds des Monts Virunga, dans le froid glacial, pour y végéter pendant de longues années encore. Et si le mouvement de libération réchappait par miracle aux épidémies, aux fléaux dus à l’hypothermie ambiante dans ces lieux, et à la faim, il serait anéanti par des déchirements internes comme tant d’autres mouvements de libération, dans l’histoire, avaient été voués à la désagrégation, à l’oubli et à leur disparition définitive.
L’événement se produisit en mars 1992 et des négociations s’ouvrirent à Bruxelles, d’abord, puis à Paris, où curieusement Paul Kagame fut arrêté, puis relâché ; enfin à Arusha, en Tanzanie. Op.cit., p. 97. Le 12 juillet, le FPR accepta le principe d’un cessez-le-feu permanent et décida de se transformer, passant d’un mouvement de lutte armée à la formation d’un parti politique. Un partage du pouvoir était alors en vue. Ibidem, p. 97. Mais les radicaux de la partie gouvernementale, qui n’en voulaient surtout pas, accentuèrent leur campagne de haine, déclenchèrent de nouveaux massacres et prônèrent la « solution finale » du problème tutsi.
Au début de 1993, à la suite de massacres effroyables des pasteurs Bagogwe au Nord-Ouest du pays, le FPR rompit unilatéralement le cessez-le-feu et annonça son retrait provisoire des discussions d’Arusha, lesquelles étaient d’ailleurs en panne.
Le 8 février 1993, le haut commandement de l’APR lança une offensive forte de 8000 hommes en direction de Kigali, non pas, une nouvelle fois, pour s’emparer de la capitale, mais afin de récupérer des équipements militaires sur l’ennemi, d’étendre les zones libérées et de porter un coup décisif sur le moral des ex-FAR, avant de décider de la nouvelle stratégie à adopter. Les ex-FAR furent effectivement dispersées, mais l’artillerie française bloqua l’offensive d’APR sur les rives de la rivière Base, près de Kigali.
L’ « Opération Chimère »- nom de code- forte de 20000 hommes des troupes conjointes des ex-FAR et des troupes françaises, de février-mars 1993, a provisoirement évité la déroute totale aux ex-FAR et rendu possible l’éventualité du génocide contre les Tutsi. Selon l’ex-président Juvénal Habyarimana lui-même [cf. entretien des présidents François Mitterrand et Juvénal Habyarimana, note déclassifiée du 7 octobre 1993], l’aide de la France « a été essentielle pour empêcher une victoire militaire du FPR » à cette occasion. Selon le rapport de la commission des parlementaires français sur le Rwanda, cette énième intervention française, après Noroît et d’autres opérations inédites, constituait un cap que l’armée française « n’aurait pas dû passer » [cf. Rapport de la Mission d’information parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda, déc. 1998].
Le retrait des forces françaises du Rwanda en décembre 1993 intervient avec plus d’un an de retard, puisqu’il était censé s’effectuer dès août 1992. L’accord de cessez-le-feu de N’sele, conclu entre le FPR et le gouvernement, en mars 1991, prévoyait, déjà, le retrait français. Même le retrait des troupes françaises de décembre 1993 n’est pas complet, puisque, après cette date, plusieurs dizaines de coopérants militaires restent au Rwanda. Une note d’un service de renseignement belge du 23 décembre 1993 indique, en effet, que « plusieurs autres militaires [français, NDA] stationneraient en civil » et précise notamment qu’un groupe du 13ème RDP [Régiment de Dragons Parachutistes] continue de circuler « en tenue ». En cette fin d’année 1993, la France ne respecte donc toujours les accords de paix et continue à soutenir le régime qui est en train d’organiser le génocide contre les Tutsi.
Contre l’avis de certains de ses officiers supérieurs, qui voulaient forcer le passage à tout prix, Kagame ordonna le retrait. Il dut leur rappeler que son objectif stratégique n’était pas tellement de prendre la capitale. Et que le FPR n’avait pas déclenché la guerre de libération pour les seuls droits des Tutsi, mais pour l’ensemble de tous les citoyens, afin de vivre en paix dans un même pays démocratique.
Les accords de paix d’Arusha en trompe- l’œil
A la demande du président Museveni et des représentants de « la communauté internationale » [entendez Etats- Unis d’Amérique, Belgique, France et Nations Unies, NDA], un accord signé à Kampala consacra le retrait du FPR de ses positions conquises lors de l’offensive de février 1993, mais sans la réoccupation du terrain par les forces gouvernementales. Une Zone Démilitarisée [DMZ] fut créée entre les 2 armées belligérantes. En outre, les pourparlers de paix d’Arusha devraient reprendre. Et le 4 aout 1993, les chefs des armées ennemies signaient des accords qui laissaient espérer la fin de 3 années de guerre civile rwando-rwandaise.
Un gouvernement de transition, incluant le FPR, était créé, sur « le papier- chiffon », déclara, plus tard, l’ex-président Juvénal Habyarimana, et le principe d’une armée nationale commune arrêté. Tous les réfugiés tutsi seraient autorisés à rentrer, avec l’appui de « la communauté internationale » et, en particulier, de l’ONU. Les mentions « ethniques » discriminatoires, Hutu, Tutsi et Twa disparaîtraient des cartes d’identité. Les rebelles demeureraient en zones libérées, au Nord, jusqu’à la tenue des élections générales, après 22 mois. Entretemps, une force internationale neutre, la MINUAR, garantirait le maintien de la paix et de la sécurité pour tous les citoyens. Le colonel Théoneste Bagosora venait pourtant de claquer la porte de la salle de conférence et, répondant à Patrick Mazimpaka, chef de la délégation du FPR, qui lui demandait, dans l’ascenseur où il allait, il déclara : « A Kigali, préparer l’Apocalypse » […]. Op.cit., p.98.
Habyarimana signa, la mort dans l’âme, car l’accord était favorable au FPR et à la coalition des partis politiques alliés du FPR [MDR modéré, PL, PDI, PSR, UDPR, PDC, etc.]. A partir de là, l’histoire troublante du pays s’accélère. Le parti le plus extrémiste, la coalition pour la Défense de la République [CDR] avait été écartée de transition, sous l’insistance du FPR et des modérés, alors que la CDR constituait, en réalité, le bras armé de la partie gouvernementale, y compris l’essentiel des ex-FAR.
La CDR accusa globalement de haute trahison les partisans des Accords de paix d’Arusha, menaça publiquement d’exécution le président Habyarimana, et déclencha des émeutes particulièrement sanglants qui coûtèrent encore la vie à des centaines de Tutsi et aux partisans des partis politiques de la tendance modérée [lire supra]. En vain Paul Kagame réclama-t-il qu’une force puisse assurer la sécurité de ceux des réfugiés qui se rapatrieraient au Rwanda, pendant que la Radio- Télévisions Libre des Milles Collines [RTLM], aux mains des extrémistes continuait à brailler quotidiennement des messages appelant à l’extermination des Tutsi et des Hutu modérés, et des extrémistes Hutu achetaient des machettes et d’autres armes de génocide, notamment en Chine.
En janvier 1994, alors que les Français venaient de retirer « officiellement » leurs troupes du pays, le général Roméo Dallaire de la MINUAR découvrit, grâce à une fuite d’information, qu’une extermination systématique des Tutsi était en train de s’organiser, mais, à New York, aux Nations Unies, ses appels à l’aide, de plus en plus pressants, demeuraient sans écho. Paul Kagame le harcelait en vain : « Pourquoi ne faites-vous rien ? » Jusqu’à ce que, Dallaire ayant avoué sa complète impuissance, le chef adjoint du FPR poursuivit : « Dans ces circonstances, c’est en est fini d’Arusha. Il va bientôt falloir qu’il y ait un vainqueur et un vaincu ».
Et pendant tout ce temps, l’ex-président Juvénal Habyarimana semblait traîner les pieds en mettant en sourdine, délibérément, la mise en application effective des Accords de paix d’Arusha ; son cynisme et son étrange ambiguïté se pérennisèrent jusqu’au crash de son avion, dans la soirée fatidique du 6 avril 1994, où il fut pulvérisé dans le ciel de Kigali, selon l’expression d’une personnalité française pourtant de son entourage, et mit fin à ses jours.
La victoire contre un génocide
Avec l’assassinat d’Habyarimana, le mécanisme du génocide s’enclencha. Le surlendemain, le 8 avril 1994, à Mulindi, au QG du FPR, Paul Kagame établissait avec ses principaux commandants des unités combattantes son plan d’offensive générale pour arrêter le génocide. Et au soir du 12 avril, après avoir combattu et marché plusieurs jours en portant leurs armes et des énormes caisses de munitions sur leur dos et leur tête, les avant- gardes des trois colonnes arrivèrent conjointement aux abords de la ville de Kigali, où elles firent leur jonction avec le bataillon stationné dans le bâtiment du parlement, à Kimihurura. Pour une fois, les pressions des Occidentaux sur le commandant en chef d’APR demeuraient sans effet.
Le Mémorial national de Gisozi, près de Kigali, que l’on ne peut visiter sans être étreint par l’émotion, perpétue le souvenir de l’innocence des victimes et celui de la sauvagerie des génocidaires.
A une proche du président Bill Clinton, probablement Hillary Clinton pourtant amie personnelle de la famille Kagame, qui le pressait, au téléphone, de stopper l’offensive, Paul Kagame répondit poliment ceci :
« Madame, ils sont en train de tuer mon peuple ».
Au même moment, il envoya un télégramme au conseil de sécurité des Nations Unies, libellé dans ces termes :
« Un crime de génocide a été commis contre le peuple rwandais en présence d’une force des Nations Unies [en l’occurrence la MINUAR, NDA] et la communauté internationale n’a rien fait d’autre que de le regarder s’accomplir ».
Ainsi que je l’écrivais dans la revue Dialogue no 203 d’août- octobre 2013 :
« En avril 1994, l’armée française était présente au Rwanda dans le cadre de l’Opération Amaryllis, avec, au moins 500 hommes appartenant aux forces spéciales. Or, leur rôle, à ce moment crucial, s’est limité à la seule évacuation des ressortissants occidentaux ».
J’y faisais une autre remarque qui soulignait la totale indifférence des occidentaux envers le génocide contre les Tutsi, en écrivant ceci :
« […] un autre calcul s’impose. En plus de cas des 500 militaires français présents à Kigali à partir du 9 avril 1994, 400 paras belges menaient leur propre opération d’évacuation humanitaire de leurs compatriotes, Silverback ; les Italiens, évalués à une centaine de soldats ; s’y ajoutaient les 2400 Casques Bleus de la MINUAR et 300 Marines américains stationnés au Burundi voisin, c’est-à-dire à moins de 150 km de Kigali. Un saut de puce. »
Et je concluais : « Pendant quelques jours, près de 4000 militaires autres que des Rwandais étaient donc sur les lieux mêmes des tout premiers massacres. A eux tous-et à condition d’en avoir reçu l’ordre, ils auraient pu tuer dans l’œuf le projet génocidaire et l’empêcher de se répandre sur le pays. Au contraire, ils sont restés des témoins passifs de l’horreur ». Dialogue, op.cit., p.245.
Le 21 avril 1994, alors que les soldats Occidentaux, abandonnant les Rwandais à leur sort, évacuaient les ressortissants de leurs pays, la résolution 912 du Conseil de sécurité ordonne le retrait du général Roméo Dallaire [actuellement sénateur au Canada], qui en serait devenu un malade mental, et de l’intégralité des troupes de la MINUAR.
Dès lors, la voie de Paul Kagame et du haut commandement de l’APR était toute tracée : lancer l’offensive générale contre le génocide, défaire totalement les ex-FAR et les milices Interahamwe qui leur servent de supplétifs. Et les poursuivre jusqu’à l’entrée d’APR dans la capitale Kigali, à l’aube du 4 juillet 1994. Mais la ville dont les vaillants combattants du FPR avaient tant des fois rêvé la conquête avait perdu de tout son attrait ; elle était réduite à un immense incendie, livré aux pillards, aux charognards et aux chiens errants. Des hommes, des enfants, des femmes et des vieillards prostrés, blessés, moribonds, gisaient au milieu des ruines et des gravats, sur des trottoirs des rues et des maisons abandonnées, les yeux grands ouverts dévorés par les mouches.
Et partout l’odeur insupportable des cadavres en décomposition et l’air de désolation. Une brève cérémonie conduite par Frank Mugambage, alors commissaire politique [PC] dans l’APR, aujourd’hui ambassadeur du Rwanda à Kampala, marqua symboliquement la victoire, au principal rond- point de la ville en face de la paroisse Sainte Famille. Pour la ville, comme pour tout le reste du pays complètement délabré, il fallait tout rebâtir, tout refaire à partir de zéro et ériger une société nouvelle, meilleure, sur les décombres du passé.

Général victorieux, Paul Kagame entre dans Kigali, le 4 juillet 1994.
Encore n’était-ce là que le début de la mission que Paul Kagame s’était assignée. De longues années de combats l’attendaient encore : contre la volonté de revanche des forces génocidaires résiduelles, qui s’étaient repliées notamment dans l’actuelle RDC, mais aussi éparpillées un peu partout dans le monde ; contre aussi l’hostilité d’une « communauté internationale » [en voir les composantes, in supra, NDA] apparemment sourde et aveugle envers le drame fondamental du Rwanda et qui, parfois, impose au monde une lecture négationniste ou révisionniste du génocide.
Or, l’opinion internationale était régulièrement informée de l’éventualité du génocide [voir supra] en temps réel. Le 11 janvier 1994, soit 3 mois à l’avance, le « Génocide fax » décrivait le recensement macabre des victimes en vue de leur élimination, avec un rendement estimatif de 1000 assassinats en 20 minutes ; soit 3000 assassinats/ heure ! Faire le décompte en 100 jours…
Au total, au Rwanda, entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, 1.074.017 personnes ont été violées, torturées et assassinées de la manière la plus barbare par les nervis du Hutu Power. Les victimes sont à 93.7% Tutsi, dont 43.3% de femmes et des dizaines de milliers de bébés ou de très jeunes enfants. La quasi totalité de la population tutsi, vivant à l’intérieur des frontières du Rwanda, à l’époque, a été exterminée dans l’indifférence générale de ce qu’on appelle « communauté internationale » [voir supra]. Nano & Mitz, 10 janvier 2014. Ce qui témoigne qu’avec ce génocide, l’un des plus dévastateurs et les plus effroyables de l’Histoire, le plus rapide du xxè siècles, exécuté avec la complicité d’un membre influent de la « communauté internationale », berceau de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme- la France- est bel et bien l’annihilation de tout un peuple, voire de l’espèce humaine tout court.
Enfin, à l’intérieur du Rwanda même, pour faire prévaloir la priorité absolue des exigences d’unité et de réconciliation tout en prônant la justice distributive, pédagogique, pour tous ses concitoyens, les criminels du génocide sincèrement repentis inclus.
Jamais, en effet, on n’a vu ou entendu le président Paul Kagame, en public ou en privé, faire le marchandage sur la justice exigible, équitable envers ses compatriotes, avec ses interlocuteurs des Etats nantis ou des institutions internationales bailleurs des fonds, pour leur faire plaisir, sur le dos du martyrologe rwandais, comme le font des tas d’autres dirigeants des pays en voie de développement.
Un homme d’Etat confronté à l’urgence et à la nécessité
Reproche-t-on au chef de l’Etat Rwandais son autoritarisme ou son impatience ? Sa contre-critique invoque l’urgence et la nécessité :
« Nous sommes pauvres, dit-il, et il n’est pas bon d’être pauvre. Je pousse à la roue pour que cela change, je bouscule peut-être et si certains s’estiment choqués d’être bousculés, je réponds que rien ne choque plus gravement que la pauvreté.
Qu’importe qu’ils soient ainsi choqués s’ils se sont mis au travail, et si, de perdants qu’ils étaient, ils sont devenus, au bout du compte, des gagnants ». Op.cit., p.99.
Sans commentaire.
Sa conception sur la démocratie consensuelle, l’économie libérale et l’Aide Publique au Développement [APD]
A ceux qui critiquent sa conception d’une démocratie consensuelle à la rwandaise qui ne respecterait qu’imparfaitement les critères de démocraties occidentales, il répond qu’il n’existe pas de version « prête à porter » de la démocratie, car celle-ci ne peut être ni universelle ni seulement politique : elle doit être également économique, sociale, collective et pédagogique, et donc s’adapter aux réalités locales de chaque pays ; sa réplique est constructive et elle s’exprime en ces termes :
« Nous ne faisons pas un seul pas, dit-il, qui ne soit compris et accepté par la majeure partie des citoyens rwandais. Nous sommes constamment à l’écoute de ce qu’ils veulent et chacune de nos décisions est minutieusement expliquée, débattue et amendée, s’il le faut ». Ibidem, p.99.
S’agissant du libéralisme, Paul Kagame ne cache pas ses goûts pour l’économie libérale. Il explique que « le libéralisme, en économie, ne consiste pas à laisser les gens tels qu’ils sont, à les abandonner à eux-mêmes ». Ce terme, à son sens, tout comme le concept de démocratie [voir supra, NDA], doit être compris par rapport à son contexte. Ibidem, P.99.
En fait, son ambition va plus loin, concluent les co-auteurs de l’album, au-delà des frontières de son pays.
Le président Paul Kagame en train d’expliquer et de répondre aux interrogations de la population.
Il veut faire du Rwanda un modèle pour l’Afrique. Ses nouveaux combats- apprendre à se passer de l’aide étrangère et lancer les principes d’une « révolution verte » [« green revolution »] s’inspire du modèle indien, afin de permettre à chacun de ses concitoyens de se nourrir, d’abord,- et dépassent ainsi, largement, l’horizon des Mille Collines. En cela, il est bel et bien demeuré l’homme du refus de la fatalité.
Les résultats du Rwanda sous la présidence de Paul Kagame (2000-2013)
Pays de 11 millions d’habitants en 2013. Plus faible niveau de corruption d’Afrique-lire plus haut-, placé en tête des réformateurs par la Banque Mondiale, majorité de femmes au parlement, futur « Silicon Valley » de l’Afrique de l’Est (East African Community- EAC), classé 3ème

Devant le Médiateur de la République, Tito Rutaremara, le président Paul Kagame signe sa déclaration de patrimoine personnel.
mondial pour la créativité en cyber- organisation, et aussi 4ème mondial pour la parité, 5ème mondial pour l’absence de favoritisme au sein de l’Etat, 7ème pour la transparence de l’Etat, 11ème pour l’efficacité du marché du travail, 18ème pour le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, et 19ème mondial pour la qualité de sa police, etc. Le Rwanda est enfin aujourd’hui classé parmi les pays les plus optimistes de la planète contrairement à la France, reléguée aux dernières places, 111ème sur 117 pays, pour pessimisme record, comparativement. Source : Nano& Mitz, 24 décembre 2013. C’est concluant.
L’auteur de ce texte est un député au Parlement rwandais et chef du PSR (Parti Socialiste Rwandais).






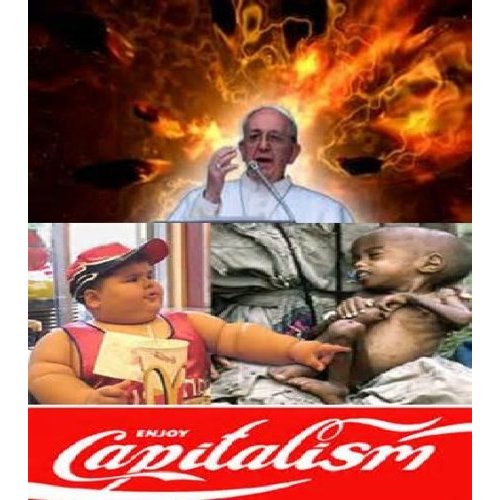






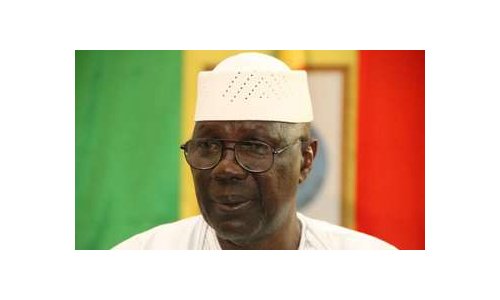



AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!