Un document, daté de 1994 et dont « Libération » publie la teneur, révèle la présence d’armes françaises dans l’arsenal rwandais et relance le débat sur les auteurs de l’attentat du 6 avril.
Une fois de plus, elle ressurgit : l’une des plus grandes énigmes de l’histoire récente n’en finit pas de se rappeler régulièrement à notre mémoire à coups de nouveaux éléments, indices oubliés, pistes négligées. Qui a tué l’ancien président rwandais Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, lors d’un attentat spectaculaire resté non revendiqué ? Depuis dix-huit ans, cette question suscite des débats passionnés. Car même si l’attentat est le déclencheur et non la cause du génocide de la minorité tutsie, programmé de longue date, l’identité des commanditaires pèse forcément sur la lecture des événements.
C’est presque par hasard, dans le cadre d’une recherche historique, que Linda Melvern, journaliste britannique, tombe sur la fameuse liste évoquant la présence de missiles Mistral, dans les archives de l’ONU. Le document avait été adjoint et noyé au milieu d’un autre rapport. Pourquoi est-ce si important ? Parce que, depuis 1994, les anciens officiers rwandais inculpés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda n’ont cessé d’affirmer qu’aucun des leurs ne pouvait être mêlé à cet attentat, car ils ne possédaient pas de missiles. Les autorités françaises, qui les ont trop longtemps soutenus, formés et équipés, ont suivi le même raisonnement : sans arme, pas de crime possible. Mais alors, que viennent faire ces Mistral dans les stocks de l’armée rwandaise ? Et qui savait ?
La liste des armes de l’armée rwandaise, dans laquelle apparaissent les missiles français, a été établie avant le génocide, puis a été oubliée durant deux décennies.
C’est une simple liste qui énumère des stocks d’armes, sans aucun commentaire. Depuis près de vingt ans, elle se trouvait dans les archives des Nations unies, à New York. Aujourd’hui, soudain exhumé de l’oubli, ce document relance quelques questions troublantes sur le rôle de la France dans l’attentat qui a coûté la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994.
Ce soir-là, l’avion présidentiel amorce sa descente sur Kigali, lorsqu’il est abattu par deux tirs de missiles sol-air. L’attentat ne sera jamais revendiqué mais, dans les heures qui suivent, une machine de mort se met en marche : le génocide perpétré contre Tutsi vient de commencer, il va durer trois mois et faire près d’un million de victimes.
C’est au nom d’une prétendue « vengeance spontanée », que les ultras du camp présidentiel vont justifier le massacre systématique des Tutsi accusés du meurtre du chef de l’Etat.
En réalité, depuis cette époque, deux camps s’opposent : ceux qui croient que Habyarimana a été assassiné par certains de ses proches, inquiets de le voir accepter de partager le pouvoir, et ceux qui pensent qu’il a été tué par le FPR, un mouvement avec lequel Habyarimana était justement pressé de faire la paix.
Or, depuis vingt ans, ceux qui accusent le FPR assènent de manière répétée que l’armée rwandaise ne disposait pas de missiles avant le génocide et ne savait pas s’en servir. Contrairement aux rebelles du FPR.
Démentis. C’est cet argument qui risque d’être mis à mal par le document exhumé des archives de l’ONU. Car la liste qui détaille les stocks d’armement à la veille du génocide révèle que l’armée rwandaise était alors en possession d’une quantité « indéterminée » de « missiles sol-air de type SA-7 » et de « 15 missiles sol-air Mistral ». Des armes d’origine française. Même si rien ne permet à ce jour d’attester que ce sont ces missiles-là qui ont servi à l’attentat, l’information est en contradiction flagrante avec les nombreux démentis et déclarations officielles qui se sont succédé depuis plusieurs années, affirmant que « le camp de Habyarimana n’avait pas de missiles », ainsi que l’a encore répété en janvier le socialiste Hubert Védrine, secrétaire général de la présidence de la République au moment du génocide. François Léotard, lui, était ministre de la Défense. Le 7 juillet 1998, lors de son audition par une mission d’information parlementaire sur le rôle joué par la France au Rwanda entre 1990 et 1994, il certifie lui aussi qu’« aucune information n’atteste la présence de lanceurs sol-air dans l’équipement des FAR [Forces armées rwandaises] entre 1991 et 1994 ».
La présence de missiles Mistral dans l’arsenal de l’armée gouvernementale avait pourtant déjà été mentionnée. Mais jamais attestée de source officielle onusienne avant que soit lancé le massacre des Tutsi. Ce sont des observateurs militaires de la Minuar, la mission d’observation de l’ONU envoyée au Rwanda quelques mois avant le génocide, qui ont compulsé la liste des stocks d’armes dans le cadre des inspections qu’ils effectuaient en attendant l’application des accords de paix. Début mai, le général Roméo Dallaire, à l’époque commandant en chef de la Minuar, a confirmé l’authenticité de cette liste qui, après inspection des stocks, a été finalement rédigée… le jour même de l’attentat.
Menace. Mais alors pourquoi l’ONU n’a-t-elle jamais fait mention de cette liste ? Très vite, le document se noie dans d’autres urgences, à une époque où l’origine des missiles n’est pas encore un enjeu. Une copie atterrit bien à New York, quelques semaines après le déclenchement du génocide. La liste est notamment transmise à la délégation américaine auprès de l’Organisation des nations unies. Ensuite, elle se trouve annexée à un autre document : une synthèse de huit pages datée du 1er septembre 1994 et intitulée : « Ancienne armée rwandaise : capacités et intentions ».
A cette date, le génocide a été arrêté. Les inquiétudes se sont déplacées : le reliquat de l’armée gouvernementale et des miliciens impliqués dans le massacre ont fui le Rwanda et se trouvent en exil dans l’ex-Zaïre (l’actuelle république démocratique du Congo). D’où ils menacent de déclencher une offensive contre le Rwanda, passé sous le contrôle du FPR.
A la quatrième page de la synthèse, des missiles en possession de l’armée rwandaise sont à nouveau évoqués, mais cette fois dans le contexte de la menace qu’ils font encore peser sur la région. Le document est transmis à Kofi Annan, alors à la tête du département des opérations de maintien de la paix des Nations unies, puis au représentant de l’ONU à Kigali. A la suite de quoi, il est enregistré dans les archives. La liste et la synthèse sont apparemment vite oubliées.
L’attentat d’avril 1994 ne fera jamais fait l’objet de la moindre enquête internationale. Il aura fallu attendre 1998 pour qu’une information judiciaire soit ouverte en France. Le juge Jean-Louis Bruguière privilégie alors la thèse des missiles appartenant au FPR et accepte d’emblée l’idée que les forces armées rwandaises n’en avaient pas. Puis, à partir de 2007, le dossier est confié aux juges Marc Trévidic et Nathalie Poux.
Contrairement à leur prédécesseur, les deux magistrats se rendent, en septembre 2010, sur le site du crash. Mais le rapport d’expertise de cette mission exclut lui aussi dès le début qu’un missile Mistral ait pu être utilisé dans l’attentat, puisque « la première commande à l’export » date de « 1996 » - avant cette année-là, la France n’était pas autorisée à exporter ces armes.
Les missiles qui figurent sur la liste de la Minuar auraient-ils alors été fournis en dépit de l’interdiction officielle ? Au nom du même raisonnement (l’interdiction d’exportation en vigueur), un « rapport d’enquête » de l’armée belge daté du 1er août 1994 écartait lui aussi par principe la piste des Mistral. Toutefois, les auteurs précisaient en conclusion que si jamais leur utilisation dans l’attentat du 6 avril 1994 était finalement avérée, une telle information « impliquerait la complicité des autorités d’une nation qui en possède ou en produit ».
Depuis longtemps, des responsables politiques, de gauche comme de droite, tentent d’occulter la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. Contrastant singulièrement avec la qualité des travaux de la commission sénatoriale belge, la mission d’information parlementaire française n’a produit qu’un vaste écran de fumée.
Plus grave encore, un magistrat en charge de l’enquête, le fameux juge Bruguière, semble avoir tout mis en œuvre pour brouiller les pistes et organiser la désinformation la plus totale, ouvrant la voie au pire négationnisme. Reprenant l’instruction, le juge Trévidic a commencé à apporter de précieux éléments, un rapport balistique établissant le rôle déclencheur de l’attentat contre l’avion du président Habyarimana. Un nouveau document de l’ONU, dont Libération révèle aujourd’hui l’existence, vient d’être versé à son dossier. Il révèle que le régime rwandais était, au jour de l’attentat, en possession de quinze missiles français Mistral, pourtant strictement interdits d’exportation. Pourquoi la France aurait-elle fourni ces armes sol-air alors que les rebelles rwandais ne disposaient pas d’avions ? Des instructeurs français se trouvaient-ils sur place pour former à leur maniement ? Quel rôle Paris a-t-il ?
Mais où était l’ex-super gendarme de l’Elysée contraint à la démission après le scandale des écoutes téléphoniques, sous Mitterrand, le jour de l’attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana ? Dans la région, reconnaît-il dans ses mémoires. Plus précisément, on ne sait pas. Il aurait dû être au côté de la victime, puisqu’il était chargé de sa protection. Etrangement, le juge Jean-Louis Bruguière ne lui a jamais posé la question. Plus tard, l’ex-gendarme a menti en prétendant avoir découvert la boîte noire de l’appareil.
Le 6 avril 1994 L’avion du président Habyarimana est abattu à proximité de Kigali. Les extrémistes du Hutu Power, et leurs adversaires du Front patriotique rwandais (FPR), mené par Paul Kagame, sont soupçonnés.
Avril-juillet 1994 le génocide, qui fera plus d’un million de morts, est perpétré par des extrémistes hutu contre des Tutsi. Planifiés depuis plus d’un an par le régime et menés par les milices « interahamwe », les massacres ont commencé après que l’avion du président Habyarimana a été abattu. La force de l’ONU n’ayant ni les moyens ni le mandat d’intervenir, le génocide se poursuit pendant une centaine de jours.
La liste révélant la présence de missiles dans les arsenaux des forces armées rwandaises à la veille du génocide se trouve désormais chez les juges Marc Trévidic et Nathalie Poux, chargés de l’instruction sur l’attentat contre le président Juvénal Habyarimana. Les avocats des personnalités rwandaises mises en examen par le juge Bruguière en 2006 l’ont versée au dossier hier. Un jour qui marquait l’expiration du délai offert à toutes les parties civiles pour commenter ou contester la fameuse expertise balistique rendue publique le 10 janvier.
Emotion. Résultat de la première enquête scientifique française réalisée sur les lieux du crash, cette expertise avait finalement conclu que le lieu du tir le plus probable se situait près d’un cimetière, à l’intérieur de l’enceinte du camp militaire de la garde présidentielle à Kanombé, non loin de l’aéroport. Ces conclusions contredisent totalement celles émises par le juge Bruguière en 2006, et qui ont suscité, en ce début d’année, une certaine émotion. Surtout chez ceux qui, comme Bruguière, ont du mal (ou peu d’intérêt) à admettre que les proches du président rwandais ont pu assassiner leur chef, soupçonné de céder au partage du pouvoir avec les rebelles tutsis.
Hier encore, à l’extrême limite du délai pour contester le rapport balistique de janvier, plusieurs avocats représentant notamment les proches des victimes (celles qui se trouvaient dans l’avion le soir de l’attentat) ont présenté des demandes de contre-expertise ou des commentaires. Premier avocat à avoir engagé cette procédure, Me Hélène Clamagirand représente les intérêts de la famille d’un membre de l’équipage français du Falcon 50. Mais cette avocate défend par ailleurs les intérêts d’un certain Paul Barril , ex-gendarme du GIGN dont le rôle dans le drame rwandais reste à déterminer : mandaté par Habyarimana pour réorganiser ses services secrets, présent au Rwanda deux jours avant l’attentat puis, aussitôt après, mandaté par la veuve du Président pour faire la lumière sur l’assassinat de son mari, avant de présenter aux médias français une fausse boîte noire…
« Enfumage ». Depuis 1994, l’affaire de l’attentat contre le président rwandais a donc donné lieu à une série de manipulations rocambolesques. De vraies fausses boîtes noires, de vrais faux missiles, retrouvés sur une colline mais mentionnés seulement deux ans après l’attentat avant de disparaître, de vrais faux témoins et des affirmations qui défient toute vraisemblance : « Les missiles, on le sait, sont de fabrication soviétique, vendus à l’Ouganda, puis fournies au FPR », croit bon d’asséner Hubert Védrine sur France Culture le 13 janvier, alors qu’il exprimait ses « doutes » sur l’expertise balistique réalisée par les juges parisiens. D’où tient-il de telles certitudes ? L’ancien fidèle de Mitterrand ne le dit pas.
En réalité, la présence de missiles français dans les stocks de l’armée rwandaise à la veille du génocide ne confirme ni ne contredit l’enquête en cours du juge Trévidic. Elle n’est qu’un élément qui incite à se poser des questions « sur l’enfumage constant de ce dossier » comme le souligne Bernard Maingain, l’avocat des officiels rwandais mis en examen. « Pour l’instant, cet enfumage est toujours venu de Paris », conclut-il.
Outre la possession de par les forces armées rwandaises, d’autres pistes demeurent encore inexplorées par la justice. Notamment des témoignages d’anciens Casques bleus qui, en avril 1994 se trouvaient incorporés au sein de la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar), dans le pays à partir d’octobre 1993 pour veiller au respect des accords de paix signés entre le régime de Habyarimana et le FPR.
Même si la hache de guerre était officiellement enterrée depuis août 1993, le partage du pouvoir et la mise en place des nouvelles institutions butaient continuellement sur les manœuvres dilatoires du camp présidentiel, peu pressé de céder ses prérogatives au FPR comme à l’opposition interne. En raison de ces reports constants, la situation était très tendue en ce début avril, marqué par des assassinats et des explosions de violences qui compliquaient la tâche de la Minuar.
Barrage. C’est dans ce contexte qu’Yves Teyssier, un para-commando belge en poste à Kigali en avril 1994, a vécu une situation singulière le 5 avril, soit vingt-quatre heures seulement avant l’attentat et le début des massacres. A l’époque, sa mission principale consiste à patrouiller autour de Kanombé, pour assurer une présence ostensible de l’ONU dans un périmètre stratégique. Car Kanombé n’est pas un endroit anodin à Kigali : c’est dans cette partie de la capitale que se trouvent la résidence du chef de l’Etat, l’aéroport, mais aussi le principal camp de la garde présidentielle. Jusqu’à cette fameuse soirée, les patrouilles auxquelles participait le sergent Teyssier s’étaient déroulées sans la moindre anicroche, malgré le climat tendu qui prévalait ailleurs en ville.
Ce soir-là, le convoi qui inspecte la zone de Kanombé se compose d’un petit camion avec neuf Casques bleus à bord et d’une Jeep. Sa patrouille est prévue pour durer deux heures, de 20 heures à 22 heures. La petite équipe se trouve déjà au niveau du camp de Kanombé quand on lui refuse l’accès aux routes à voie unique menant vers la vallée en contrebas. Un barrage a été curieusement érigé au milieu de la route, comme si on voulait dissuader toute intrusion. Les Casques bleus tentent bien de faire valoir le bien-fondé de leur mission, mais aucune discussion ne semble possible : les militaires rwandais restent intraitables.
Tranchées. A la porte principale du camp, Teyssier constate alors que des pièces d’artillerie viennent d’être installées, ainsi que des emplacements de mitrailleuses. Des soldats sont positionnés dans des tranchées fraîchement creusées. Sur le coup pourtant, les Casques bleus font demi-tour. Ils pensent peut-être avoir le temps d’analyser la situation les jours suivants.
Teyssier, pour sa part, est envoyé en mission dès le lendemain dans le nord du pays. C’est alors qu’il entend sur le réseau radio de la Minuar la voix d’un de ses collègues. Ce dernier se trouve en faction à l’aéroport de Kigali, plus précisément sur une plateforme du deuxième étage de l’ancienne tour de contrôle. Nous sommes le 6 avril et il vient de voir le premier missile manquer l’avion tandis que le second touchait sa cible, un peu en dessous de l’aile gauche. Le sergent Teyssier réalise que la situation dérape et repense à l’incident de la veille au camp Kanombé.
Si son témoignage a pu échapper jusqu’à présent aux juges Trévidic et Poux, en charge de l’enquête à Paris, son collègue de l’aéroport a été entendu par les services militaires belges dès 1994. Il affirmait alors déjà que les tirs provenaient du camp militaire de Kanombe. Bien avant que les experts des juges parisiens privilégient cette piste eux aussi.
C’est rarissime, mais il arrive que la vérité soit cachée dans les pages d’un roman de gare. A preuve, cette phrase qu’un agent de la CIA prononce dans Enquête sur un génocide, un SAS paru en 2000, et qui se déroule au Rwanda : « Les Français leur avaient donné quinze Mistral, missiles sol-air montés sur véhicule. » D’où cette question : Gérard de Villiers, le célébrissime auteur des SAS, est-il mieux informé que tous ceux qui ont travaillé sur le génocide rwandais, policiers, juges, parlementaires membres de la commission d’enquête, journalistes, etc. ? On peut le croire. Non seulement il avait connaissance de l’existence des Mistral, mais il savait aussi leur nombre à l’unité près. On devine très bien d’où peut venir une telle information quand on sait que l’auteur est très proche des services de renseignements français, en particulier du général Philippe Rondot, un vétéran de la DGSE et de la DST, aujourd’hui à la retraite. Mais si ces services connaissaient l’existence des Mistral, on peut estimer aussi que le sommet de l’Etat ne l’ignorait pas.
Source : LeFaso.net















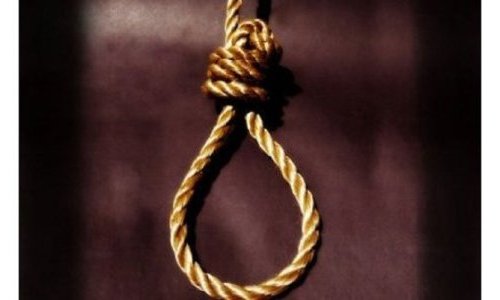

AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!