IGIHE s’est entretenu avec Laure De Vulpian, journaliste française qui vient de publier en partenariat avec un adjudant du GIGN/Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale Française, M. Prungnaud, un livre intitulé "Silence Turquoise".
Un livre qui jette un autre regard sur la sombre mission Turquoise caractérisée essentiellement par la non assistance de personnes en danger de génocide particulièrement sur le triste lieu dit BISESERO. L’auteur semble mal apprécier une démarche entreprise par les commandants de l’Opération Turquoise.
Non ! Il accuse pêle mêle différentes personnalités politiques et militaires françaises et autres pour avoir délibérément omis d’apporter leur assistance à BISESERO, une haute colline de Kibuye au Sud Ouest du Pays , aux Tutsi en grand danger de mort. L’auteur porte carrément plainte contre le silence de la Communauté internationale, un silence qui couvre comme un linceul ses crimes.
L’interview dirigée par Karirima A. Ngarambe de IGIHE est libellée comme suit :
LAURE : Journaliste depuis 30 ans à Radio France,16 ans à France Culture. Mon activité à la rédaction de France Culture touche spécifiquement aux questions de justice et de droit. C’est par ce biais-là que j’ai découvert en 2001 le génocide du Rwanda qui, bizarrement, m’avait échappé en 1994. En 2001, on m’a demandé de suivre le procès d’assises de Bruxelles (celui d’Higaniro, Ntezimana et des deux Sœurs de Sovu). Je peux donc dire que c’est le génocide qui est venu à moi par mon activité professionnelle.
IGIHE : Pourquoi le titre« silence turquoise » ?
Laure :Turquoise, c’est le nom de l’opération des troupes françaises envoyées au Rwanda entre le 23 juin et le 22 août 1994. Bien sûr, je la remets dans son contexte politique et militaire de l’époque, période marquée par la guerre civile, entre 1990 et 1993. Silence, parce que il y a toujours une chape de plomb sur ce qui s’est passé à cette période entre les deux Etats, la France et le Rwanda, et notamment au moment du génocide. Ce silence se prolonge depuis 18 ans.
IGIHE : Dans votre livre, on peut lire ‘‘les zones d’ombre’’ qui entourent le génocide des tutsi du Rwanda, c’est quoi ces zones d’ombre ?
Laure : Je voudrais d’abord préciser que ce n’est pas un livre sur le génocide, mais sur la politique de l’Etat français - ou du moins d’une partie de l’Etat français - à l’égard du Rwanda. Et « la France » d’alors, c’est le président François Mitterrand, ce sont les gouvernements successifs entre 1990 et 1994. Et là, il faut faire la distinction entre le gouvernement socialiste jusqu’au milieu de 1993 et, ensuite, le gouvernement de droite. Pendant la « cohabitation », tout le monde n’épousait pas la ligne politique du Président Mitterrand.
Quant aux zones d’ombre qui planent sur cette politique, elles tiennent en quelques questions. Pourquoi au tout début de la guerre civile, Mitterrand envoie-t-il des militaires au Rwanda ? Pourquoi maintient-il ces troupes pendant trois ans et demi ? Elles ne quittent le Rwanda qu’en décembre 1993 parce que, à ma connaissance, le FPR l’a exigé dans le cadre des Accord de Paix d’Arusha. Et en effet, à partir du 15 Décembre 1993, la France a l’autorisation de laisser sur place 24 coopérants militaires…autant qu’avant la guerre civile.
Mais cette situation soulève encore des questions.
Qu’ont fait ces 24 coopérants militaires français au Rwanda ? Peut-être ont-ils continué à conseiller l’état-major des FAR/Forces Armées Rwandaises du Gouvernement HABYARIMANA comme ils le faisaient précédemment et à assurer l’instruction de l’armée rwandaise. Et il faudrait savoir aussi pourquoi la mort de deux d’entre eux, au moment de l’attentat du 6 avril 1994 contre le président Habyarimana, n’a jamais été élucidée.
Il s’agit plus précisément de deux gendarmes et de la femme de l’un d’entre eux. Leur décès est encore un mystère. Je continue à enquêter là-dessus. Un jour ou l’autre, on finira bien par découvrir qui a bien pu les tuer et pourquoi. On dit parfois que c’est le FPR. Peut-être, mais deux d’entre eux ont été tués à la machette et, que je sache, le FPR ne tuait pas de cette manière.
Vous voyez, c’est encore une zone d’ombre. Qui avait intérêt à leur mort ? Est-ce qu’ils ont été assassinés parce que l’un d’entre eux était un spécialiste des télécommunications ? A l’endroit où vivait ce gendarme, il était en mesure d’écouter les communications provenant du CND (Conseil National pour le Développement ; dénomination qu’on donnait au Parlement rwandais d’alors, ndlr), de la caserne de la garde présidentielle à Kimihurura, de l’aéroport et du camp militaire de Kanombe. Alors, a-t-il surpris des conversations reliées à l’attentat qu’il n’aurait jamais dû entendre ? (…)
IGIHE : D’après vous, quelle était l’attitude de la France avant et pendant le génocide au Rwanda ?
Laure : La France est une grande puissance, qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a une position à maintenir. Elle a des alliés dans le monde et une bonne partie de ses alliés sont des pays africains, ou plutôt des chefs d’Etats africains qui font partie de ce qu’on appelle la Françafrique. Celle-ci recouvre l’ancien empire colonial auquel sont venus s’ajouter quelques pays dont le Rwanda justement. (…)
Pas mal de pays d’Afrique avaient signé des Accords de défense avec la France, mais pas le Rwanda qui n’avait signé que des Accords de coopération militaire, ce qui est très différent.
Donc, quand la guerre civile éclate au Rwanda, avec l’attaque du FPR depuis l’Ouganda à partir du 1er Octobre 1990, le président Habyarimana demande dès le lendemain à la France de lui venir en aide. La réponse de la France est immédiate et positive. La raison est simple : parce qu’en disant oui à Habyarimana, la France met en œuvre sa protection au bénéfice d’un de ses alliés et ainsi, elle envoie un message à tous les autres pays de son « précarré »comme on dit. (…)
Autrement dit, pour rester une grande puissance, la France a besoin d’alliés, qui vont voter pour elle à l’Assemblée générale des Nations unies et dans d’autres instances internationales. Voilà ce qui explique le soutien du président François Mitterrand au Général Habyarimana.
(…)
Dans cette phase qui précède le génocide, Mitterrand ne prend pas assez de distance avec Habyarimana. Au contraire, il continue à le soutenir, à lui envoyer des armes, des militaires qui ont pour mission de former son armée.
(…)
Face à la mort des deux gendarmes dont je vous parlais, à l’assassinat des dix casques bleus belges le 7 avril, face aux massacres, la France décide de lancer une opération spéciale baptisée Amaryllis. Un contingent de 500 hommes arrive au Rwanda dans la nuit du 8 au 9 Avril et en repart le 14. Entretemps, elle rassemble les ressortissants français et étrangers qu’elle souhaite évacuer, environ 1500 personnes je crois. Et elle s’en va. C’est-à-dire qu’elle s’en lave les mains. Elle laisse les Rwandais « se débrouiller » entre eux. En se limitant à cette seule mission d’évacuation, la France laisse de fait le génocide se commettre. Mais il faut souligner que le 14 Avril, personne ne pouvait savoir qu’on en arriverait à un million de morts trois mois plus tard.
Rétrospectivement, on n’est pas fier de voir que la France s’est retirée, à ce moment-là. Mais elle n’est pas la seule ! Les Belges aussi sont partis, comme les Italiens et les Américains qui, eux, étaient à Bujumbura. Aucun n’a rien fait alors que tous pouvaient s’allier avec la MINUAR/ Mission onusienne au Rwanda et avec le FPR qui l’avait proposé, pour s’opposer au génocide qui commençait. Il s’agit donc clairement d’une terrible faute collective.
Ensuite, à partir de la mi-juin, les dirigeants français se sentent obligés de répondre à l’indignation de l’opinion, qui vient d’être remobilisée par des reportages diffusés par la presse et à la télévision. C’est là qu’apparaît l’idée d’une opération humanitaire. Mais quelles sont les intentions réelles de la France ?
C’est le propos de notre livre. On nous a dit, à nous Français, que ce serait une opération humanitaire, et rien qu’une opération humanitaire. Les gens l’ont cru… ou pas. La presse elle aussi était partagée. Certains journaux ont exprimé des doutes. Des hommes politiques aussi ! Il y a une polémique, qui n’a pas empêché le Conseil de Sécurité de l’ONU de donner un mandat à la France. En fait, Turquoise a bien été une opération humanitaire, mais pas seulement. Elle avait un aspect politique militaire et la meilleure preuve, c’est notamment l’instauration de la zone humanitaire sûre (ZHS) à partir du 5 Juillet 1994. La zone humanitaire sûre est une portion du territoire rwandais, au Sud-Ouest du pays, qui passe quasiment sous la juridiction de l’armée française.
Mais pourquoi la France décide-t-elle de confisquer ainsi une partie du territoire rwandais ? Parce que cela va permettre d’empêcher le FPR de prendre le contrôle de tout le pays et de remporter une victoire totale. Car telle était la hantise des dirigeants français, à l’époque. Que le Rwanda ne tombe aux mains des Tutsi…. Il est là, l’objectif politique.
Enfin, pour moi, l’épisode central de Turquoise se déroule à Bisesero. Il est au cœur des plaintes déposées par des Rwandais devant le Tribunal aux armées de Paris en 2005. Il faut d’abord bien comprendre qu’au tout début de Turquoise, il n’y a que très peu de militaires effectivement présents au Rwanda. Ces précurseurs viennent ‘‘ouvrir les portes’’ : ils font des reconnaissances et du renseignement, de manière à ce que l’état-major soit en mesure de prendre les décisions stratégiques.
(…)
Le premier à découvrir Bisesero le 27 juin 1994 est le lieutenant-colonel Diego. Installé à Kibuye depuis le 25 juin, l’officier a entendu dire que des massacres se poursuivaient à Bisesero. Il veut en avoir le cœur net et emmène une petite patrouille - une douzaine d’hommes et 3 journalistes, dont Patrick de Saint Exupéry. Et effectivement, arrivés à Bisesero, les militaires français tombent sur un groupe de Tutsi qui affirme, preuves à l’appui, qu’ils sont menacés. Et en effet, ils leur montrent des cadavres, et notamment celui d’un homme qui venait d’être tué une heure plus tôt. Diego comprend alors l’impensable : le génocide se poursuit quasiment sous les yeux de l’armée française.
Matériellement dans l’incapacité d’organiser une évacuation ou une protection, l’officier rentre à Kibuye après avoir promis aux Tutsi de revenir sous quelques jours. Arrivé au camp, Diego rend compte à son supérieur (le colonel Rosier) par fax, comme d’habitude. Il souligne l’urgence de la situation. Il évoque même un risque d’extermination…ce sont ses mots. Mais mystérieusement, les responsables de Turquoise n’ordonnent aucune intervention à BISESERO. Ils pourraient sécuriser cette zone de manière passive, en empêchant les équipes de tueurs d’y aller. Mais rien ne se passe…. jusqu’au 30 juin.
Ce jour-là, le détachement GILLIER reçoit l’ordre d’aller à GISOVU, c’est-à-dire quelques kilomètres au dessus de Bisesero. L’objectif fixé aux militaires français (dont Thierry Prungnaud qui nous donne ici une information de première main), c’est de distribuer des bouteilles d’eau et des biscuits protéinés à la population hutu de Gisovu ; pas d’aller sauver des Tutsi menacés, non !
Et finalement, l’imprévu se produit. Un tutsi s’approche discrètement des militaires français. Par chance, il parle un peu français. Et il attire Thierry et quelques-uns de ses collègues dans une maison en ruines et il leur montre des cadavres. Et il dit aux militaires : « Si vous voulez, je peux vous en montrer d’autres. Mais c’est plus loin, en bas, à Bisesero ».
Les militaires se regardent, discutent un peu : « Oui, on veut bien y aller, on doit faire notre boulot, on est là pour faire des reconnaissances, on est en mission humanitaire ».
En fait, on ne leur avait pas dit exactement ce que se passait. On leur avait présenté la situation sous l’angle de la guerre civile qui avait repris, et non pas sous l’angle du génocide. On leur avait dit que les Tutsi zigouillaient les Hutu. Autrement dit que les soldats du FPR attaquaient les FAR et tuaient la population hutu.
Face à l’information inverse donnée par ce Tutsi, ils décident donc d’aller vérifier le renseignement. Après autorisation, ils descendent vers Bisesero avec leur guide tutsi. Ils sont une douzaine de militaires français. Et, effet du hasard, il y a aussi à ce moment-là des journalistes.
Arrivés à Bisesero, le petit groupe découvre l’innommable : les collines tapissées de cadavres, des survivants qui commencent à arriver, des gens qui sont dans un état terrible de délabrement physique. Ils sont usés, fatigués, blessés, malades etc. Cette petite poignée d’hommes (un officier et plusieurs sous-officiers) décide alors qu’il faut prévenir GILLIER immédiatement. Le chef du détachement arrive de Mukungu une heure plus tard, alerte son supérieur. Le Colonel Rosier arrive à son tour en hélicoptère et demande au général Lafourcade de déclencher une opération de secours.
Trois jours après la patrouille de Diego, l’armée française arrive donc à Bisesero, mais par hasard, et non intentionnellement. Si le sauvetage a lieu, le 30 juin, c’est parce qu’un Tutsi est allé tirer les militaires français par la manche en leur disant : « Venez, je vais vous montrer quelque chose ».
En France, Lafourcade et Rosier ont toujours dit que Diego n’avait jamais informé ses supérieurs de sa découverte du 27 juin et qu’il avait commis une lourde faute. Or, c’est faux. Ce mensonge servait juste à cacher l’inaction de l’armée française pendant trois jours. Or, pendant ces trois jours, mille Tutsi ont été massacrés. Mille personnes, hommes, femmes et enfants, qui avaient réussi à survivre jusque là.
A la mi-avril, il y avait 50.000 réfugiés tutsi à Bisesero. Le 27 juin, ils n’étaient plus que 2.000. Et le 30, ils n’étaient plus que 1.000. Alors à qui la faute ? C’est toute la question ! Et ce délai de trois jours, c’est African Rights qui l’a révélé en 1998. Sans cette ONG, on n’en aurait peut-être jamais rien su.
IGIHE : Parlez- moi de Thierry Prungnaud ?
Laure : Thierry Prungnaud était gendarme au GIGN, le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale. Il occupait précisément la position de tireur d’élite et il était adjudant.
En 1992, il est volontaire pour une mission d’instruction de quatre mois au Rwanda.
A la mi-juin 1994, l’état-¬major français cherche des militaires qui connaissent le Rwanda. Le patron du GIGN demande alors à Thierry de se porter volontaire. Au total, le détachement de la gendarmerie sera composé de 8 militaires : 2 du GIGN et 6 de l’EPIGN (escadron parachutiste d’intervention de la Gendarmerie nationale). Ils sont affectés pour l’opération Turquoise au COS, le Commandement des opérations spéciales. Au total dans la première phase de Turquoise, ils sont 220 hommes, ce qui est très peu !
(…)
IGIHE : Comment vous vous êtes rencontrés pour pouvoir écrire ensemble ce livre alors ?
Laure : De mon côté, je m’intéressais déjà au Rwanda depuis 2001 (précisément depuis le procès de Bruxelles). Petit à petit, j’ai découvert que la France pouvait avoir eu un rôle négatif, toxique ou problématique dans cette histoire. Avant, bizarrement, je n’en savais rien.
Au Rwanda, j’avais senti de temps en temps un peu d’animosité parce que j’étais française. Ca m’avait beaucoup étonnée… jusqu’au jour où j’ai rencontré un général français et là, j’ai compris que l’armée française avait des positions anti-Tutsi.
Un peu plus tard, lors d’un reportage en province, j’ai pris un taxi. Le chauffeur était un ancien militaire qui était allé au Rwanda. Il m’a expliqué que pour lui, cela avait été sa pire mission. Il me disait : « on s’est fait manipuler, on nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. C’était terrible. J’ai quitté l’armée peu après ». Il m’avait promis qu’il s’expliquerait, mais il ne l’a jamais fait. C’était un ancien caporal de la Légion étrangère.
Un an plus tard, en février 2005, je tombe sur un article dans un hebdomadaire, à propos du génocide. Dans un coin d’une page, il y avait un petit encadré de quelques lignes, avec les propos d’un gendarme qui disait des choses hallucinantes.
« On a nourri les tueurs, on n’a pas sauvé ceux qu’il fallait… ». Il y avait son nom. J’ai cherché son numéro de téléphone dans l’annuaire, je l’ai appelé pour lui dire que j’aimerais le rencontrer. C’était Thierry Prungnaud. Et effectivement, je l’ai interviewé. On a diffusé cet entretien sur France Culture et ce qu’il racontait était hallucinant !
« On ne nous avait pas dit que c’était un génocide, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Finalement, c’est à Bisesero que j’ai compris qu’on nous avait menti ».
Après l’interview, nous sommes restés en contact. Un jour, je lui ai dit que je partais bientôt en reportage au Rwanda. C’est à ce moment-là qu’il m’a dit qu’il rêvait d’y retourner pour retrouver ceux qu’il avait sauvés. Il se souvenait parfaitement d’une femme avec un nouveau-né à Bisesero et d’une infirmière qu’ils avaient accueillie pendant 3 semaines dans leur camp, à Karama. C’est comme cela qu’est née l’idée d’un voyage ensemble au Rwanda et de l’écriture d’un livre à notre retour. Thierry a effectivement retrouvé le bébé de 2 jours qui avait désormais 12 ans et sa maman… et l’infirmière Bernadette. C’était vraiment très fort et émouvant. C’est à ce moment-là que je lui ai raconté ce qu’il ne savait pas : que Diego était passé à Bisesero trois jours avant lui. C’est comme ça que s’est imposée aussi l’idée de mener une enquête en plus du récit de Thierry. Il a fallu chercher les documents, les exploiter, les analyser, et parallèlement, recueillir des témoignages, multiples, en France et au Rwanda. Le résultat, c’est ce livre, de 450 pages.
IGIHE : Dites – moi, la motivation d’écrire ce livre vient d’où ? C’est par profession ou par émotion de l’histoire des tutsi du Rwanda ?
Laure : En 2001, ce sont mes premiers reportages au Rwanda, mes premiers contacts avec des rescapés du génocide. Evidemment, je suis profondément touchée. Ensuite, j’ai fait un travail approfondi sur le génocide à la demande de France Culture, sur la base des archives sonores du procès de Bruxelles, auxquelles j’ai ajouté des interviews faites en France, en Belgique et au Rwanda.
(…)
La motivation, c’est aussi Bisesero, parce qu’il s’agit d’une tragédie qui n’aurait jamais dû exister. Pourquoi ces 3 jours sans rien faire ? Il y a plusieurs causes. D’abord, c’est une opération qui commence, qui n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière et qui n’a pas les moyens matériels et logistiques pour agir comme il faudrait. Et en effet, Turquoise manquait de véhicules dans les premiers jours ; Les Américains devaient les acheminer, ils ne l’ont pas fait. Il a fallu trouver une solution de rechange, ce qui a fait perdre un temps précieux. Finalement, c’est le trafiquant d’armes Victor Bout qui a été sollicité. Voilà pourquoi Diego n’a rien pu faire, lui-même, le 27 juin 1994.
Mais il y a une autre explication possible. Un auteur belge a révélé l’existence d’une opération secrète, qu’il a baptisée« opération grise. »
C’est ainsi qu’à côté de l’opération Turquoise, il y a eu cette autre opération, parallèle, secrète, très secrète, qui a consisté non pas à envoyer des militaires au Sud-ouest, mais au Nord-ouest du Rwanda. Ces soldats sont donc entrés dans le pays par Gisenyi. Apparemment, ils sont allés jusqu’à Mukamira, où se trouve un camp militaire des anciennes Forces armées rwandaises (FAR, Hutu). C’est là, semble-t-il, que des militaires et des civils français, présents clandestinement au Rwanda depuis plusieurs mois, attendaient qu’on vienne les chercher. (…)
Ils ont choisi de sauver cette poignée de militaires français et d’abandonner à leur sort les Tutsi de Bisesero.
IGIHE : Merci de nous avoir accordé votre temps.
LAURE : Merci.















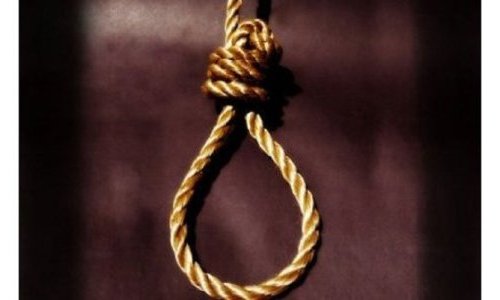

AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!