"Le corps du Rwanda a été torturé, agressé, et a succombé, mais l’esprit n’est jamais mort. Le Rwanda ne périra pas une seconde fois”, Paul Kagame (7 avril 2014)
L’acacia : un arbre providence
Ceci est l’histoire d’un arbre, une histoire vraie, une histoire d’amour, une histoire de résilience, une histoire de loyauté !
L’arbre, un acacia arabica, communément appelé barbillon, existe en plusieurs espèces en Afrique et en Australie ou il est le second arbre le plus populaire après l’eucalyptus. La graine d’acacia contient 25% plus de protéines que les céréales ordinaires. Son bois est utilisé pour fabriquer des instruments domestiques, des armes, du fuel ou des instruments de musique. Dans l’ancienne Egypte, ses feuilles étaient utilisées pour traiter des hémorroïdes. L’acacia produit du miel jaune, mais certaines espèces contiennent aussi des substances venimeuses. Dans la Sainte Bible (Livre de l’Exode), il est dit que le bois d’acacia a été utilisé pour la construction du Tabernacle.
L’acacia est omniprésent dans les régions relativement sèches du Mayaga, Nduga, Bugesera et Umutara, des régions généralement de basse altitude en comparaison avec les zones montagneuses et volcaniques du Nord et de l’Ouest du pays a climat tempéré. L’acacia est connu localement sous les noms d’Umunyinya, Umugu, Umuharata…selon les types. Dans la région naturelle du Nduga ou je suis né, la variété de cet arbre la plus communément présente est celle d’Iminyinya et ce récit relate l’histoire d’un Umunyinya, un arbre qui a eu un impact extraordinaire sur la vie de ma famille à travers le génocide contre les Tutsi.

L’Umunyinya a toujours ete un compagnon incontournable des agro-éleveurs. Il s’agit d’un arbre agro-forestier qui est propagé par le bétail qui mange ses fruits pour ensuite disperser les graines dans la bouse, ces mêmes graines pouvant germer et grandir dans un environnement relativement plus fertile que la terre aux alentours. La survie des jeunes plants reste précaire pourtant, car ils sont souvent la proie d’animaux prédateurs qui viennent se délecter des jeunes branches riches en protéine avant que les épines ne deviennent assez solides pour tenir éloignés les animaux en maraude. Même à l’âge assez avancé, les feuilles encore frêles et les jeunes branches sont dévorées par les animaux.
Les jeunes plants entrent en compétition au cours de leur croissance et il y a toujours un plant qui prend le dessus pour donner un ombrage plus large aux hommes et au bétail, dans lequel cas les autres arbres moins solides sont sacrifiés pour élargir la zone d’ombre. Il y avait un jour un tel Umunyinya, vigoureux et élancé, qui avait enduré tous les dangers de la croissance, échappé aux animaux en maraude et enduré le soleil brulant et la sècheresse prolongée. Il était devenu un arbre imposant qui donnait une ombre protectrice durant la saison sèche, et Dieu seul sait combien le soleil du Nduga peut taper fort ! L’arbre se tenait debout et observait, en témoin immobile mais attentionné, tout ce qui se passait autour de lui.
L’arbre protecteur
Pas besoin de main d’œuvre pour préparer un abri provisoire, dresser une tente pour l’occasion des festivités. Je me souviens que les jeunes du village étaient quelque peu contrariés de voir leur échapper le pot de bière qu’ils allaient partager pour la préparation des lieux. Toujours est-il que quand même mon père finissait par leur donner la bière de sorgho, non pour le travail mais surtout pour préserver sa notoriété au village et prouver son sens de responsabilité sociale.

Avec la saison sèche venaient les festivités. En 1977, mon père organisait la préparation de mon mariage ; aussi ne devait-il pas designer une équipe pour préparer l’abri traditionnel des cérémonies (Igisharagati). L’arbre était là, il fallait simplement nettoyer sous son ombre. Avant moi, il y avait eu mes grandes sœurs, et les cérémonies de la dot se passaient l à, sous l’arbre. Après moi, il y avait eu mes deux jeunes frères et ma sœur cadette et toutes les festivités se passaient là-bas, personne ne se gênait, l’arbre était là. Même les passants s’arrêtaient sous son ombre pour se reposer avant de continuer leur voyage et le vent parmi les branches leur jouait un petit air de musique au son cristallin. Parfois même ils somnolaient et se réveillaient trop tard pour continuer leur chemin et étaient obligés de demander à passer la nuit chez nous, ce qui leur était toujours accordé car on ne refusait jamais le droit de passer la nuit chez vous à un voyageur, même inconnu.
Les évènements heureux se succédaient en famille. Les naissances, les mariages, la moisson, tous autant d’occasions pour la fête sous le grand arbre qui, du haut de sa majestueuse cime garde un œil vigilant. Il protège de ses branchages touffus les cérémonies qui s’y déroulent. Il coupe les vents les plus violents, exerce une gestion parcimonieuse sur les mouvements de la brise qui ramène la fraicheur les soirs d’été. Il attenue les effets des pluies diluviennes et parvient même à retenir les gouttes les moins intenses dans son feuillage pour ne pas perturber les cérémonies.
Le jour de l’Umuganura, toute la famille se réunissait autour des parents et les vieux sages du village sont invités aussi. Chacun apportait qui un pot de bière de sorgho, qui une calebasse de vin de bananes, les chants et danses se succédaient jusqu’a la tombée de la nuit et parfois même elles se prolongeaient beaucoup plus tard, sous l’arbre autour du feu de bois. Point n’est besoin d’un autre abri, l’arbre est là qui donne un espace de confort et de sécurité à la famille rassemblée.
L’acacia majestueux est au faîte de sa gloire. Il en a vu des fêtes, le maestro. Des cérémonies locales lorsque les enfants se rassemblaient pour donner un nom au nouveau-né dans la famille (Ubunnyano) ; des fêtes religieuses de Noel ou de Pâques et même lors du baptême, de la première communion ou la confirmation des enfants à l’église locale.
La bière de sorgho coulait à flots, le meilleur hydromel était distribué avec parcimonie aux moins jeunes, mais toujours est-il que tout le monde rentrait en tanguant comme un bateau au gré des vagues, en chantant la chanson du moment mais toujours revenant à louer la généreuse libation cause d’une si bonne humeur. Mon père a toujours été fier de partager une bonne bière. Quand il n’était pas sûr de la qualité, il faisait toujours recours a ses enfants pour lui fournir une bonne bouteille de whisky importé, sinon de liqueur distillée localement pour « relever » le gout de son vin de bananes, car il n’appréciait guère qu’on dise de lui qu’il était chiche jusqu’à « allonger » son mélange d’eau et de jus qui n’arrivait plus à fermenter proprement.
Mon père était un « évolué ». Il avait été catéchiste à son jeune âge, et plus tard le chef du conseil de l’église catholique dans sa localité, ce qui lui donnait un ascendant sur son environnement. Il lui arrivait donc d’offrir à quelques privilégiés de la bière Primus, une modernité que beaucoup l’enviaient. A cette occasion, il choisissait une jeune fille introduite aux manières des blancs pour servir le premier rang des « évolués ».
Comme le veut la tradition, on ne sert pas quelqu’un sans goûter sur la boisson offerte. Il en résultait donc que la malheureuse serveuse risquait de tomber à la renverse après quelques tours de service…et de dégustation obligée sur chaque bouteille servie, à la grande rigolade des jeunes qui suivaient chacun de ses mouvements en guettant le moment où elle s’éloignait pour aller cracher la mousse qui lui montait à la gorge…
Et, du haut de ses branches entrelacées, le majestueux acacia veillait avec un sourire ironique devant la frénésie de danses traditionnelles rythmées des garçons et celles plus douces et lancinantes des filles. Car l’arbre servait également d’école de danse (Itorero), d’atelier de vannerie (Urubohero), de lieu de rencontre des sages du village après avoir abreuvé le bétail, et de commérage des femmes après les travaux des champs. C’était le lieu de rencontre privilégié ou tout le monde se retrouvait à tour de rôle, un espace de repos pour les voyageurs et surtout de rassemblement pour traire les vaches avant de les amener aux pâturages ou à leur rentrée le soir.
L’arbre, un témoin privilegié
A propos, l’arbre n’est pas tombé du ciel. Il était né de son ancêtre qui lui-même avait été coupé fin des années 1960 pour permettre à son rejeton de s’épanouir. Le vieil arbre avait lui aussi connu des jours heureux et avait accompli sa tâche pour la famille durant de longues années, des temps immémoriaux dont je ne pouvais même pas me rappeler. Ce dont je me rappelle, c’était en 1959, et on cachait dans ses branches touffues des ustensiles de cuisines, des barates et autres jarres à lait, des objets de ménage qu’on déposait la nuit dans ses branches, et le lendemain on s’empressait de fuir nos maisons en flammes. Et après des semaines, quand nous revenions dans les décombres calcinées des maisons incendiées, nous retrouvions nos biens intacts dans les branches enchevêtrées de l’acacia.
Comme l’arbre était le lieu incontournable de rencontre, il était également un centre d’observation de toute la vie au village. C’est ainsi que lorsqu’éclata le génocide contre les Tutsi en 1994, l’arbre devait servir tour à tour de lieu de réunion des tueurs planifiant leurs expéditions macabres, de délibération de la mort et du sursis, mais aussi, ironie du sort, le siège des Tribunaux Gacaca au village après l’hécatombe du génocide.
Ainsi, les tueurs devaient se rassembler là le jour où mon jeune frère Canisio était débusqué dans un champ de sorgho ou il se cachait. Il essayait de courir pour sauver sa peau quand il fut rattrapé, ramené sous l’arbre à palabre pour entendre sa sentence, frappé d’un coup sec de gourdin clouté et jeté dans un trou profond de cinq mètres qui devait faire office de latrine. Il y mourut le cou disloqué par des jets de lourdes pierres devant servir à construire la fondation de la latrine. Et l’arbre voyait tout !

Au début du génocide, mon père Mariko avait tenu longtemps dans sa maison proche de l’arbre qui l’observait avec indifférence, lorsque tout le monde prenait la fuite devant la foule menaçante des tueurs. Sa jeune épouse qu’il venait de marier [des années après le décès de ma mère] avait tenté de rester avec lui, mais il l’en avait vite dissuadé. « Pars, sauve-toi, lui avait-il dit, moi ces gens me connaissent, j’ai vécu avec eux depuis si longtemps, ils n’oseront pas me faire du mal. Je leur ai donné des vaches, je leur ai donné du lait lorsqu’ils avaient des enfants en bas âge afin que leur progéniture ne meurent pas de malnutrition. Ce sont ces enfants même qui tuent, ils n’oseront pas me tuer. Mais toi, ils n’hésiteraient pas une seconde. Alors, va-t’en, sauve-toi, ne reste pas ici ! ». Elle sera tuée au croisement des chemins, quelques centaines de mètres plus loin.
Quant à mon père, il sera amené au quartier général des tueurs où il servira de cuisinier deux mois durant. A 84 ans, il coupait le bois de chauffe, cuisait la viande de ses propres vaches, certaines en gestation éventrées devant ses yeux à son plus grand désespoir. Il faisait la salle besogne en leur lançant des invectives appuyées d’un jet de salive méprisant et les provoquait pour qu’ils l’achèvent car, selon lui, il était déjà mort. Il finit par être abattu d’un coup de hache, celle-là même qu’il utilisait pour couper du bois, quelques fois pour couper les branches les plus accessibles de l’arbre, notre acacia, qui le regardait d’un air triste plein d’empathie. Ainsi partagea-t-il la même fosse commune avec la femme enceinte et la petite fille de mon jeune frère parti peu avant eux. Mon grand frère Jerardi qui avait tenté la cavale fut rattrapé quelques kilomètres plus loin après une chasse à l’homme effrénée, il fut abattu et enterré sur le bord du chemin.
La furie du génocide contre les Tutsi fut arrêtée par l’Armée de Libération du FPR INKOTANYI le 30 juin 1994 dans ma région. Une fois le pays libéré, nous avons rassemblé les corps des membres de notre famille massacrés que nous avons pu retrouver. A l’ombre du grand arbre, nous avions enterré notre maman partie sept ans avant le génocide ; elle fut déterrée par les tueurs pendant le génocide soit disant parce que nous l’aurions enterrée avec de l’argent. Nous avons retrouvé ses ossements éparpillés et rongés par les prédateurs de toutes sortes.
Nous avons alors entrepris de les inhumer à nouveau avec les restes de mon père, mes deux frères, ma belle-sœur et sa petite fille. Plus tard, ma sœur, l’ainée de la famille, rescapée, sera aussi assassinée pour avoir été le témoin presque unique lors des procès Gacaca et rejoindra les autres où ils reposaient sous le regard attristé du grand arbre. Ce dernier s’acquittera toujours avec fatalité de son rôle séculaire de veille, fidèle à ses engagements, tel un sphinx scrutant l’horizon comme pour détecter, anticiper et prévenir le mal là où avait prévalu le bien.
L’arbre et la mort
Telle une vague qui grossit dans la mer et s’écrase sur le rivage, étendant ses tentacules sur le sable ; telle la mousson qui fait monter le lit de la rivière pour envahir la rive, ainsi l’arbre avait étendu ses branches, déployé sa verdure luxuriante et couvrait de son ombrage une aire de repos et de quiétude. Il ne sentait jamais la chaleur torride de l’été, même quand on apercevait de loin les réverbérations de la canicule sur les champs désormais débarrassés des épis secs de sorgho, quand on voyait des mini-cyclones - Serwakira - soulever des colonnes de poussière couleur d’ocre dans les champs dénudés. Alors, tout le monde se hâtait de rejoindre la fraicheur providentielle à l’ombre du grand acacia.
Hélas, l’ombre de l’arbre commence à se rétrécir, les minuscules feuilles mortes tombent inexorablement, comme si l’arbre qui a tant vécu, qui a tant vu, qui gardé autant de souvenirs d’un passé chargé d’émotions, qui a vu se succéder tant d’évènements heureux et tant de malheurs sur la même scène, cet arbre décidait simplement d’en avoir assez vu. Il est en train de mourir doucement, comme s’il y allait à contrecœur. Les colonies de plantes saprophytes qui l’avaient envahi se détachent et tombent par paquets, celles qui continuent à s’accrocher meurent en même temps que les branches porteuses et se collent à elles dans un dernier soubresaut en essayant d’en extraire la dernière goutte de sève.
L’arbre meurt doucement mais sûrement, il meurt d’avoir trop vécu. Il vient d’accomplir sa dernière mission : garder dans la fraicheur de son ombrage les tombes des miens décimés durant le génocide contre les Tutsi. Par un concours de circonstances, nous venons de déplacer ces corps pour les amener au mémorial du génocide, là où ils reposeront désormais avec leurs proches, une demi-douzaine de milliers de Tutsi massacrés à Mbuye.
Un choix difficile en somme pour nous les survivants : les laisser dans ce sanctuaire de quiétude et de recueillement sous notre arbre séculaire, [hélas souvent vandalisé par les nostalgiques du génocide] ; ou les ramener au mémorial collectif ou ils demeureront dans la convivialité qui avait toujours caractérisé leur existence. Nous nous sommes inclinés devant cette dure réalité et nous devrons désormais leur rendre hommage dans ce havre collectif de paix.
L’arbre, lui, a tranché. Il a décidé de mourir après plus d’une cinquantaine d’années de turbulences et de conflits sanglants qui avaient couté la vie à des milliers de Tutsi, ces années qui, pourtant, mutatis mutandis, avaient donné la vie et continuent à le faire encore aujourd’hui.
L’arbre, une belle leçon de la vie
La vague envahissante se retire doucement du rivage et ramène avec elle des branches d’arbres, des herbes arrachées aux dunes dénudées. La mousson se retire et ramène dans le lit de la rivière, de la mer, des éléments de la faune et de la flore précédemment submergés.
L’arbre se dessèche mais ne tombe pas. Il tient debout, encore solide, comme pour défier la mort. Son corps décharné, ses branches desséchées et mutilées par les chercheurs de bois de chauffe, ces nouveaux vandales de l’environnement, servent encore de perchoir aux corbeaux noirs, aux hiboux nocturnes, ces oiseaux de malheur selon la tradition locale. Mais aussi quelques hirondelles, symboles d’espoir d’un jour nouveau, s’y reposent dans un léger gazouillis avant de reprendre leur envol pour une destination mystérieuse, inconnue.
L’arbre n’est pas tout à fait mort, pourtant car, avant de mourir, il a semé ses graines alentour. J’ai fait combler tout le terrain ayant servi de sépulture temporaire aux membres de la famille qui venaient d’être relogés au mémorial. J’ai fait planter du gazon, des fleurs, une petite haie de buissons délimite le périmètre. J’ai gardé la grande croix peinte en blanc et portant les inscriptions des noms de ceux qui y avaient été précédemment ensevelis.
Un, deux, trois jeunes plants d’acacia ont percé timidement la terre, tiennent debout vigoureusement et grandissent gaillardement dans le sous-bois fertile nourri durant des décennies par l’arbre mourant. Parmi eux, un jeune plant plus fort que les autres, monte de la tombe même où reposait ma mère. Et j’ai décidé d’éliminer les deux plus petits plants pour garder le plus vigoureux, le petit fils de celui qui m’avait vu naître, le fils de celui qui avait gardé les années durant la mémoire, les joies et les peines, les intenses émotions, les plus lourds secrets de ma famille.
La vie va continuer, meilleure, pleine de promesses annoncées par l’arbre qui meurt mais qui nous laissent son petit comme gage de pérennité. « Ibyaye amamasa yicungura amarago », idiome intraduisible signifiant simplement que l’arbre nous aura laissé un testament, un message. L’arbre n’aura pas vécu pour rien. Il nous laisse une belle leçon de la vie.
L’auteur Wellars Gasamagera est Directeur Général de RMI (Rwanda Management Institute)







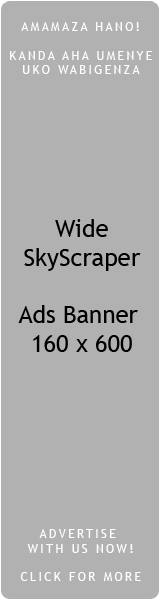
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!