La Société civile rwandaise affiche des attitudes peu combatives face à sa mission de sauvegarde des intérêts des classes sociales pauvres destinataires de ses prestations. Contrairement à la société civile d’autres pays de la région des Grands lacs, la rwandaise, selon qu’elle est née après le génocide des Tutsi de 1994 ou avant, elle adopte un profil bas. Mutisme ou bâillonnée ? Pourquoi n’assume-t-elle ses responsabilités autant qu’on l’observe chez le voisin burundais ou dans d’autres pays africains où la Société civile arrache un dialogue avec les pouvoirs publics ou le patronat après manifestations qui parfois prennent des allures de confrontation si pacifique soit-elle ?

A gauche, M. Thaddée Karekezi, Secrétaire Général de la plateforme de la Société civile
Le caractère fragile de la société rwandaise impose des choix d’actions de la société civile qui ne sont pas dictés par des nécessités de pédagogie populaire à l’apprentissage de la démocratie citoyenne.
L’effervescence de la Société civile constatée dans les pays de la région affiche des organisations de défense des droits des citoyens de différentes catégories sociales qui font un travail efficace de plaidoirie à coup de manifestations et réclamations pacifiques. Des syndicats burundais d’enseignants, d’avocats ou du secteur médical parviennent à faire entendre les revendications de leurs syndiqués sans débordement de violence. Ils parviennent à arracher leurs droits sans mort d’homme. Le cas est pourtant différent de l’Uganda où toutes les fois que des manifestations citoyennes ont eu lieu, le sang a coulé.
Méthodologies et approches différentes
« La Société civile a le choix entre deux démarches quand il est question de réclamer ses droits. Soit elle adopte la méthode de la confrontation et des manifestations ou elle privilégie le dialogue et la complémentarité. Nous, c’est cette dernière option que nous avons adoptée. Toutes les fois qu’un défi nait, aussitôt nous entrons en consultation avec les Pouvoirs publics ou le Secteur privé (le patronat). Chaque partie expose son point de vue et le dialogue commence ainsi pour arriver à un consensus.
Le gouvernement a généralement son point de vue, qu’il ne change pas immédiatement mais au fil du temps, on observe qu’il suit nos recommandations », déclare Thaddée Karekezi, Secrétaire Général de la Plateforme de la Société Civile rwandaise faite de 15 collectifs membres regroupant plus de 800 organisations locales.
Curieuse méthodologie arrêtée par la Société civile rwandaise. Il faut plutôt dire que ce choix lui est imposé par la récente triste histoire du pays. Il a été constaté de violents débordements des manifestations de rue dès l’ouverture de l’espace démocratique des années 1992 ; lesquels débordements présageaient une immaturité de la Société civile rwandaise d’alors. La société rwandaise a consommé les tristes mauvaises conséquences de ce manquement de la Société civile avec l’irruption du génocide des Tutsi de 1994 et la faillite de l’Etat rwandais.
En clair, à la conférence de la Francophonie de la Baule de 1991, le discours de Mitterrand imposant l’ouverture de l ‘espace politique des régimes dictatoriaux africains est tombé dru sur la Société civile qui a perdu l’équilibre face à l’impréparation d’un nouveau mode de gouvernance exigeant la transparence et le débat sincère sur la Chose publique. Alors qu’elle s’était réfugiée dans des œuvres caritatives et d’assistance aux classes sociales pauvres, les personnalités de la société civile rwandaise d’alors se sont découvert une peau de politicien. Et tout est devenu noir. Difficile de démêler le social du politique. La fonction pédagogique populaire de la société civile a été enterrée car les leaders d’opinion d’alors se sont rués dans les couloirs difficiles d’accès pour la prise du pouvoir grâce aux masses populaires incultes et pauvres qu’ils allaient manipuler avec la très facile idéologie ethnique faisant facilement de gros dégats dans la conscience populaire.
Sur quel pied danser ?
La société civile rwandaise actuelle ne sait plus sur quel pied danser. Entre la réclamation des droits bafoués des civils et la sensibilisation citoyenne à la prise de parole publique et à la production, elle constate que ces couloirs stratégiques pour son action sociale en profondeur sont déjà envahis et exploités à fond par les pouvoirs publics dont les agents et autres dirigeants de la base communautaire sont tenus de rendre des comptes à la haute hiérarchie administrative dans le cadre des Contrats de Performance.
« La Plateforme de la société civile rwandaise compte 15 collectifs rassemblant plus de 800 ONG locales. AMUR (Association des Musulmans du Rwanda), CCOAIB (Comité de Concertation des Organisations d’Appui aux Initiatives de Base), CGP, CPR, CESTRAR,CLADHO, Forum d’ONG sur le SIDA, IBUKA, Inteko Izirikana, IMBARAGA, Maison de la Presse, NUDOR (Associations de handicapés), PROFEMME, TIR (Transparency Int’l). Ces collectifs rassemblent plus de 800 ONG locales. »
Quelque chose a changé dans le cadre de la gouvernance locale avec l’introduction de la politique officielle de la décentralisation. Ici, l’une des missions de la Société civile étant celle de dénoncer les abus de l’autorité sur les masses populaires, on remarque que cette mission est noyée par les institutions publiques dont l’Office de l’Ombudsman ou la Commission Nationale des Droits de l’Homme tout autant que l’Office de l’Auditeur Général des Finances Publiques ou le Conseil de la Magistrature. Ces organes publics, dans leurs domaines respectifs, jouent le rôle très sérieux et à fond, de garde fou contre les possibles dérapages des personnalités publiques gérant la société rwandaise et distribuant le patrimoine public.
Acculée à l’ ‘implementation process’
« Nous de la Société civile autant que le Gouvernement avons le citoyen au centre de nos préoccupations. Logiquement, il ne devait pas y avoir des relations de confrontation entre nous deux mais plutôt nous devrions privilégier le dialogue chaque fois qu’il se constate une incompréhension dans l’ ‘implentation process’. Nous jouons le watchdog et le monitoring mais aussi l’advocacy (plaidoyer) tout en dénonçant les injustices commises sur les citoyens. Mais nous intervenons également dans le développement et amélioration des conditions de vie des citoyens. Ainsi, les sections de la Société civile rwandaise interviennent-e lles dans la distribution des génisses aux familles paysannes rwandaises. En ceci, nous jouons le rôle de complémentarité aux programmes publics existants », confie Thaddée Karekezi qui montre que les ONGs locales membres de la Plateforme de la Société civile rwandaise s’identifient dans les 15 collectifs qui forment l’ossature de ladite Plateforme.





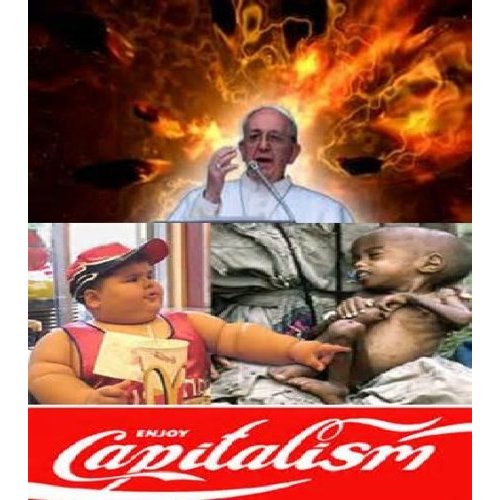






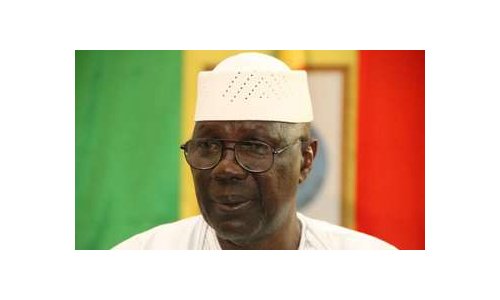



AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!