Cette ode à la Mère rwandaise est une complainte composée par le belgo rwandais Willy Fabre et présentée à la toute première fête des mères post génocide des Tutsi, le 14 mai 1995, au Centre Culturel Flamand de Bruxelles par une certaine Pitchette SAYINZOGA. Cette déclamation a fait sensation dans une salle pleine de six cents spectateurs effondrés de douleur à l’évocation du drame de génocide des Tutsi du Rwanda qui venait à peine d’être stoppé par l’Armée Patriotique Rwandaise.
L’Ode
Grâce à cette lettre, mère, par le biais de ce subterfuge, je voudrais pouvoir reprendre courage en te parlant, en passant un moment avec toi afin de retrouver ce courage qui me manque tant pour l’instant. Et, s’il me manque tant, c’est surtout parce que celle qui me redonnait du courage n’est plus depuis bientôt un an.
Oui, mère, il y a un an tu me quittais dans un carnage que je ne revivrai sans doute jamais, mais qui, par contre, restera définitivement marqué au fond de mon être telle une empreinte horrible, douloureuse et indélébile. Oui, mère, tu étais celle qui me redonnait régulièrement le courage nécessaire, indispensable même à chaque être équilibré, ou qui se considère comme tel.
D’un regard, d’un seul, d’une petite grimace de ta bouche, d’un petit clin de l’oeil, ou tout simplement d’un très bref haussement de tes sourcils à peine visible, une petite complicité imperceptible s’établissait immédiatement entre nous, tel un fil, telle une ligne de haute tension, tel un cordon ombilical : tu me redonnais des forces, de l’énergie car tu en avais à satiété.
Ainsi par ce cordon, tu me passais déjà ta force et ta sagesse. Et j’attendais que tu puisses me passer, un jour, quand je serais femme, ta beauté et toute la patience et l’art qu’il faut pour la garder, pour l’entretenir.
Ta force, mère, celle que tu domestiquais par la sagesse, tu m’en as passée les rudiments, les éléments de base mais j’ai parfois la douloureuse impression d’être une apprentie sorcière, qu’il me manque quelque chose, ou que d’un geste, d’une parole je puisse anéantir le résultat de tout un long et patient labeur.
De fait, la force et le courage, c’est ce que tu me passais depuis que je peux courir de mes propres jambes, donc depuis plus de dix ans, déjà. La sagesse, c’est ce que lentement, depuis cinq ans, tu me distillais, au compte-gouttes, sans jamais t’énerver. Tu étais la sagesse même, mère.
Et cette sagesse, ton départ précipité, tu ne m’en as passée qu’une partie, et le complément me manque terriblement.
Tu es partie, mère, dans un éclair, dans un éclair de violence, dans un éclair de haine, dans un éclair de honte. Tu es partie sans un mot, sans un murmure face à tes bourreaux. Mes trois petites soeurs ont bien lâché une petite plainte, infime, un souffle non maîtrisable.
Mon frère a lui lâché un cri, il t’a appelé car il te quittait sans pouvoir te dire au revoir, sans même pouvoir te voir une fois encore. Mon petit frère, tu m’as fait mal, tu sais, et je n’oublierai jamais le son aigu et plaintif de ta petite voix d’enfant. Tu étais le cadet de la famille et tu venais à peine de fêter tes trois ans.
Quant à toi, mon père, tu avais bien essayé de temporiser, de reporter l’échéance fatale de nous tous, tu essayais même, les connaissant très bien, de les soudoyer mais rien n’y fit et ta dernière phrase restera gravée dans mes tripes : Vive le Mwami.
Pourquoi, père, une telle phrase, un tel mot qui n’apparaissait jamais dans nos longues conversations lors de nos veillées familiales. Ce fut certainement une sorte de vengeance, tu leur faisais payer le prix de ta mort à ta manière, en y ajoutant le grain de provocation, d’ironie, complètement gratuite en ce moment de délire suprême, dans ce carnage auquel tu as dû participer sans rien pouvoir faire, impuissant devant la terreur.
Et, après ta mort, votre mort à tous, je suis restée seule, seule parmi vos quatre bourreaux qui se sont ensuite un peu repus de bière d’abord, de chanvre ensuite et de mon jeune corps innocent pour clôture.
Tu m’avais appris, mère, les soins que je devais apporter à mon corps, pour moi-même d’abord, que je dois me connaître, m’aimer avant de pouvoir connaître, comprendre et, enfin, aimer les autres un jour à mon tour. Avant donc de pouvoir un jour aimer un homme, m’offrir à lui en l’épousant. Avant de pouvoir créer une famille, avant d’offrir des enfants à l’homme auquel je lierais ma vie.
Cet homme, ce futur époux, n’était pas encore connu de vous et vous hésitiez d’ailleurs, père et mère, si vous alliez encore perpétuer la tradition en me choisissant un mari ou si vous alliez me laisser libre d’un choix.
Nous avions finalement convenu, lors d’une de nos très longues soirées heureuses comme nous en connaissions tant, près du feu, à l’extérieur, parmi les étoiles claires, le crépitement du bois et le délicat chant des grillons à la tombée de la nuit que vous me proposeriez un candidat au mariage et que je pourrais décider en final. Que donc le choix ultime me revenait. Et nous étions satisfaits de cette solution.
Mère, après ce qui s’est passé, je doute que je puisse encore aimer un jour, un homme. Je doute que je puisse m’offrir à un être aimé. J’ai peur mère, de ne pouvoir réaliser ce but que nous nous étions fixées ensemble. Ce corps, mère, le mien, que je soignais, que j’habillais, coiffais, avec patience, avec plaisir, pour le jour suprême, tout cela a volé en éclats le jour où ces quatre hommes qui vous ont d’abord horriblement mutilés avant de vous assassiner, ces quatre hommes m’ont ensuite fait subir la honte d’être une jeune femme fraîche et désirable.
J’ai dû les subir, sans rien dire, en pleurant. Et à présent j’ai un enfant de cette horrible nuit. Cet enfant, mère, j’avais appris, pendant toute mon adolescence comment le langer, comment le soigner car tu m’avais appris ces soins avec mes plus jeunes soeurs et mon jeune frère.
J’ai dû, mère, sans tes conseils, sans ta présence, donner le sein à cet enfant que j’ai mis au monde. Un garçon, mère, que j’ai appelé WIRIRA, en souvenir de vous tous, de ma famille, disparue un jour de juin, le 20 avril 1994, à Butare, peu avant l’arrivée du F.P.R.
Et j’ai accouché, mère, ce 25 janvier 1995, de ce fils de l’un de vos assassins, ceux qui se sont enfuis comme des lâches, telles des hyènes vers la forêt de Nyungwe, devenue ensuite la zone Turquoise, protégés par les Français à l’occasion de leur soi-disant opération humanitaire qui n’a trompé personne.
Et j’ai accouché, mère, comme tu me l’avais appris, sans un cri, sans un mot, dans la dignité.
J’étais l’aînée de cinq enfants et vous étiez encore jeunes, chers parents. Vous étiez exigeants avec moi et ce long apprentissage avec vous m’a servi depuis que vous m’avez quittée. J’ai pu avec patience, continuer à soigner ce corps, déchiré par cette nuit honteuse et horrible, par ces quatre bêtes humaines en furie.
Je continue à me lever avant le lever du soleil pour balayer, pendant que la maisonnée dort encore, la poussière et les feuilles tombées la nuit sur la courette. C’était ma tâche lorsque vous étiez encore là et je continue en me souvenant de vous, chaque matin.
Pendant que les oiseaux s’essaient à leurs premiers sifflements, qu’ils se réveillent les uns les autres, lentement, je balaie lentement aussi, courbée, et je pleure sur mon sort, sur ma solitude, sur ma famille disparue à jamais, pendant que les premiers rayons de soleil apparaissent un à un.
Et, dès que la lumière nouvelle est présente, que les diamants qui scintillaient dans le ciel bleu ont laissés la place au ravissant nouveau soleil, j’essuie mes larmes avec mon pagne et je range le balai, le même que j’employais déjà il y a un an.
Tu sais, mère, ta plus jeune sœur, Cécile, qui avait fui il y a plus de vingt ans vers l’Ouganda est revenue ici avec ses trois enfants et son mari, tandis que ton frère aîné, Emile, qui était descendu à Bujumbura depuis 1973 s’est également installé ici avec ses neuf enfants : après vingt ans, tu peux t’imaginer la joie immense générée par ces retrouvailles. Mais cela ne compense pas, tu ne t’en doutes certainement pas, votre disparition à tous, ma famille.
La maisonnée une fois en ordre, mère, je nourris ensuite ce fils, au sein, et il me fait mal. Il me mord goulûment les tétons, tellement fragiles et je pleure en début de chaque tétée.
Mère, tu devrais voir mes seins comme ils sont beaux, bien pleins, bien faits, avec des gouttelettes de lait telles de petites perles fines autour des tétons : tu serais fière de ta fille, tu sais. Mais tu n’es plus là pour me dire comment faire et je pense à toi, pendant qu’il tête. Mère, j’ai tellement de lait que je pourrais en nourrir deux en même temps, tu t’imagines.
A propos du splendide pagne que vous m’aviez offert pour mes 16 ans, et que je portais d’ailleurs ce satané jour, après l’horreur que nous avons tous douloureusement vécue, je n’ai plus pu le porter et je l’avais donc rangé dans le fond de l’armoire.
Mais sa vue seule me rappelait cette fin horrible et j’ai fini par le brûler un soir, sur le feu qui s’endormait lentement, après que toute la maisonnée soit allée se reposer. Et j’ai pleuré devant ce pagne qui se consumait lentement car je vous revoyais dans la fumée qui montait lentement vers la lune.
D’autre part, j’ignore ce que je dois faire ; et c’est d’ailleurs surtout pour le problème qui suit, et qui me tracasse, que je t’écris. Beaucoup de jeunes femmes, ici, autour de moi, sont allées déposer leur enfant, leur seul enfant, auprès d’organisations caritatives, ou du moins dénommées comme telles.
Sans toutefois que ces enfants ne soient considérés par la suite comme des orphelins : c’est la seule promesse qui leur fut faite. J’ai essayé, quant à moi, d’assumer, d’être responsable, de gérer ma vie, là où vous aviez vécu, heureux.
Et j’essaie d’entretenir cette maison, ce champ de patates douces et les haricots qui poussent parmi nos bananiers. Une fois, par semaine, seule, je cuis des patates douces sur la braise, le soir, pendant que l’air s’embaume et je déguste un verre de lait caillé. Que c’était bon de manger cela ensemble, mère.
Quelle chaleur, quel amour, quel plaisir. Oui, nous étions très heureux, ensemble. Par contre, mère, nos avocats n’avaient pas le même goût en février : ils n’étaient plus aussi onctueux. J’ignore pourquoi. Peut-être parce que j’étais enceinte à l’époque ? Je veux le croire.
Je crois, mère, pouvoir m’en sortir : la vie de tous les jours, tu me l’avais apprise et je crois bien tenir la barre. La nouveauté, c’est bien sûr cette présence supplémentaire que représente WIRIRA et à laquelle je me fais car, de fait, il m’oblige à rester vigilante, active, de bonne humeur et je ne désire, à aucun prix, montrer à l’extérieur, même aux voisins, les soucis passagers qui me traversent l’esprit de temps en temps.
Mais, mère, je ne sais pas si je pourrai, un jour, fonder un foyer avec un homme qui m’aimera : j’ai la désagréable impression de lui offrir un corps de seconde main alors que tu m’avais toujours appris à protéger, à soigner ce corps que je ne pourrais donner, pur et sans tache, qu’une seule fois. Et cela, je ne puis m’y faire, pas encore, un an après votre disparition brutale.
Je crois pourtant que, petit à petit, buhoro buhoro, je prendrai la vie comme elle vient, et non comme nous avions crû qu’elle vienne. Cela c’est ta sagesse, mère, qui reprend le dessus. La force, oui mère, je l’ai, je la maîtrise, je la contrôle bien. Mais c’est surtout, toi, cette beauté qui me manque et le culte de la beauté de mon corps que je ne puis appliquer, mettre en valeur ; pour l’instant.
Par contre, je vois, lentement autour de moi, d’autres jeunes filles, un peu plus âgées que moi, qui sont également devenues mères suite aux viols des génocidaires, refaire leur vie et créer une famille.
L’espoir est donc là : mère, par l’exemple des autres, je le crois, je le veux, je dois pouvoir réussir là aussi.
J’aurais aimé, mère, que tu puisses être fière de moi et je continue à oeuvrer dans ce sens, pour moi, pour toi, pour père, pour mon frère et pour mes soeurs : je vis pour vous, à travers vous.
Je suis votre revanche sur la vie, sur l’honneur, sur l’histoire et je désire mériter votre confiance, toute muette, toute discrète qu’elle soit. Je désire, et c’est le seul désir pour l’instant, que vous puissiez être fiers de moi.
Mère, je t’aime mais tu me manques quand même beaucoup.
Et je pleure en te disant : NDAGUKUMBUYE
















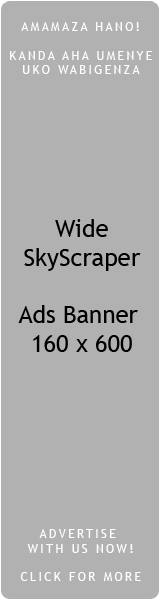
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!