Au grand dam de quelques esprits chagrins, il est désormais admis que la bonne gouvernance, la mise en place d’agences administratives efficaces, le développement des infrastructures, les investissements prioritaires et la lutte contre la gabegie et la corruption expliquent le miracle économique rwandais.
Les autorités rwandaises ne pouvant être sérieusement critiquées à ce propos, c’est sur le plan politique que les critiques allaient se focaliser : absence de jeu démocratique véritable, opposition muselée et violations des droits de l’homme.
Alimentées par quatre ONG internationales occidentales spécialisées en la matière, FIDH, RSF, AMNESTY INTERNATIONAL et, last but not least, HRW, les accusations ont été systématiquement relayées par les nostalgiques de l’ancien régime, et par des Cassandre insomniaques annonçant depuis 25 ans que le pire est imminent.
Ce n’est pas l’objet de cette étude de revenir sur le caractère partisan, peu étayé et obsessionnel de ces accusations. Cela a été remarquablement établi par Richard Johnson dans son ouvrage, The Travesty of Human Rights Watch on Rwanda.
Mon propos consistera dans une réflexion sur la pertinence épistémologique de cette critique. Au fond, ma question est la suivante : peut-on valablement juger une politique à partir du seul prisme du respect des libertés publiques : liberté d’opinion et d’expression, liberté d’association, liberté de la presse, liberté de critiquer le pouvoir politique, existence d’un pluralisme politique ?
Derrière cette question se profile une seconde, en l’occurrence celle de la légitimité de l’Occident — après avoir voulu “civiliser” par le mépris et l’exploitation les peuples colonisés — à prétendre désormais démocratiser l’Afrique. N’y-a-t-il pas dans cette prétention quelque chose de malvenu et d’exorbitant au regard du bilan que l’on peut tirer de la première expérience ?
On pourrait dire en quelque sorte que la première question a valeur épistémologique et que la seconde a valeur morale.
Le meilleur régime politique
D’Aristote à Rousseau, la question fondamentale de la philosophie politique aura été celle du meilleur régime politique entendue comme celle de la légitimité de l’exercice du pouvoir : qui a le meilleur droit d’exercer la souvenaineté ?
A cette question, il sera répondu, au XVIIIe siècle, que ce droit revient au peuple. Dans Du contrat social, Rousseau célèbrera ce principe de la souveraineté de la volonté générale : « La volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun. »
Le meilleur régime politique est donc celui de la démocratie qui repose sur l’autonomie de la volonté du peuple à savoir que les hommes se donnent à eux-mêmes les lois qui les gouvernent, et l’égalité des conditions, c’est-à-dire l’égale dignité de tous les individus.
Il reviendra à la Révolution d’indépendance américaine et à la Révolution française de mettre ces principes en application. Il faudra cependant encore de longues luttes de revendication pour que la concrétisation du principe de l’égalité des conditions se réalise véritablement, sans qu’elle soit accomplie aujourd’hui, loin s’en faut.
Bien entendu, il y a de nombreux dispositifs démocratiques possibles selon la manière dont l’on combine les trois modèles-types que sont les modèles représentatif, participatif et délibératif.
Une société juste
La question essentielle du meilleur régime politique ayant été résolue, la philosophie politique s’est trouvée confrontée à une nouvelle question tout aussi fondamentale : qu’est ce qu’une société juste ?
Cette nouvelle question était, en quelque sorte, déjà contenue dans la réponse de Rousseau qui affirmait que la volonté générale devait viser le bien commun.
L’ouvrage de référence en la matière est indiscutablement celui de John Rawls, A Theory of Justice (Théorie de la justice).
L’ambition des théories de la justice consiste, pour le dire simplement, à tenter de concilier du mieux possible la liberté de chacun et l’égalité des êtres humains, la tolérance à l’égard des choix individuels raisonnables et la solidarité entre les individus, les intérêts particuliers et le bien commun, les droits individuels et la vie collective.
Toutefois, pour Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998, il ne faut pas poser la question, par trop théorique, de Qu’est-ce qu’une société une société juste ?, mais bien la question pratique de Quelles sont les mesures concrètes qui rendront une société plus juste ?
Dans son livre The Idea of Justice (L’idée de justice), Amartya Sen répond à cette question en disant qu’il faut l’aborder en termes d’accès aux capacités/capabilités (capabilities) de base : capacité de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner, de s’éduquer, de se déplacer, etc.
Pour lui, l’injustice c’est donc le non-accès à ces capacités de base pour certains membres de la société, alors qu’il serait possible de le leur permettre.
Je souscris personnellement à cette approche concrète qui prend pour critère la qualité de vie réelle de l’individu.
Outre la nécessité d’assurer la sécurité et la protection de ses citoyens, il me paraît que la première tâche de l’État est de leur assurer l’accès à ces droits élémentaires que sont les capacités de base.
La mise en œuvre de ces droits élémentaires est à mon sens un préalable à l’exercice réel des libertés publiques. Cela ne veut évidemment pas dire que ces dernières seraient secondaires, mais il me semble qu’il n’est pas d’un grand intérêt d’en bénéficier si l’on n’a pas de toit, pas de vêtements, rien à se mettre sous la dent et pas la possibilité de se faire soigner.
Quelques brèves considérations d’économique politique
Une réponse à la nouvelle question de la philosophie politique, dans sa version pratique, Quelles sont les mesures concrètes qui rendront une société plus juste ?, suppose un bref détour par l’économie politique.
La quatrième partie du livre de Thomas Piketty Le capital au XXIe siècle, « Réguler le capital au XXIe siècle » s’ouvre par un chapitre intitulé « Un État social pour le XXIe siècle ».
Dans ce chapitre, Piketty expose quelques considérations essentielles pour notre réflexion.
1. « Tous les pays riches, sans exception, sont passés au cours du XXe siècle d’un équilibre où ils consacrent moins d’un dixième de leur revenu national aux impôts et aux dépenses communes, à un nouvel équilibre où ils en consacrent durablement entre un tiers et la moitié. » (p.760)
2. « La hausse de la part des prélèvements dans les richesses produites a permis à la puissance publique de prendre en charge des missions sociales de plus en plus importantes, représentant entre un quart et un tiers du revenu national suivant les pays, que l’on peut décomposer en première approximation en deux moitiés de taille comparable. Il s’agit d’une part des dépenses publiques d’éducation et de santé, et d’autre part des revenus de remplacement et de transfert. » (p.761-762)
3. « La redistribution moderne ne consiste pas à transférer des richesses des riches vers les pauvres, ou tout du moins pas d’une façon aussi explicite. Elle consiste à financer des services publics et des revenus de remplacement plus ou moins égaux pour tous, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé et des retraites […] La redistribution moderne est construite autour d’une logique de droits et d’un principe d’égalité d’accès à un certain nombre de biens jugés fondamentaux. » (p.766)
Bref, les revenus de l’imposition doivent se situer entre 30 % et 50 % du revenu national, ils doivent être réellement prélevés, ce qui suppose une administration fiscale efficace, et ils doivent être véritablement affectés à des politiques qui ont pour objectif premier l’accès de tous aux capacités de base : capacité de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner, de s’éduquer, de se déplacer, etc.
Les impasses de la modernité occidentale
Les impasses de la modernité occidentale sont essentiellement le règne de la raison instrumentale, le culte de l’individu total et la frénésie du profit. Avec la mondialisation contemporaine, elles se disséminent sur toute la planète.
C’est la combinaison de ces trois impasses qui nous conduit, notamment, vers l’épuisement des ressources naturelles, le dérèglement climatique et la destruction massive, pour ne pas dire irréversible, de l’écosystème planétaire.
- La raison instrumentale
Sous l’angle éthique, la raison instrumentale se débusque dans le comportement purement stratégique des individus en vue d’atteindre leurs fins personnelles au mépris de toute véritable intersubjectivité fondée sur l’égale dignité des individus.
- Le culte de l’individu total
Le sacre des droits de l’homme auquel nous assistons en Occident depuis le début des années 1980 et qui nous est apparu comme l’expression la plus accomplie de la démocratie libérale, ne manque pourtant pas de faire naître chez l’individu un désatreux sentiment de désappartenance par rapport à la collectivité dans laquelle il vit.
Au regard de ce développement illimité et incontrôlé de l’individu comme pure singularité, on peut assurément parler de nouvelle crise de la démocratie où « l’individu privé d’aujourd’hui se définit par sa déliaison foncière d’avec la société » .
Marcel Gauchet a largement développé cette problématique dans son livre Le nouveau monde , quatrième tome de sa fresque intitulée L’avènement de la démocratie.
- La frénésie du profit
La recherche du profit maximum est sans aucun doute l’une des spécificités essentielles du capitalisme sauvage.
Dans sa version traditionnelle, le capitalisme sauvage a permis la création de fortunes colossales et d’empires industriels grâce essentiellement à deux mécanismes : l’exploitation d’une main d’œuvre bon marché (prolétariat) voire gratuite (exclaves ou prisonniers de guerre) et le pillage des matières premières (période coloniale). Pour maximiser leur profit, les propriétaires de ces grandes fortunes et de ces empires industriels avaient également recours à l’ingéniérie fiscale, mais aussi à la fraude, pour payer le moins d’impôts possible.
Aujourd’hui, l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché (délocalisation), le pillage des ressources naturelles grâce à la corruption et l’ingénierie fiscale sont toujours d’actualité. Il faut cependant y ajouter de nouveaux mécanismes favorisés par le néo-libéralisme, à savoir le pouvoir de marché, les crédits prédateurs, la manipulation des marchés et les délits d’initiés.
Le pouvoir de marché est sans doute l’une des perversions les plus redoutables du néo-libéralisme : « […] Les grandes entreprises ont usé de ce pouvoir pour augmenter leurs “marges” – c’est-à-dire leurs prix par rapport à leurs coûts. Cela se traduit par de gros profits. »
La conséquence essentielle de cette frénésie du profit maximun est bien évidemment le creusement des inégalités. Cela tant au sein des sociétés occidentales où la classe moyenne est désormais mise à mal qu’à l’échelle mondiale où la grande pauvreté ne fait qu’augmenter.
« Nous avons fait fausse route sur les valeurs, écrit J.E. Stiglitz. Nous avons oublié que l’économie est censée servir le peuple, et non l’inverse. Nous avons confondu les fins et les moyens […]. »
Les droits de l’homme : paradigme problématique du politique
Dans les démocraties néo-libérales occidentales les droits de l’homme sont devenus le paradigme du politique c’est-à-dire à la fois le socle du fonctionnement démocratique et la grille d’analyse critique de tout régime politique.
Pourtant, cette quasi-sacralisation des droits individuels n’est pas sans poser de sérieuses difficultés : « Le problème philosophique des droits de l’homme, qui est le problème citoyen d’aujourd’hui, c’est qu’ils sont conçus pour s’appliquer à une réalité qui leur est hétérogène, qui a nom “société”. »
Dès lors que les notions de volonté générale et d’intérêt commun sont désormais en porte à faux avec une démocratie conçue non plus comme une unité de citoyens animés par la volonté délibérée de former un corps politique, mais bien comme une collection d’individus réclamant toujours plus de liberté et de droits individuels, c’est l’idée-même de pouvoir et de gouvernement dont le souci de l’intérêt général est la priorité qui se trouve fondamentalement remise en cause : toute limitation de la liberté individuelle, toute atteinte aux droits subjectifs apparaît désormais comme liberticide et comme un obstacle insupportable à la réalisation des aspirations personnelles, parfois profondément égoïstes, de chaque individu lesquelles priment sur l’intérêt commun.
Le réchauffement climatique auquel nous assistons, et dont les premières conséquences deviennent tangibles, ne manquera pas pourtant de remettre l’intérêt commun, planétaire cette fois-ci, au premier plan et de contraindre chacun, singulièrement dans le monde occidental, à réduire drastiquement son empreinte écologique au risque de conduire à l’extinction de l’espèce humaine. On peut d’ores et déjà gager que cela ne se fera pas sans mesures coercitives strictes qui viendront mettre, il est collectivement légitime de l’espérer, un coup d’arrêt à l’individualisme néo-libéral.
Les droits de l’homme étant devenus le paradigme des démocraties-libérales, c’est fort logiquement qu’ils deviennent également la grille d’analyse de l’examen critique d’un régime politique. Ils sont en quelque sorte les fourches caudines sous lesquelles tout régime politique doit passer.
Pour autant, constituent-ils une grille d’analyse pertinente pour juger valablement d’un régime politique ? Peut-on dire sur base de ce seul critère qu’il réussit ou échoue à mettre en place une société juste ?
Pour ma part, j’estime que ce critère seul ne permet pas de juger du caractère juste ou non d’un régime politique.
Peut-on décrédibiliser un pouvoir politique nonobstant son souci du bien commun au motif que les droits de l’homme, tout particulièrement ceux de la première génération, ne seraient pas suffisamment garantis ? Il faudrait même préciser suffisamment garantis aux yeux des ONG internationales qui donnent le ton en la matière.
En soulignant une fois encore que le respect des libertés fondamentales fait partie intégrante du développement démocratique d’une société, il ne me paraît pas qu’ils soient le critère déterminant, voire indépassable, au motif que leur hyper-développement devient à un certain moment un facteur de dissolution progressive du politique entendu comme l’organisation de la vie en commun en vue de l’intérêt général.
Autrement dit, dès lors que le développement des droits de l’homme ne peut conduire à moment donné qu’à un rejet du politique et de son insupportable pouvoir contraignant pour une personne ne s’éprouvant plus que comme sujet de droits et non plus comme citoyen, le critère du respect des droits de l’homme pour juger d’un pouvoir politique est nécessairement un critère sujet à caution.
La réalisation des capacités de base
Plutôt que de prendre le critère du respect des droits de l’homme, il convient à mon sens d’avoir recours à celui de la réalisation des droits élémentaires que sont les capacités de base (Amartya Sen).
Pour déterminer le degré de réalisation des capacités de base, on peut commencer par recourir à l’indice international de pauvreté multidimentionnelle. Cet indice mesure la nature et l’ampleur des manques liés à la santé, l’éducation et les conditions de vie des ménages, en se fondant sur dix indicateurs : nutrition, mortalité infantile, fréquentation scolaire, années de scolarité, eau potable, électricité, équipement sanitaire, énergie de cuisson, biens d’équipement, revêtement du sol du logement.
Si l’on se base sur cet indice de pauvreté multidimentionnelle, l’on peut considérer que la politique menée par les autorités rwandaises depuis 2000 est une politique juste.
En effet, le rapport 2016 de l’OPHI (Oxford Poverty & Human Development Initiative) qui évalue l’indice pour chaque pays souligne l’excellente performance du Rwanda pour la période 2005-2010 : « Le pays a non seulement réduit sa pauvreté IPM plus rapidement, mais aussi dans tous ses indicateurs » .
L’indice était de 0,426 en 2005, il était de 0,350 en 2010 et depuis 2014 il est estimé à 0,259.
Par ailleurs, le PIB par habitant (en parité de pouvoir d’achat) est passé entre 2000 et 2017 de 667$ à 2.080$, il a donc triplé en 17 ans .
Certes, les capacités de base ne sont pas pleinement réalisées chez tous les Rwandais, mais la situation s’est nettement améliorée et la volonté d’y parvenir est là.
Réduire davantage encore la pauvreté multidimentionnelle
Nous l’avons vu, tous les pays riches, sans exception, ont réussi au cours du XXe siècle à financer l’éducation, la santé et les revenus de remplacement de leurs citoyens grâce à des prélèvements fiscaux représentant 30 à 50% de leur revenu national (production intérieure + revenus nets reçus de l’étranger).
Autrement dit, la réalisation des capacités de base est tributaire des rentrées fiscales d’un État.
Les ressources financières du Rwanda évoluent progressivement. Alors qu’en 2012-2013, l’aide financière internationale représentait encore 48% du budget, elle ne représentait plus que 17% pour l’exercice 2017-2018, 16% pour l’exercice 2018-2019, 14% pour l’exercice 2019-2020.
Par ailleurs, les ressources fiscales du pays sont estimées à 60% du budget pour l’exercice 2019-2020.
Cette substitution progressive des ressources propres à l’aide extérieure correspond à une volonté très clairement affirmée par les autorités et tout particulièrement par le Président de la République.
A partir de 2012, les autorités rwandaises ont revu leur politique fiscale afin « de mettre fin à la dégringolade des revenus provenant des taxes, puisque entre 2003 et 2011, la part des taxes dans les revenus totaux du pays est passée de 59% à 45%. L’une des premières mesures fut de revoir les incitations fiscales pour les entreprises s’installant dans le pays. »
Les investissements étrangers directs - entrées nettes ($ US courant) - sont passés de 10.500.000$ en 2005 à 293.413.074$ en 2017, avec un record à 314.742.419$ en 2014 On rappellera par ailleurs qu’entre 1970 et 2005, soit pendant 35 ans, ils n’ont dépassé les 21.000.000$ qu’à une seule reprise en 1988. Il est important de rappeler d’où l’on vient ! L’attractivité économique du pays est donc évidente.
L’injonction occidentale de démocratisation
Après avoir voulu “civiliser” par le mépris et l’exploitation les peuples africains colonisés, l’Occident s’érige désormais en juge et garant de la démocratisation des États africains.
Il y a manifestement dans cette prétention quelque chose de malvenu et d’exorbitant au regard du passif colonial.
Rappelons tout d’abord que la colonisation s’est faite, avec toutes les avanies qui la caractérisent, alors que les grands textes fondateurs des droits de l’homme avaient déjà été solennellement proclamés : L’Angleterre avait son habeas corpus depuis 1679, les États-Unis d’Amérique sa Déclaration d’indépendance depuis 1776 et la France sa Déclaration des droits de l’homme et du citoyen depuis 1789.
Pourtant les puissances coloniales n’ont jamais été capables d’instaurer la démocratie et de respecter les droits de l’homme dans leurs colonies, singulièrement à compter de 1948 (date de la Déclaration universelle des droits de l’homme) et alors que bon nombre de soldats issus des colonies avaient fait le sacrifice de leur vie durant les deux conflits mondiaux.
Pour trouver une réponse à ce flagrant décalage entre les proclamations solennelles et la triste réalité, il faut se tourner vers Hannah Arendt.
Dans la deuxième partie, intitulée L’impérialisme, de son livre Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt écrit : « Là [dans les empires coloniaux], à la barbe de tous, se trouvaient maints éléments qui, une fois réunis, seraient capables de créer un gouvernement totalitaire fondé sur le racisme. Des « massacres administratifs » étaient proposés par des bureaucrates aux Indes, tandis que les fonctionnaires en Afrique déclaraient qu’ « aucune considération éthique telle que les droits de l’homme ne sera autorisée à barrer la route » de la domination blanche. »
Pour Arendt, c’est donc dans le creuset de l’impérialisme colonial que se formèrent les caractéristiques essentielles de la structure totalitaire que sont le critère racial qui légitimera la domination du colonisateur et celui de la gestion bureaucratique qui justifiera les massacres commis à l’encontre des populations dominées.
Le totalitarisme, qu’il soit nazi ou soviétique, n’est pas selon Arendt la suite logique de l’impérialisme colonial, mais il va trouver dans celui-ci deux principes fondamentaux. Ainsi donc, l’expansionnisme colonial, qui va battre son plein de la conférence de Berlin au début de la Première Guerre mondiale, fournira au totalitarisme ses outils les plus redoutables.
Dès lors que l’entreprise coloniale était viscéralement contraire au principe de base de la démocratie moderne qu’est l’égalité des conditions (« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »), la seule et unique issue possible était sa disparition de gré ou de force.
Depuis juillet 1994, le Rwanda s’est démocratisé et entend continuer à le faire. Il ne le fera toutefois pas sur injonction du monde occidental qui ne dispose d’aucune légitimité en la matière, et il le fera en tenant compte de sa propre culture et de ses traditions, en particulier celle de l’Ubuntu qui signifie la générosité, la solidarité et le partage .
Cette tradition précoloniale de l’Ubuntu qui met l’accent sur l’importance du vivre en commun est exactement à l’opposé du culte de l’individu total délié de la société produit par l’Occident néo-libéral.
Peut-on dès lors reprocher aux autorités rwandaises de ne pas vouloir pour leur pays une démocratie à l’occidentale dès lors que celle-ci se caractérise en Occident par la dissolution du sens collectif et de l’intérêt général, par le culte du profit personnel sans limite, de la revendication individuelle à outrance, et du consumérisme ? Peut-on sérieusement prétendre que notre modèle démocratique est la voie à suivre pour des pays où la cohésion sociale, le lien communautaire, l’intersubjectivité, l’action commune ont encore du sens ? Faut-il contraindre ces pays, au nom d’une idéologie toute relative, de verser dans nos excès et nos dérives nihilistes ? Poser la question, c’est y répondre. Les professionnels de la vigilance démocratique en Afrique seraient sans doute bien inspirés de commencer par réfléchir sur les conséquences sociales et politiques de leur idéologie dans le monde occidental.
Au Rwanda, une politique juste c’est d’abord une politique qui renforce le lien social et qui veille, grâce à la bonne gouvernance, à ce que tous les citoyens puissent accéder à ces droits humains élémentaires que sont les capacités de base.
Bibliographie
PIKETTY Th., Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013
GAUCHET M., La condition historique, Stock, 2003,, pp. 328-329.
GAUCHET M., Le nouveau monde, bibliothèque des sciences humaines, Gallimard, 2017.
STIGLITZ J.E., Peuple, pouvoir & profits, Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale, 2019, LLL Les liens qui libèrent, p. 85.
Ibidem, p. 286.
GAUCHET M., Les droits de l’homme avec la démocratie et contre la démocratie, in Le droit contre la loi, Cahier de la Fondation Res Publica, Octobre 2018.
https://ophi.org.uk/global-mpi-reports/
Chiffres du FMI
REVILLON J., « Le Rwanda, un modèle économique ? », n° 24, Les Cahiers d’Afrique de l’Est / The East African Review [En ligne], 48 | 2014, mis en ligne le 07 mai 2019.
URL : http://journals.openedition.org/eastafrica/385
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/RWA/fr/BX.KLT.DINV.CD.WD.html
Ibidem, p. 499.
TWAHIRWA A., « L’Ubuntu et la démocratie participative au Rwanda », in IGIHE, http://www.fr.igihe.com/education-culture/l-ubuntu-et-la-democratie-participative-au-rwanda.html
















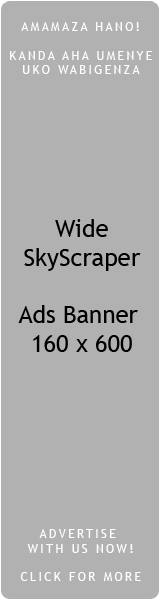
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!