Un débat autour de la question ethnique dans les Grands-Lacs africains montre que cette question est forgée et renforcée par l’administration coloniale belge.

Le travestissement idéologique ethnocentriste constaté a été forgé en dur par l’administration coloniale belge et renforcée par des chercheurs issus des milieux intéressés, ont avancé quatre chercheurs dont le Dr Jean Bosco Manirambona et Simon Simbananiye du Burundi de même que les rwandais Stéphane Byiringiro et Tharcisse Semana. Le débat se passait ce Samedi 18 janvier 2014 à la BBC dans son programme IMVO N’IMVANO.
Ethnocentrisme devenu récemment réalité pour des fins politiques ?
Les quatre chercheurs montrent dans leur cheminement que les Batutsi, Bahutu et les Batwa au Rwanda de même que les mêmes auxquels s’ajoutent les Baganwa au Burundi ont toujours été soumis à une mobilité sociale bien avant la pénétration coloniale au Rwanda et au Burundi jusqu’en 1933 où le colon belge a obligé les Barundi et Banyarwanda, surtout ces derniers, à se classer dans ces nouvelles catégories ethniques alors qu’au départ et même actuellement ils se retrouvent dans des catégories que les uns disent claniques que sont les Abenengwe, Abanyakarama, Abasindi, Abanyiginya…
Le Dr Jean Bosco Manirambona quant à lui préfère les appeler des familles (imiryango) et non des clans. Pour ce dernier chercheur, les différentes théories pseudo scientifiques des chercheurs du temps de la colonisation selon lesquelles les Batutsi viendraient de l’Abyssinie, qu’ils auraient perdu leur langue d’origine avec le temps ne tiennent pas debout car, a-t-il dit, « il aurait dû y avoir de quelconques ancêtres qui se seraient perdus tout le long du chemin d’Abyssinie en passant par la Somalie, le Kenya, l’Ouganda au point qu’un parler qui s’apparenterait au leur aurait été dépisté », a-t-il argumenté balayant d’un coup cette soi-disante origine couchitique des Batutsi.

Et puis, selon le chercheur, il y a une réalité très sociale qui vient contrer cette hypothèse. « Partout où vous irez au Rwanda, au Burundi ou ailleurs, vous ne verrez jamais un Mututsi qui vit seul sans le Muhutu à côté. C’est un signe qui ne trompe pas et qui vient renforcer le fait qu’ils partagent la même langue, culture, et mœurs de tout temps », est ainsi intervenu Manirambona montrant que seule la mobilité sociale du Mutwa au Muhutu, du Muhutu pour devenir un Mututsi selon des considérations économiques de leur temps.
Et puis, un Mututsi l’était par rapport à celui qui était inférieur à lui. Il était Muhutu par rapport à celui qui le protégeait et lui permettait d’accroître ses richesses, a-t-il dit montrant qu’il a fait des recherches poussées en matière d’anthropologie de la région des Grands-Lacs africains.
Tharcisse Semana critique sévèrement l’Abbé Alexis Kagame pour avoir gobé cette théorie des origines différentes des Batutsi et Bahutu. Pour lui, les catégories Bahutu, Batutsi et Batwa sont une création de Lyangombe qui, avant sa mort, aurait catégorisé ainsi les Rwandais disant « il allait régner sur ce monde dans l’après mort »
Dans tous les cas les 4 chercheurs sont d’avis que tout porte à croire que les catégorisations Hutu, tutsi et Twa et Ganwa au Burundi s’apparentent plus aux classes sociales plutôt qu’aux catégories ethniques.
« De tout temps, il y a eu de l’ascension dans les classes sociales. La paupérisation étant fréquente. Donc on retombait d’une catégorie sociale à l’autre », a dit le chercheur Manirambona. Ceci se justifie avec le fait qu’au Rwanda le terme de Kwihutura signifiait qu’on quittait la catégorie sociale de Muhutu pour celle de Mututsi. Manirambona va plus loin et montre que « les Barundi pouvaient tomber de haut, catégorie Ganwa, à celle des Batutsi puis des Bahutu et jamais de Batwa car quand on était sédentaire, il en était fini de tomber dans la catégorie Batwa ».
Politiciens non visionnaires
Ces chercheurs montrent que la plupart des politiciens Banyarwanda et Barundi ont été caractérisés par une légèreté qui frisait un égocentrisme plat avec l’introduction de l’ethnie par l’administration coloniale. Le conflit d’intérêts a toujours miné ces derniers jusqu’à privilégier la notion ethnie qui leur permettait une longévité au pouvoir et des privilèges y afférents plutôt que la perception et la protection des droits égaux de tous les nationaux.
« Actuellement les deux pays , le Rwanda et le Burundi, n’ont pas encore des politiciens visionnaires qui ont su dépasser le discours ethnisant pour pouvoir garder le pouvoir », indiqué Manirambona comme pour dire que toutes les conséquences de divisionnisme mortifère dont le génocide des Tutsi du Rwanda de 1994 auquel on assiste n’auraient pas dû arriver. Ce chercheur insiste, après recherche corroborante, sur les liens familiaux entre les Bahutu et les Batutsi de par les ‘amoko’ burundaises et rwandaises telles qu’elles sont structurées où Bahutu et Batutsi y compris les Batwa s’y distribuent et s’y reconnaissent.
Enfin Tharcisse Semana montre qu’un leader visionnaire tanzanien, le Mwalimu Julius Nyerere, a eu un rôle positif dans le tassement des différences ethniques hutu tutsi de l’ancien royaume du Buha.
Des chances de succès de l’idéologie de la citoyenneté rwandaise.
De fil en aiguille, on comprend qu’avec un développement matériel et un accroissement des richesses des citoyens rwandais, avec une gestion socio politique saine combattant les injustices dans la société rwandaise, l’idéologie de la rwandité, celle de la citoyenneté rwandaise peut donner des fruits certains. Tout dépendra du mode de promotion sociale des rwandais mais aussi de l’organisation des stratégies et d’opportunités de plus de création de richesses sociales dans le pays.

En d’autres termes, à l’heure actuelle où les poches de l’économie d’autosubsistance sont entrain d’être éradiquées, il s’avèrera un succès au moment où le paysan rwandais qui ne fait qu’actuellement moins de trois heures de travail, puisse s’occuper au-delà de 10 heures de la journée y compris les week-ends puisqu’il sera entrain de produire pour lui-même.
Ici il faudra déployer une capacité de sensibilisation populaire intense montrant des possibilités illimitées d’exploitation de son lopin de terre avec une plus grande productivité grâce à sa collaboration avec les banques commerciales du pays qui s’implantent de plus en plus à chaque coin de rue du pays.





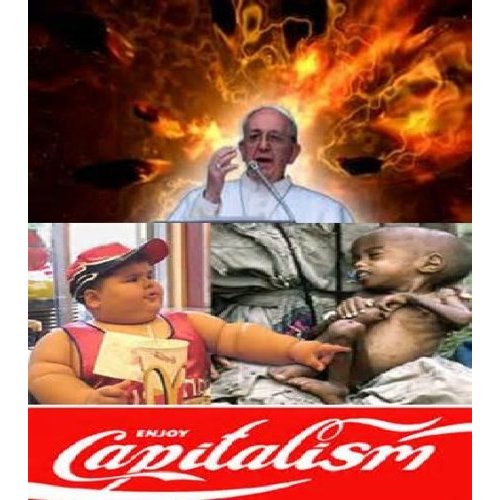






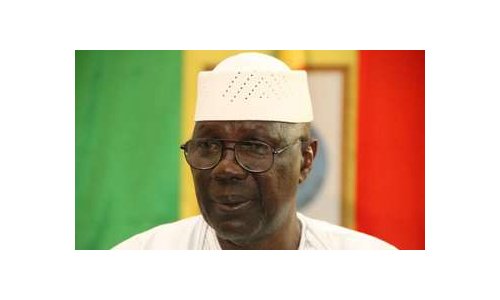



AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!