Tribune. Pour la seconde fois en moins d’un an, me voilà de retour au Brésil. Je suis invitée au salon du livre de Porto Alegre, puis je dois présenter à São Paulo la traduction d’Inyenzi ou les cafards : Baratas, avec mon éditrice (éditions Nos),le troisième de mes livres parus au Brésil. Enfin, je dois participer au forum Women of the World, soutenu par le British Council en partenariat avec l’ONG Redes da Maré qui œuvre en faveur des femmes dans les favelas du même nom. J’avais gardé un souvenir ébloui de ma première visite au Brésil tant la ferveur de mes lecteurs pour mes livres m’avait touchée. Peut-être n’avais-je pas saisi alors la violence de l’abîme qui sépare la richesse ostentatoire de l’extrême pauvreté et du racisme affiché par certains qui gangrènent ce pays pourtant si attachant. La situation politique actuelle a mis à nu ces aspects angoissants.
Dès mon arrivée, je suis frappée par l’atmosphère de peur et de violence qui règne. A Porto Alegre, on me recommande aussitôt de ne pas sortir de l’hôtel dès la nuit tombée. Les gangs règnent sur la ville et se disputent les quartiers et les rues. A São Paulo, on réitère avec plus d’insistance encore les avertissements :
« Fais extrêmement attention : non seulement tu es une femme, mais de plus tu es une femme noire. Ici, une femme noire ne compte pour rien. Ne serait-ce qu’en voulant traverser une rue, redouble de précautions, une voiture peut foncer sur toi. Elle ne s’arrêtera pas, surtout pas pour une femme noire. »
Dans les conversations, il n’est question que d’agressions contre les Noirs, les homosexuels, les travestis.
São Paulo est une ville immense. On croit ne jamais pouvoir en sortir. Les riches la survolent en hélicoptère mais la misère jonche les trottoirs. Qui sont-ils ces femmes, ces hommes couchés sur le pavé ? Ils ne mendient pas. Sans doute n’en ont-ils plus la force. Je me demande avec effroi si je ne viens pas d’enjamber un cadavre. Personne ne semble s’en soucier.
« Blanchir » les favelas
A Rio, il est toujours surprenant de voir la pauvreté sordide des favelas surplomber à y toucher le luxe des palaces d’Ipanema. La conférence de Women of the World à laquelle on m’a demandé de participer a pour sujet les violences faites aux femmes selon l’intitulé : « Violent deaths : dealing with pain in women’s daily life ». L’intervention qui m’a le plus touchée et émue est celle de Marinete da Silva. Marinete da Silva est la mère de Marielle Franco assassinée à Rio le 14 mars. Femme noire, issue de la favela Complexo da Maré, sociologue diplômée de l’université pontificale catholique de Rio, lesbienne, féministe, Marielle est élue, en 2016, conseillère municipale de la ville de Rio sur la liste de coalition formée par le Parti socialiste (PSOL) et le Parti communiste (Mudar é possivel, « changer est possible »). Elle portait l’espoir des femmes, des jeunes des favelas, de tous ceux qui ne font plus confiance aux institutions politiques face aux assassinats systématiques perpétrés par les gangs aussi bien que par l’armée et la police. Marielle Franco est devenue le symbole de la résistance au régime de terreur qu’annonce le nouveau président élu. Marinete, juriste, est bien décidée à continuer la lutte menée par sa fille contre une politique de violence qui assassine chaque année des dizaines de milliers de jeunes Noirs et à faire éclater la vérité sur son assassinat qu’on veut faire passer pour un simple fait divers comme il y en a tant au Brésil. Mais c’est avant tout une mère. Elle se sent coupable de ne pas avoir accompagné sa fille à la conférence qu’elle devait donner ce soir-là. Mais cela aurait-il changé quelque chose ? Le chauffeur de Marielle a lui aussi été tué. Alors, pourquoi ne l’a-t-elle pas découragée à entrer en politique sachant qu’elle risquait sa vie ? Ses engagements pour les droits des femmes, des transgenres, pour l’accès à l’avortement ne suffisaient-ils pas ? Je me jette dans les bras de Marinete.
Y a-t-il une politique systématique d’assassinat des jeunes hommes noirs dans les favelas ? L’accusation est grave. Au cours d’une longue conversation, Gonceição Evaristo, grande voix de la littérature afro-brésilienne, me confirme que les assassinats sont bien systématiques et ciblés. Elle avance même le terme de génocide. Je pense aussitôt au Rwanda. Je suis inquiète qu’elle emploie ce mot qui me semble devoir être réservé pour une volonté délibérée d’éradication massive d’une population. Gonceição sait ce qu’elle dit et insiste : il s’agit bien d’un projet de « blanchir » les favelas.
La fille d’Ipanema
Copacabana, Ipanema, des noms qui font rêver. Aujourd’hui, il pleut sur Copacabana, sur Ipanema. C’est normal, c’est la saison. Je chantonne la célèbre bossa nova The Girl From Ipanema :« The girl from Ipanema goes walking / When she walks, she’s like samba. »
Mais je sais aussi qu’il peut être dangereux de se promener sur la plage. Lors de mon précédent voyage, j’avais commis l’imprudence de ne pas me séparer de mon indispensable compagnon : mon sac à main. Je fus bientôt suivi de près par trois hommes qui manifestement avaient repéré mon précieux bagage. J’eus le bon réflexe de me jeter dans un taxi. Le chauffeur me fit comprendre en me montrant mon sac combien grande avait été mon imprudence. Je regarde autour de moi : c’est bizarre les femmes ne portent pas de sac. Ici, Louis Vuitton ferait faillite.
Je croise un groupe d’évangéliques tonitruants. Ils hurlent le nom de Jésus qui « sauve ». Les doctrines fondamentalistes et réactionnaires de ces néopentecôtistes m’effraient. En Afrique aussi, elles inspirent les législations les plus répressives contre les libertés individuelles. Le Rwanda a heureusement réagi en fermant quelques temples desservis par des pasteurs et autres prophètes autoproclamés.
Une toute petite fille (je suis incapable de lui donner un âge, peut-être 3 ans) s’approche pour me vendre un paquet de chewing-gums. Je suis frappée par son visage vide de toute expression. Moi aussi au même âge, sur le marché de Nyamata, je vendais mes cornets de cacahuètes. Je lui achète donc ses chewing-gums. Un homme qui tient non loin une petite boutique, un « lolo » comme on dirait aux Antilles, vient vers moi et m’interpelle en français : « Ce n’est pas bien ce que vous avez fait là, l’argent que vous avez donné à cette gosse, ce n’est pas pour elle, c’est pour sa mère que vous voyez là-bas. C’est pour acheter sa drogue. Pourtant, l’Etat s’occupe de ces enfants. Mais les mères viennent les récupérer pour les remettre à mendier dans les rues. » L’homme m’explique qu’il est libanais, que son épouse est noire, il me la présente, il habite une favela, mais il est pour la manière forte, il est pour la stérilisation des drogués, hommes et femmes, surtout les femmes. Le populisme suprémaciste blanc de Bolsonaro a trouvé aussi ses partisans dans les favelas.
Iemanjà et la mer
J’avais toujours rêvé le Brésil comme le pays heureux de tous les métissages, de toutes les mixités. Et le spectacle de cette rue de Rio que je contemple en savourant un verre de caïpirinha semble me le confirmer : toutes les nuances de couleur de peau s’y croisent, toutes les possibilités de couples entre êtres humains s’y rencontrent. Vous souhaitez qu’un tel métissage, qu’une telle liberté de comportements deviennent universels. Et pourtant, tout cela n’est sans doute qu’une belle illusion. Les nuances de couleurs sont aussi une hiérarchie et cela même à l’intérieur des familles : ceux qui sont moins foncés se sentent moins menacés, du moins pour l’instant. Les inégalités sociales se fondent en premier lieu sur le racisme issu de l’esclavage qui ne fut aboli au Brésil qu’en 1888. L’élection remportée par Bolsonaro excite toutes les violences, le Brésil va-t-il sombrer dans une dictature plus sombre encore que toutes celles qu’il a déjà connues ? Mon compagnon et guide veut me rassurer : « Regarde dans la rue, à la plage, cette foule bariolée, elle continuera à vivre comme elle le fait aujourd’hui. Comment changer la joie de vivre de tout un peuple ! »
Je voudrais partager ce bel optimisme et moi qui ne crois plus guère en l’au-delà, ni en ses anges, ni en ses saints, ni en ses esprits, je me retourne pourtant vers la statuette de Iemanjà que j’ai achetée sur un marché de São Paulo. Iemanjà, c’est une orixa du candomblé, le culte afro-brésilien transmis de la « Mère Afrique » au travers des horreurs de l’esclavage. C’est une déesse de la mer. Ma déesse à moi a les seins nus, elle est vêtue d’une longue jupe bleue scintillante retenue par une ceinture de cauris. De ses bras tendus, elle déploie derrière elle, comme la cape d’une madone, un filet de pêcheur aux mailles dorées constellées d’étoiles de mer. C’est pour célébrer cette déesse secourable que la nuit du Nouvel An, les Cariocas allument des bougies sur la plage de Copacabana. A minuit, les porteurs d’offrandes s’avancent dans la mer aussi loin qu’ils le peuvent pour y jeter leurs panelas, de frêles corbeilles de pailles chargées de fleurs et qui contiennent les présents qui accompagnent les vœux des fidèles. Si Iemanjà les accepte, l’océan les engloutit, si elle les refuse, ils sont rejetés sur le rivage.
Puisse Iemanjà accepter le mien : que les Brésiliens puisent dans leurs racines africaines et amérindiennes les forces de résister à la barbarie qui menace leur si beau pays.
Scholastique Mukasonga, Liberation.















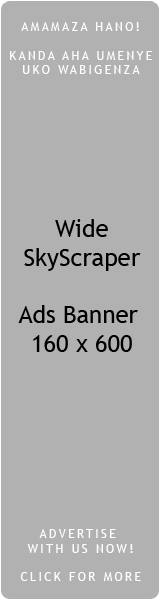
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!