Depuis le 19 décembre 2025, une chaîne YouTube appelée Real Talk, animée depuis l’Allemagne par le journaliste Étienne Gatanazi, travaillant pour la Deutsche Welle, a diffusé un entretien avec Adeline Mukangemanyi Rwigara qui relève précisément de cette logique. Avec une conviction sereine, Mukangemanyi présente le président Juvénal Habyarimana comme un dirigeant aimant et bienveillant, un modèle de sollicitude envers tous les Rwandais.
Elle est allée plus loin encore : elle a affirmé qu’il favorisait les Tutsi dans les affaires et qu’il aurait permis leur prospérité. Il ne s’agissait ni d’une ignorance, ni d’une simple maladresse. C’était un acte sophistiqué de blanchiment moral, une canonisation rétrospective d’un pouvoir qui a présidé à la construction délibérée de l’extermination. Une mise en scène de l’innocence, plus de trente et un ans après que le sang a séché, alors même que les conséquences demeurent douloureusement vivantes. Apparemment, l’histoire fonctionnerait désormais selon un nouvel algorithme faussement vertueux.
Malheureusement, s’il est prononcé avec suffisamment de calme, le crime devient sollicitude, et s’il est répété avec douceur, l’idéologie se mue en vertu. Selon cette logique, les systèmes exterminateurs n’auraient plus qu’à être racontés sur un ton chaleureux pour être qualifiés de projets humanitaires.
On en vient parfois à se demander pourquoi les tribunaux s’encombrent de preuves, lorsque la sentimentalité tient désormais lieu de preuve disculpatoire. Dans cet univers moral révisé, la responsabilité s’évanouit dès lors que l’orateur sourit avec persuasion.
Il est incompréhensible de louer un incendiaire alors que les braises brûlent encore dans la mémoire collective. On ne peut faire d’un saint l’ingénieur en chef d’un système qui a préparé, organisé, armé, entraîné et conditionné idéologiquement une population au génocide, puis plaider l’innocence en brandissant des anecdotes sélectives de bonté.
Ce n’est pas seulement une fraude intellectuelle, c’est une offense morale.
Des dates autour desquelles la réalité s’impose
Aucune discussion honnête sur Habyarimana ne peut reléguer les 6 et 7 avril 1994 au rang de dates accessoires. Ces dates ne sont pas des post-scripts. Elles constituent les points de bascule de l’histoire. Le 6 avril 1994, l’avion présidentiel est abattu.
En quelques heures, l’ordre constitutionnel du Rwanda s’effondre. Le 7 avril, la Première ministre Agathe Uwilingiyimana, opposante déclarée à l’Akazu et à sa machine génocidaire, est assassinée. Il en va de même pour Joseph Kavaruganda, président de la Cour constitutionnelle ; le ministre Landouald Ndasingwa ; le ministre de l’Agriculture Frédéric Nzamurambaho ; et Faustin Rucogoza, ministre de l’Information, pour n’en citer que quelques-uns.
Ces meurtres n’étaient pas spontanés. Ils obéissaient à des listes préparées. Ils découlaient de décisions prises à l’avance. Ils s’inscrivaient dans un schéma déjà répété. Ils visaient l’élimination délibérée de tous les obstacles à la mise en œuvre du génocide contre les Tutsi. Dans le théâtre du déni, ces assassinats sont souvent présentés comme de tragiques coïncidences, à l’image d’une intempérie venant perturber une journée autrement paisible.
Mais les coïncidences n’arrivent pas avec des listes, et elles n’exécutent pas méthodiquement des dirigeants légitimes les uns après les autres. Cela relève de l’intention, de la mémoire et du commandement. Louer Habyarimana sans affronter la réalité de ces dates, c’est commettre une fraude morale : présenter la vertu là où le vice n’était ni accidentel, ni marginal, mais systémique, opérationnel et meurtrier.
La maternelle criminelle de Kanombe
Ce qui s’est déroulé à la résidence de Habyarimana à Kanombe après le crash de l’avion ne relevait pas seulement du deuil pour des proches et des membres de la famille.
Il s’agissait d’un centre de coordination du génocide contre les Tutsi. Des témoins, cités par Andrew Wallis dans son ouvrage Stepp’d in Blood, décrivent Agathe Kanziga décourageant les pleurs, avertissant que le deuil « aiderait l’ennemi ». Aux côtés de son frère Protais Zigiranyirazo, elle a passé des appels répétés à des dirigeants étrangers alors que des corps gisaient encore dans le salon.
Des listes d’ennemis, déjà établies, furent transmises aux exécutants. Lorsque Suzanne Seminega, une connaissance d’enfance d’Agathe Kanziga, arriva pour présenter ses condoléances, elle ne trouva pas une veuve accablée par le chagrin, mais une femme dictant au téléphone les noms de personnes devant être tuées. Parmi eux figurait Agathe Uwilingiyimana, qui serait assassinée peu après.
Un chauffeur de taxi, qui attendait à l’intérieur de la résidence, témoignera plus tard avoir entendu Agathe Kanziga exiger, dans un accès de fureur : « Apportez‑moi la tête d’Agathe Uwilingiyimana. » Il ne s’agissait pas d’une figure de style. C’était un langage de commandement.
Ce qui s’est déroulé à Kanombe ne relevait pas du deuil, mais d’une grotesque leçon d’instruction civique : comment transformer la perte en permis d’agir, le chagrin en autorisation, et la tragédie en opportunité politique. On aurait pu prendre la résidence pour une salle de séminaire, à ceci près que le programme était la vengeance et que la condition d’obtention du diplôme était le sang.
Parmi les personnes présentes à la résidence présidentielle se trouvaient deux religieuses catholiques, sœur Godelieve Barushywanubusa et sœur Télésphore Nturoziraga, toutes deux sœurs de Habyarimana. Était également présent l’archevêque Vincent Nsengiyumva, arrivé en tenue cléricale. Leur présence n’a pas freiné la violence. Elle l’a ritualisée.
Des témoins ont rapporté que, durant les prières, Agathe Kanziga demandait à Dieu d’intervenir afin d’accorder la victoire aux Interahamwe et de veiller à ce que l’armée dispose de suffisamment d’armes. Depuis la cuisine, on entendit sœur Godelieve déclarer que « tous les Tutsi devaient être tués ». Cet instant porte un poids moral insoutenable.
Deux jeunes femmes présentes, âgées d’à peine une vingtaine d’années, les filles du Dr Emmanuel Akingeneye, médecin personnel de Habyarimana, lui aussi mort dans le crash, entendirent ces appels à l’extermination tout en sachant que leur propre mère, Leoncilla Mukantagara, était tutsie. Imaginez cette fracture : se tenir dans une maison de prière où la mort est invoquée contre un peuple auquel appartient votre mère. Il ne s’agit pas d’une haine abstraite ou impersonnelle.
Elle est intime, familiale, et annihilatrice. Ici, l’indignation devient inévitable. La haine n’est plus abstraite lorsqu’elle vise votre propre mère, tout en se drapant de prières. C’est le moment où l’idéologie franchit la frontière de la politique pour entrer dans l’anéantissement intime. Au fil de la journée du 7 avril, les noms des opposants politiques assassinés furent annoncés.
Chaque annonce ne rencontra pas le silence, mais des acclamations. Des témoins ont rapporté qu’Agathe Kanziga et ses belles-sœurs célébraient, buvant du champagne et de la bière St. Pauli, tandis que confirmaient les décès d’Uwilingiyimana, Ndasingwa, Kavaruganda et d’autres. Il ne s’agissait pas de confusion, mais d’une affirmation. Le champagne symbolise depuis longtemps la victoire.
Ici, il a baptisé le meurtre comme un accomplissement. Chaque décès annoncé devenait un toast, chaque exécution une confirmation que la boussole morale ne s’était pas seulement brisée, elle avait été délibérément recalibrée.
Jeunes diplômés de la haine
Ces deux jours, l’histoire nous montre des enfants élevés dans la haine. C’est là que l’indécence ultime devient générationnelle. Jean-Luc Habyarimana, âgé de 18 ans, armé d’un fusil R4, aurait exigé de voir le corps de la Première ministre assassinée et a dû être convaincu de ne pas tirer dessus. Pas pour tuer, elle était déjà morte, mais pour profaner.
Sa sœur cadette, Marie-Merci Habyarimana, âgée de seulement 15 ans, aurait repris la véhémence de sa mère, exigeant que même les maîtresses tutsies de Zigiranyirazo soient exécutées.
Il ne s’agit pas d’excès de jeunesse. Il s’agit d’un héritage idéologique. Une haine aussi précise s’enseigne. Une violence ritualisée s’apprend. Contempler le fait de tirer sur le corps d’une Première ministre déjà assassinée n’est pas un réflexe de chagrin soudain. Ce n’est pas une rage improvisée dans le choc. Ce n’est pas le débordement émotionnel d’un adolescent submergé par la perte. C’est quelque chose de bien plus révélateur et bien plus accablant : l’empreinte morale de quelqu’un qui aurait voulu tuer les vivants et est arrivé trop tard.
Lorsque Jean-Luc Habyarimana, armé d’un fusil d’assaut, aurait exigé de voir le corps de la Première ministre Agathe Uwilingiyimana et a dû être convaincu de ne pas tirer sur son cadavre, il ne s’agissait pas d’un acte de folie né le 7 avril 1994. C’était une révélation. La profanation des morts est l’affaire inachevée d’un esprit déjà engagé dans l’extermination. On ne vise pas un cadavre sans avoir répété auparavant le geste sur des corps vivants.
Ce tempérament ne tombait pas du ciel. Il a été cultivé. Bien avant avril 1994, le 15 novembre 1992, Jean-Luc était assis dans le stade de Ruhengeri, observant son père louer les Interahamwe tandis que sa mère apparaissait dans leur uniforme. Ce moment n’était pas un théâtre symbolique ; c’était une cérémonie de remise de diplôme. À cette époque, Jean-Luc n’était pas un novice. Il avait grandi dans ce que l’on ne peut décrire que comme une maternelle du mal et de la criminalité hardcore, progressant sans heurt dans une académie de génocidaires où la haine était normalisée, récompensée et célébrée.
Jean-Luc n’était pas seul. Sa sœur et dernière née de la famille, Marie-Merci Habyarimana, à peine âgée de quinze ans, aurait exprimé son indignation, non contre le meurtre lui-même, mais contre son caractère incomplet, exigeant que les maîtresses tutsies de son oncle Protais Zigiranyirazo soient exécutées. Ce détail est important. Zigiranyirazo avait des enfants, les cousins de Marie-Merci. Que pensait-elle d’eux ? Étaient-ils des exceptions ? Des dommages collatéraux ? Des parents temporaires attendant une clarification idéologique ?
La haine qui s’affine ne surgit pas spontanément. Elle s’enseigne. Elle se répète au petit-déjeuner et au dîner. Elle est authentifiée par le rire lorsque la mort est annoncée et sanctifiée lorsque les bouchons de champagne célèbrent les exécutions. Les enfants élevés dans un tel environnement n’apprennent pas l’amour pour ensuite dévier vers la haine ; ils sont formés à la haine et finissent par la prendre pour la vertu.
C’est pourquoi les manières et le comportement de Jean-Luc et Marie-Merci importent historiquement. Leur attitude révèle le mensonge selon lequel le génocide contre les Tutsi aurait été l’œuvre de foules incontrôlables. Elle montre au contraire comment l’extermination est domestiquée, héritée et transmise comme un sens moral commun.
Lorsque des enfants parlent couramment le langage de l’élimination et de l’extermination, la société doit cesser de se demander ce qui s’est passé ce jour-là et commencer à s’interroger sur quelle éducation a rendu ce jour inévitable.
Le mensonge et le culte du « Bon Homme »
Les défenseurs d’un criminel se réfugient dans un abri familier : le bon homme trahi par les événements. On nous dit que Habyarimana était modeste, rural, pieux et pacifique. Un homme, en apparence, séparé du système qui portait son nom.
Toutefois, le pouvoir laisse des empreintes. Un dirigeant qui aime son peuple, comme Mukangemanyi décrit Habyarimana, ne préside pas sur un État qui institutionnalise l’exclusion ethnique, normalise les cartes d’identité comme instruments de tri et gouverne par la peur tout en l’appelant « ordre ».
Le culte du « bon homme », à l’image de Habyarimana, fonctionne comme un détergent moral : il promet de laver les taches de sang à l’aide d’anecdotes. Le racisme structurel est effacé par une histoire d’enfance. Les milices sont neutralisées par des affirmations d’humilité personnelle. La préparation du génocide est annulée par des souvenirs sélectifs de bonnes manières imaginées. Ce n’est rien d’autre qu’une éthique réduite à un simple décor intérieur, où le papier peint de la vertu privée est censé masquer les fissures du crime public.
Le Rwanda de Habyarimana était conçu ethniquement, préparé idéologiquement et organisé administrativement pour des formes extrêmes de violence de masse. Le génocide contre les Tutsi
Habyarimana comme ancre idéologique
Juvénal Habyarimana n’était pas un spectateur de la radicalisation du pouvoir hutiste. Il en était la pierre angulaire.
Bien qu’étant président, il était un actionnaire majeur de la RTLM, la station de radio qui transforma la haine contre les Tutsi en devoir civique. La RTLM ne se contentait pas d’insulter et d’inciter à la haine : elle instruisait. Elle nommait des ennemis imaginaires et normalisait l’extermination d’un peuple.
Les miliciens Interahamwe n’étaient pas de simples voyous désœuvrés. Ils étaient formés, armés, admirés par la famille Habyarimana et, de ce fait, politiquement protégés. Ils défilaient au grand jour, confiants non parce qu’ils étaient puissants, mais parce qu’ils savaient où résidait le pouvoir.
Le 15 novembre 1992, Agathe Kanziga Habyarimana est apparue publiquement vêtue de la tenue des Interahamwe, un acte symbolique qui ne peut souffrir aucune ambiguïté.
Selon Mukangemanyi, nous serions invités à croire que des radios de haine comme la RTLM, financées au sommet même du pouvoir rwandais, auraient, d’une manière ou d’une autre, fonctionné indépendamment de ce pouvoir, comme un lion privé de ses dents et de ses griffes. Le président, nous dit-on, se serait contenté de présider l’administration du pays, tandis que la propagande haineuse s’aiguisait toute seule, que les milices s’entraînaient d’elles‑mêmes et que l’idéologie s’organisait spontanément. C’est une gouvernance par omission immaculée : tout se produit, mais personne n’est responsable.
La puérilité du récit de « l’ange »
Si l’on veut éprouver le caractère d’un dirigeant, il faut examiner non seulement ses discours, mais l’écosystème moral qu’il cultive autour de lui. Ce qui s’est déroulé à la résidence de Kanombe dans les heures qui ont suivi le crash de l’avion n’est pas l’histoire d’une famille endeuillée submergée par la perte. C’est celle d’un centre de commandement, fonctionnant au milieu des cadavres avec une clarté glaçante.
Nous connaissons une résidence présidentielle où le deuil était découragé comme signe de faiblesse ; où des listes « d’ennemis » étaient dictées au téléphone ; où des appels étaient passés à des parrains et alliés étrangers tandis que des corps gisaient à proximité ; où une peur factice de « l’eau empoisonnée » remplaçait la compassion humaine élémentaire ; et où des figures religieuses arrivaient non pour consoler, mais pour sanctifier. Et l’archevêque était là.
Agathe Kanziga ne s’est pas comportée comme une veuve brisée par la tragédie. Elle a agi comme une actrice politique veillant à la continuité du pouvoir et à l’exécution de la vengeance. Des noms furent prononcés. Des ordres furent suggérés, et les conséquences suivirent. Cette même nuit, ou à l’aube, ceux qui avaient été désignés seraient morts.
Peut-être rien n’illustre plus crûment l’effondrement moral que la présence, et le comportement, de religieuses catholiques au sein de ce cercle. Imaginez simplement que des sœurs, voilées de blanc, célèbrent et que la mort devienne eucharistique. La religion, dépouillée de toute éthique, devient une arme. Les témoignages rapportent des prières non pour la paix, mais pour l’extermination des ennemis ; non pour la retenue, mais pour davantage d’armes. Depuis les cuisines, la chapelle et les couloirs s’élevaient des proclamations prônant l’élimination de tous les Tutsi, prononcées avec désinvolture, comme si l’on parlait des festivités de Pâques.
Ce n’était pas la foi. C’était un génocide liturgique. Imaginez encore : lorsque les annonces de morts étaient reçues, il n’y avait ni silence, ni larmes, ni effroi, mais des acclamations, de l’alcool et des célébrations. Les noms des opposants assassinés étaient accueillis avec joie. Le champagne remplaçait le deuil. La bière sanctifiait le meurtre. Si cela n’est pas une école de criminalité, qu’est-ce donc ?
Le comportement de Jean-Luc et de sa sœur n’était pas un accès de rage spontanée. C’était une idéologie apprise. La haine ne fleurit pas du jour au lendemain.
Elle se cultive, se raffine, se normalise et se récompense. Lorsqu’une famille réagit à un assassinat politique par des listes, des célébrations et des prières instrumentalisées, nous ne sommes pas témoins du deuil, nous sommes témoins de l’intimité domestique du pouvoir génocidaire.
Et pourtant, en décembre 2025, on nous demande, calmement, avec assurance, de croire que cet homme était un ange. Qu’il aimait son peuple. Qu’il favorisait ceux qui allaient bientôt être traqués, mutilés et effacés.
On peine à imaginer un journaliste allemand recevant un invité déclarant qu’Hitler aimait les Juifs et promouvait leur prospérité, sans indignation, sans conséquence, sans disgrâce professionnelle. Et pourtant, lorsqu’il s’agit du génocide contre les Tutsi, le seuil de l’indignation s’effondre.
Le double standard n’est pas accidentel. Il est racial. Il est géopolitique. Et il est dangereux. Ce texte n’est pas une salle d’audience, mais un espace moral. Et dans cet espace, certaines affirmations, comme celles prononcées par Mukangemanyi, ne peuvent rester sans contestation.
Habyarimana n’était pas un ange, mais le mal. Il était l’incarnation emblématique et structurelle des vices cardinaux. Il gérait un système qui transformait le sectarisme en politique et la politique en extermination.
Le louer aujourd’hui n’est pas simplement une erreur. C’est une insulte aux morts, une trahison des vivants et une invitation à la répétition.
Un mot pour Mukangemanyi et Gatanazi
Louer Juvénal Habyarimana comme un homme moralement irréprochable n’est pas une opinion anodine. C’est une blessure morale infligée en public.
C’est insoutenable, non parce que cela choque, la négation du génocide contre les Tutsi a appris à murmurer, mais parce que cela demande aux auditeurs d’avaler le poison poliment. Lorsqu’un génocidaire est loué pour son amour, ses soins et sa vertu, le génocide contre les Tutsi lui-même est silencieusement requalifié en un style de gouvernance qui serait allé « un peu trop loin », mais qui, dans l’essence, resterait respectable et acceptable.
Soyons clairs : admirer Habyarimana n’est pas un discours neutre. C’est un blanchiment de politique. Cela transforme un système qui préparait l’extermination en une administration mal comprise. Cela invite le public à confondre un comportement calme avec une substance éthique, et une rhétorique paternelle avec l’innocence morale. C’est ainsi qu’un crime horrifique comme le génocide est réhabilité, non pas en niant le résultat, mais en sanctifiant le principal architecte.
Pour les survivants, entendre cela n’est pas simplement offensant ; c’est viscéral. Cela revient à leur dire que la logique qui a conduit des personnes à être marquées pour la mort était, au fond, bienveillante. Que l’exclusion était de la sollicitude. Que la haine militarisée était de la discipline. Qu’un État qui entraînait des milices, finançait des médias de haine et normalisait le ciblage ethnique avait simplement été mal interprété par l’histoire.
Mukangemanyi et Gatanazi, c’est dans cet abîme que vous plongez en louant un tel homme. Vous n’« apportez pas de nuance ». Vous supprimez les conséquences. Vous n’élargissez pas le débat ; vous effondrez l’éthique. Lorsque vous qualifiez un génocidaire de juste, vous ne l’élevez pas, vous dégradez le sens même de la vertu.
C’est pourquoi un tel éloge apparaît comme indiscernable d’un éloge du génocide en tant que « bonne politique ». Car le génocide ne tombe pas du ciel ; il découle de choix de gouvernance, d’investissements idéologiques et d’autorisations morales. Applaudir l’homme, c’est excuser la machine. L’histoire ne demande pas votre admiration. Elle exige votre honnêteté. Et l’honnêteté commence là où s’arrête l’éloge.
Le fait qu’Adeline Mukangemanyi et Étienne Gatanazi soient eux-mêmes des survivants du génocide ajoute une absurdité tragique frôlant le surréel. La survie y est réutilisée comme un certificat, non pas de vigilance, mais d’absolution. Comme si échapper au feu autorisait désormais à louer l’incendiaire.
Le traumatisme, au lieu d’aiguiser la clarté morale, est mobilisé comme un bouclier contre la critique, preuve que même la mémoire, si elle est négligée, peut trahir la vérité.
Nous devons rester vigilants
La propagande de la chaîne Real Talk avec Adeline Mukangemanyi nous montre comment et pourquoi la négation du génocide ne crie plus toujours. Oui, parfois, elle sourit simplement.
Elle se présente sous la forme de nostalgie, de mémoire sélective, de biographies aseptisées et de louanges détachées de toute structure. Louer Habyarimana aujourd’hui n’est pas débattre de l’histoire. C’est former de futurs idéologues dans l’attente d’une absolution posthume.
Notre mémoire forte et engagée de notre passé est notre salle de classe quotidienne contre l’amnésie. L’histoire n’enregistre pas seulement ; elle instruit. Lorsque l’oubli s’installe, le bon sens est la première victime, suivi de près par le raisonnement moral. La louange de Habyarimana n’est pas un simple écart isolé, c’est un programme de l’oubli, un syllabus où le pouvoir est pardonné, les victimes reléguées en arrière-plan et la responsabilité déclarée inconvenante.
Dans de telles salles de classe, le génocide devient un malentendu, l’idéologie un différend d’opinion et l’extermination un excès malheureux plutôt que l’aboutissement logique de politiques et de préparations. Le confort remplace la clarté. La sentimentalité éclipse les preuves. Et la leçon la plus dangereuse est transmise : le temps lui-même absout le crime.
Se souvenir honnêtement est donc une discipline éthique. La mémoire doit rester inconfortable, car le confort est exactement ce que cherchent les auteurs, et leurs réhabilitateurs. Lorsque les sociétés récompensent la louange plutôt que la vérité, elles forment de futurs criminels à attendre une réhabilitation par le récit plutôt que par la responsabilité.
C’est pourquoi la clarté historique n’est pas vengeance ; elle est prévention. Refuser les faux anges, c’est protéger l’avenir. Insister sur la vérité amère sans anesthésie, c’est enseigner que le pouvoir ne rachète pas le crime, que la piété ne purifie pas l’idéologie, et qu’aucun éloge prononcé avec douceur ne peut ressusciter la vertu à partir de l’architecture de la mort.


















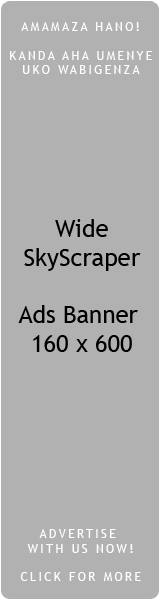
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!