Ce qui s’est produit dans les communes de Kayove, Ramba, Gaseke - ainsi qu’à Rutsiro - n’avait rien de spontané ni d’improvisé. Il s’agissait de l’issue prévisible d’un climat politique délibérément entretenu par ceux qui détenaient l’autorité, où la rhétorique de déshumanisation visant les Tutsi, la complicité administrative et l’inaction stratégique se sont conjuguées pour produire ce que les survivants ont ensuite vécu comme un chaos organisé.
Le rapport soumis le 6 janvier 1993 par le Dr Augustin Iyamuremye, alors chef du Service de renseignement, au Premier ministre Dr Dismas Nsengiyaremye, constitue une accablante mise en cause de cette complicité. Il documente, avec des dates, des lieux, des noms et des reconnaissances internes, l’ampleur des informations disponibles, les responsables qui en avaient connaissance, et l’absence de mesures prises.
Rédigé dans le langage sobre de la correspondance administrative, le rapport détaille l’insécurité, les attaques ciblées, les pillages organisés et la persécution systématique des populations tutsi dans les communes de Ramba, Gaseke et Kayove, dans la préfecture de Gisenyi, ainsi que dans la commune de Rutsiro, dans la préfecture de Kibuye.
Le rapport ne spécule pas ; il consigne les faits. Il n’exagère pas ; il documente. Mais son importance ne réside pas seulement dans ce qu’il révèle, elle tient aussi à ce qui a suivi - ou, plus exactement, à ce qui n’a pas suivi. Le président a été informé. La chaîne de commandement a été alertée. Aucune action significative n’a été entreprise. Dans de telles circonstances, l’inaction cesse d’être neutre.
Les événements décrits dans le rapport sont revisités avec un niveau de détail minutieux, car les détails comptent. Les dates comptent, parce qu’elles révèlent les enchaînements et les intentions. Les noms de lieux comptent également, car la violence est toujours locale avant de devenir nationale. Les noms des responsables comptent enfin, parce que l’impunité n’est pas une abstraction : elle est exercée par des hommes identifiables, occupant des fonctions précises.
Le 15 novembre 1992, le président Juvénal Habyarimana s’est adressé à des foules à Ruhengeri, reprenant les thèmes de l’ennemi intérieur et de la trahison. Une semaine plus tard, le 22 novembre 1992, Léon Mugesera poussera cette logique jusqu’à son paroxysme grotesque à Kabaya. Son appel à renvoyer les Tutsi « en Éthiopie par le Nyabarongo » ne relevait pas d’un dérapage isolé, mais constituait la cristallisation d’un discours déjà en circulation au plus haut niveau du pouvoir. Mugesera a nommé des ennemis, désigné des cibles et annoncé une violence à venir avec une clarté glaçante. Lorsque de tels propos restent impunis - et plus encore lorsqu’ils sont repris et banalisés - ils cessent d’être de simples paroles pour devenir des instructions.
Ces discours n’étaient pas des excès rhétoriques marginaux, prononcés en périphérie du pouvoir ; ils étaient des signaux émis depuis son cœur même. Ils n’ont pas seulement attisé les passions : ils ont fourni un vocabulaire, une logique et un sentiment d’autorisation. Des termes tels que inyangarwanda - « ennemis du Rwanda » -, inyenzi (« cafards ») ou encore « l’ennemi » ont été utilisés de manière interchangeable pour dépouiller les Tutsi de leur citoyenneté et de leur humanité, assimilant les civils à des combattants et transformant les voisins en cibles.
Dans un tel climat, les autorités locales n’avaient nul besoin d’ordres écrits explicites pour agir. Le signal était compris. Les paroles prononcées au centre irradiaient vers l’extérieur, modelant les attentes dans les communes et secteurs voisins. La violence est ainsi devenue pensable, puis permise, avant de s’installer dans la routine.
Dans ce contexte, des décisions administratives telles que l’organisation d’un Umuganda le 28 décembre 1992 dans la forêt de Gishwati, officiellement présenté comme une mesure de sécurité, ont pris une signification bien plus sinistre.
Ce qui suit est une reconstitution et une analyse détaillées du déroulement des événements : comment les alertes ont été émises puis ignorées, comment des agents de l’État ont reconnu l’existence de risques tout en poursuivant leurs actions, et comment l’absence d’intervention décisive a, de fait, constitué une forme d’aval. L’objectif n’est pas uniquement historique. Il est moral et politique : démontrer que la violence de masse est toujours précédée par la connaissance, et que le silence face à cette connaissance n’est jamais neutre.
Le ’où’ et le ’quand’ de la violence
Selon le rapport du Dr Iyamuremye, la première flambée de violences s’est produite le 28 décembre 1992, précisément le jour prévu pour un Umuganda improvisé dans la forêt de Gishwati. Ce matin-là, des troubles à caractère ethnique ont éclaté dans la cellule de Gihira, secteur de Kayove, commune de Kayove, dans la préfecture de Gisenyi.
En l’espace de quelques heures, la violence a débordé les frontières administratives, atteignant les cellules de Kirwa, Karuruma et Ruhanga, dans le secteur de Bwiza de la commune de Rutsiro, également située dans la préfecture de Kibuye. Le même jour, des attaques ont été signalées dans le secteur de Rwili, commune de Gaseke, en préfecture de Gisenyi.
La simultanéité de ces foyers de violence, répartis entre plusieurs communes et préfectures, suffit déjà à ébranler toute thèse de conflits locaux spontanés.
Le 29 décembre 1992, les violences se sont intensifiées et étendues. De nouveaux incidents ont été enregistrés dans les secteurs de Boneza et de Busanza de la commune de Kayove, dans le secteur de Bayi de la commune de Ramba, dans le secteur de Magaba de la commune de Gaseke, ainsi que dans la cellule de Remera du secteur de Gitebe, commune de Rutsiro.
Le rapport souligne que « partout, il s’agissait d’attaques menées par des groupes de Hutu qui ont incendié ou détruit les habitations des Tutsi, en particulier des Abagogwe, massacré ou pillé leur bétail, et saisi leurs biens ainsi que leurs réserves alimentaires ».
Il ne s’agit pas d’un langage vague. Le texte identifie clairement les auteurs comme des « groupes de Hutu », les victimes comme des « Tutsi, en particulier les Abagogwe », et les actes comme relevant de l’incendie, du pillage et de la destruction des moyens de subsistance. Ces faits ne relèvent ni du vandalisme aléatoire ni de la criminalité ordinaire. Ils constituent une entreprise ciblée d’anéantissement économique et social. Ils correspondent, point par point, à ce que le droit international reconnaîtra ultérieurement comme des méthodes de destruction ethnique.
Au 30 décembre 1992, le bilan humain ne pouvait plus être ignoré. Le rapport fait état de deux morts dans le secteur de Magaba, commune de Gaseke, à cette date, ainsi que d’un décès survenu le 28 décembre dans le secteur de Rwili, également dans la commune de Gaseke. Ces chiffres, précise l’auteur, demeuraient provisoires, les évaluations complètes étant rendues difficiles par le caractère à la fois sporadique et étendu des attaques.
Dans la seule commune de Kayove, la première journée a vu l’incendie de cinq maisons dans le secteur de Kayove, des dégâts touchant sept ménages dans le secteur de Boneza, et deux ménages affectés dans le secteur de Busanza. À Gaseke, outre les décès, de nombreuses habitations ont été incendiées et plusieurs vaches pillées. À Ramba, les vols de bétail ont constitué la forme principale des exactions, tandis qu’à Rutsiro, notamment dans le secteur de Bwiza, les affrontements ont fait trois blessés, entraîné le pillage d’environ dix vaches et d’une centaine de chèvres dans le secteur de Gitebe, ainsi que la destruction d’au moins une maison.
Le piège de l’Umuganda
Le rapport retrace la genèse de ces événements au 23 décembre 1992, date à laquelle le bourgmestre Isidore Maburakindi, de la commune de Kayove, a parcouru la commune afin de mobiliser la population pour l’Umuganda prévu le 28 décembre dans la forêt de Gishwati.
Lors d’une réunion tenue au marché de Gihira, dans le secteur de Kayove, à laquelle participaient de nombreux habitants abagogwe en raison de la proximité du lieu, Maburakindi déclara que « tous les hommes iraient aider les soldats venus de Gisenyi à fouiller la forêt de Gishwati afin d’y rechercher des inyangarwanda susceptibles de s’y cacher ».
Interrogé ultérieurement, Maburakindi a reconnu avoir employé ce langage, justifiant l’opération par l’insécurité qui aurait régné dans la forêt en octobre 1992, lorsque quatre corps non identifiés y avaient été découverts. Aucune enquête ne fut toutefois menée sur ces décès.
Ces corps, précise le rapport du Dr Iyamuremye, avaient été enterrés par la commune, et l’affaire portée devant le Conseil préfectoral de sécurité, lequel décida d’organiser une opération de fouille de la forêt. Fait crucial, Maburakindi ajouta que ce Conseil, craignant que la population ne se livre à des pillages ou à des massacres de Tutsi - comme cela s’était produit lors d’une précédente opération à Gishwati en 1991 - avait décidé que des soldats participeraient à l’Umuganda afin de « surveiller efficacement » la population.
Cet aveu constitue l’un des éléments les plus accablants du rapport : les autorités anticipaient la violence, anticipaient les massacres, et ont pourtant procédé à une mobilisation qui devait, de manière prévisible, produire exactement ce qu’elles prétendaient redouter.
À la suite de la réunion de Gihira, des rumeurs se sont rapidement propagées selon lesquelles l’Umuganda servirait de couverture à un massacre des Tutsi abagogwe. Après cette réunion, une rumeur a circulé, consignée mot pour mot par les services de renseignement. Certains habitants hutu se réjouissaient ouvertement, déclarant : « abategetsi batanze ubunani. »
La traduction de cette expression est explicite : « Les autorités ont offert un cadeau de Nouvel An. » Ce « cadeau » n’avait rien de symbolique. Il était matériel. Il s’agissait de l’autorisation de piller les biens des Tutsi - bétail, récoltes, maisons et réserves alimentaires - à quelques jours seulement du passage à la nouvelle année. Le rapport précise que les Hutu se réjouissaient parce qu’ils anticipaient un bénéfice économique tiré de la violence.
La référence à « abategetsi batanze ubunani » révèle une autre dimension fondamentale de ces violences : la récompense matérielle. Le pillage du bétail et des récoltes des Tutsi n’était pas accessoire ; il était central. En permettant aux auteurs de s’enrichir, les autorités ont transformé la violence en opportunité. La participation promettait non seulement une satisfaction idéologique, mais aussi un gain tangible.
Cette dynamique a renforcé l’implication populaire. Les habitants ordinaires, attirés par la perspective du butin et rassurés par l’indifférence officielle, sont devenus complices. La violence s’est propagée non pas parce que tout le monde était radicalisé idéologiquement, mais parce que les coûts étaient faibles et les bénéfices immédiats. « Abategetsi batanze ubunani » constitue un éclairage essentiel : la violence génocidaire était incitée par des avantages matériels, et non simplement idéologisée. La dépossession était un motif, et non un simple sous-produit.
Le dimanche 27 décembre 1992, trois émissaires abagogwe de Kayove - Kidonga, Nyagasaza et Buhirike - se rendirent auprès du bourgmestre Maburakindi pour exprimer leurs craintes et questionner explicitement l’Umuganda prévu. Maburakindi a ensuite confirmé que cette réunion avait eu lieu, affirmant avoir écarté leurs préoccupations comme des rumeurs inventées. Cela établit, sans l’ombre d’un doute, une connaissance préalable des événements.
Pourtant, lorsque des Abagogwe ayant trouvé refuge au bureau communal de Rutsiro déclarèrent, en présence de Maburakindi, qu’ils n’avaient jamais revu leurs émissaires, sa réponse fut terriblement évasive : « Si vous ne les avez plus vus, peut-être ont-ils fui… fui ailleurs, là où vous ne savez pas. »
Cette déclaration est révélatrice pour deux raisons : premièrement, elle manifeste une indifférence totale au sort de personnes qui venaient de signaler des attaques imminentes ; deuxièmement, elle suggère une normalisation des disparitions dans un contexte où la violence criminelle était déjà en cours.
Le même dimanche après-midi, rapporte le Dr Iyamuremye, l’unité militaire chargée de superviser l’Umuganda arriva à Kayove depuis Gisenyi. Ce soir-là : « Les Bagogwe commencèrent à confier leur bétail à des amis hutu et à fuir. » Ils se réfugièrent au bureau communal de Rutsiro. La fuite - et non la protection - devint la seule stratégie de survie rationnelle. On ne fuit pas un travail civique ; on fuit des attaques planifiées.
Échec ou complicité de l’État ?
Au 29 décembre 1992, 124 Abagogwe - 38 de Kayove et 86 de Rutsiro - se trouvaient réfugiés au bureau communal de Rutsiro. Ceux de Rutsiro ne retournèrent chez eux ou chez des voisins qu’au 30 décembre, après que le Préfet de Kibuye se soit personnellement rendu à Rutsiro pour garantir leur sécurité, accompagné d’un dispositif militaire. Le contraste entre cette intervention ponctuelle et l’inertie observée ailleurs est flagrant.
Parallèlement, le 30 décembre 1992, trente-sept Abagogwe du secteur de Bayi, dans la commune de Ramba, se rassemblèrent au domicile de Sebukufi, dans la cellule de Remera, secteur de Gitebe, commune de Rutsiro. Ce matin-là, des assaillants venus de Ramba lancèrent une attaque, pillant et détruisant la maison de Munyanganizi tandis que les Abagogwe observaient à courte distance, impuissants.
Une seconde attaque suivit le 31 décembre vers 14 h, cette fois menée par environ trois cents assaillants. Seule la résistance combinée des Abagogwe et des habitants hutu du secteur de Gitebe parvint à les repousser, laissant de nombreux blessés.
Le Dr Iyamuremye conclut que la perte de vies relativement limitée ne fut pas due à une protection efficace de l’État, mais à la prévoyance des Abagogwe, qui se regroupèrent et fuirent avant que la violence n’éclate. Il souligne que les attaques étaient menées par des groupes qui rencontraient parfois une résistance à la fois de civils hutu et tutsi, ce qui montre que le génocide est toujours un projet politique imposé à la société et non une expression inévitable de celle-ci.
Le rapport soulève des questions profondes sur le calendrier et l’intention. Pourquoi, après deux mois sans incidents dans la forêt de Gishwati, une opération de fouille fut-elle soudainement organisée avec seulement cinq jours de préavis ? Pourquoi impliquer la population civile dans une opération de sécurité, en connaissant parfaitement les risques, au lieu de déployer uniquement des forces professionnelles ? L’auteur note que tout malfaiteur supposé aurait eu amplement le temps de fuir. Ce qui ne put fuir, ce furent les civils marqués comme ennemis.
Lorsqu’un chef d’État est informé de violences ciblant un groupe spécifique et choisit de ne pas agir, cela ne peut être interprété comme de l’ignorance. En droit, en éthique et dans la réalité politique, le silence après notification constitue un aval. Cette inaction fonctionne comme une autorisation, renforçant chez les auteurs la conviction qu’ils sont protégés.
Tout était très clair. Aucune directive d’urgence n’a été émise. Aucun administrateur n’a été suspendu. Les tueurs n’ont pas été punis. Les biens pillés n’ont pas été restitués. Aucun auteur n’a été publiquement arrêté ou condamné. Il ne s’agissait pas de paralysie politique. Il s’agissait d’acquiescement.
Le nombre limité de décès constatés ne résulte pas de la protection de l’État, mais du fait que les victimes ont fui à l’avance et que, dans certaines zones, des voisins hutu ont résisté aux assaillants. Ici, la survie dépendait du hasard et de la solidarité, non de la loi.
Ce qui s’est passé à Kayove, Ramba, Gaseke et Rutsiro démontre comment le langage, l’administration et l’impunité interagissent pour produire la violence de masse bien avant son expression la plus catastrophique. Les noms de Gihira, Kirwa, Karuruma, Ruhanga, Boneza, Busanza, Bayi, Magaba, Rwili, Remera et Gitebe doivent être prononcés, car ils ne sont pas des notes de bas de page ; ils sont les premiers chapitres d’une histoire qui culminera en 1994. Les noms des responsables - Isidore Maburakindi, Léon Mugesera, Juvénal Habyarimana - doivent être retenus non comme des abstractions, mais comme des acteurs dont les paroles et les silences ont façonné la réalité.
Ce que ce rapport du Dr Iyamuremye met en lumière n’est pas seulement un échec, mais un choix. Les autorités savaient. Elles anticipaient la violence. Elles en avertissaient en interne. Et pourtant, elles ont poursuivi, retardé, minimisé ou ignoré. Les tueurs ont bénéficié de l’impunité non parce que l’État était absent, mais parce qu’il était présent de la mauvaise manière - en mobilisant, en envoyant des signaux, puis en détournant le regard.
Se souvenir de ces détails, c’est résister à l’effacement sur lequel repose l’impunité. C’est affirmer que le génocide ne commence pas par le meurtre, mais par l’autorisation, et que cette autorisation est toujours traçable à ceux qui avaient le pouvoir de dire non et ont choisi de ne pas le faire.
La violence de décembre 1992, documentée par le Dr Iyamuremye, n’était pas une anomalie. Elle constituait une répétition générale, menée dans des conditions de préavis, d’incitation idéologique, d’incitation matérielle et de complicité administrative.
En janvier 1993 : le langage de l’extermination avait été normalisé. Les mécanismes de mobilisation génocidaire avaient été testés. Les limites de l’impunité avaient été établies et confirmées.
Et ceci n’est qu’un seul rapport !


















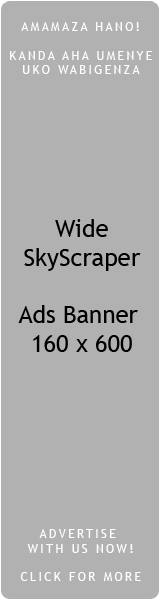
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!