L’une de ces voix feutrées est un rapport de renseignement daté du 21 novembre 1991, rédigé à Kigali, adressé au G2 (renseignement militaire) de l’État-major des Forces armées rwandaises, et signé par le commandant BUJYAKERA J., officier de renseignement à l’État-major des Forces armées rwandaises (EM AR). Il est le produit d’une mission menée par le commandant BUJYAKERA lui-même et le sous-lieutenant GASIMBA, conformément aux ordres référencés comme Lettre n° 038/G3.3.1.0 du 31 août 1991, émanant du chef des opérations (G3) de l’État-major de la Gendarmerie nationale.
Ces détails comptent, car ils établissent l’intention, la hiérarchie et la continuité institutionnelle. Il ne s’agit pas d’une diatribe d’ivrogne, ni d’un tract introduit clandestinement sur un marché. Ce n’est même pas le fantasme d’un officier isolé. Il s’agit d’un travail de renseignement prévisible, consigné, référencé et archivé.
Et il s’ouvre sous l’ombre d’une idéologie qui avait déjà été normalisée.
Le cadre intellectuel et moral du rapport est résumé dans une phrase placée en exergue : « Les Forces armées rwandaises doivent être exclusivement hutues. L’expérience de la guerre d’octobre 1990 nous l’enseigne. Aucun soldat ne doit épouser une femme tutsie. »
Cette formule au ton de décret ne provient pas du rapport lui-même. Elle est tirée de Kangura n° 6, publié en décembre 1990, dans les tristement célèbres « Dix commandements du Hutu ». Il s’agit du commandement n° 7.
Ce contexte est esssentiel. Kangura n’était pas un bulletin marginal. Il était publié par Hassan Ngeze, mais en tant qu’opérateur des principaux idéologues du Hutu Power. Kangura circulait largement, était lu dans les bureaux du gouvernement, cité par des responsables, et fut plus tard versé au dossier du TPIR comme un instrument direct d’incitation au génocide. Les Dix commandements n’étaient pas des descriptions ; c’étaient des instructions.
En novembre 1991, le commandement n° 7 avait migré, de manière impeccable, de la propagande à la pratique. Le rapport n’en débat pas. Il le met en œuvre.
L’armée sous Juvénal Habyarimana, selon cette logique, n’était plus une institution nationale. Elle devenait un sanctuaire ethnique. Le mariage n’était plus une affaire privée. C’était une faille de sécurité. L’ethnicité d’une femme devenait un vecteur d’infiltration. Voilà comment l’idéologie devient administration.
L’objectif déclaré de la mission ne pouvait être plus clair : « enquêter sur l’appartenance ethnique des officiers de la Gendarmerie nationale cités dans la lettre de référence, lesquels, selon des rumeurs, étaient considérés par la troupe comme appartenant au groupe ethnique TUTSI et seraient dès lors de possibles complices des INYENZI (IBYITSO). »
Plusieurs choses se produisent dans cette seule phrase. Premièrement, la rumeur est élevée au rang de renseignement. Deuxièmement, l’identité tutsie est traitée comme une preuve prima facie de trahison et assimilée à la complicité. Troisièmement, l’injure dégradante « Inyenzi » - cafard, le terme utilisé par les extrémistes hutu pour déshumaniser les Tutsi - est intégrée dans un document officiel de renseignement sans guillemets, sans reconnaissance de culpabilité ni prise de distance.
La logique est circulaire et hermétique : si vous êtes tutsi, vous êtes suspect ; si vous êtes suspect, vous devez faire l’objet d’une enquête ; si vous faites l’objet d’une enquête, des preuves seront trouvées. La méthode d’investigation est révélatrice. Ces officiers n’ont pas examiné la conduite, la loyauté ou les actes.
Concernant les études sur le génocide, cela est connu sous le nom de criminalisation préventive : un groupe n’est pas puni pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’on imagine qu’il pourrait être capable de faire.
Les personnes visées par l’enquête sont nommées : le commandant de gendarmerie MURANGIRA ; le capitaine de gendarmerie NDEREYIMANA ; le lieutenant de gendarmerie RUTAYISIRE ; le lieutenant de gendarmerie KARERANGABO ; le sous-lieutenant de gendarmerie MUGABO ; le sous-lieutenant de gendarmerie NDAGIJIMANA et le sous-lieutenant de gendarmerie MPAKANIYE.
Ils ne sont accusés d’aucune insubordination. Ni de collaboration. Ni d’avoir divulgué des informations sensibles. Ils sont accusés d’exister de manière incorrecte et suspecte.
Enquêter sur le sang
La méthodologie d’enquête révèle à quel point l’État avait adopté le contrôle ethnique : « nous nous sommes rendus sur leurs collines d’origine… avons mené des entretiens avec la population locale, en particulier les personnes âgées… consulté les registres de recensement communaux… les dossiers des parents… les personnes partageant des liens familiaux (frères, oncles)… ainsi que les observations des autorités communales (bourgmestres, conseillers communaux). »
Selon le rapport, il ne s’agit pas de contre-espionnage. Il s’agit d’une surveillance généalogique. Les collines ne sont pas visitées pour examiner des comportements, mais pour interroger l’ascendance. Les personnes âgées ne sont pas consultées pour la mémoire, mais pour la classification. Les registres de recensement - déjà un outil colonial de racialisation - sont ressuscités comme preuves médico-légales.
Il s’agit d’un système purement raciste qui transforme l’identité politique en destin biologique. Ce rapport montre que cette transformation était pleinement en cours.
L’un des aspects les plus grotesques du rapport est son obsession pour les documents administratifs, en particulier les fiches de recensement. À propos du lieutenant RUTAYISIRE, les enquêteurs écrivent : « sur ladite fiche de recensement, les mentions ‘HUTU, TUTSI, TWA’ étaient toutes biffées : ‘HUTU et TWA’ avec un stylo, ‘TUTSI’ avec un autre stylo. »
Cela est présenté comme une preuve médico-légale. Les différents stylos racontent une histoire. L’un est innocent ; l’autre est criminel. Ce détail n’est pas accessoire. Il est traité comme probant.
Le stylo devient témoin. L’encre devient intention. Les enquêteurs concluent : « Cela nous amène à croire que la mention TUTSI a été biffée au moment où sa carte d’identité a été falsifiée. » Le fait de rayer « TUTSI » devient une tentative d’évasion, une évasion carcérale bureaucratique.
Ce qui est criminalisé ici n’est pas la fraude dans l’abstrait, mais la tentative d’échapper à la persécution ethnique. Lors des pogroms antérieurs au Rwanda - 1959, 1963-64, 1973 - de nombreux Tutsi ont modifié ou dissimulé leur identité pour survivre. Ce rapport transforme rétrospectivement la survie en subversion. L’identité individuelle devient une marchandise de contrebande.
Le rapport redéfinit l’extrémisme. Le cas du commandant MURANGIRA offre une véritable leçon d’inversion idéologique. Son père est racialement et idéologiquement acceptable : « Son père est un HUTU bien connu dans sa région. »
Mais sa mère ne l’est pas : « la mère du Cdt MURANGIRA est TUTSI, issue d’une famille plus ou moins aisée et extrémiste. » Qu’est-ce qui rend cette famille extrémiste ? « … cette famille avait intenté un procès vers 1964 contre des personnes qui les considéraient comme HUTU. »
Autrement dit, défendre son identité devant un tribunal est rétroactivement classé comme de l’extrémisme. La pauvreté est l’innocence ; la richesse est suspecte. Le silence est la loyauté ; l’affirmation de soi est un danger. Arrêtons-nous un instant. Au lendemain des pogroms de 1959 et des massacres de 1963-64, défendre son identité devant la justice était un acte de courage.
Vient ensuite le mariage : « l’épouse du Cdt MURANGIRA est TUTSI. Tout cela peut influencer le comportement et les tendances de cet officier. » Imaginez ! Le mariage n’est plus un choix intime. C’est une fuite idéologique. L’épouse devient une preuve.
Quand le corps trahit
Si les documents du dossier ne parviennent pas à condamner, alors le corps doit témoigner. Dans le cas du capitaine NDEREYIMANA, le rapport concède : « Toutes les informations recueillies à son sujet indiquent qu’il est HUTU. »
Mais la certitude est intolérable. La méfiance et la suspicion extrême doivent être maintenues. La morphologie. La structure osseuse devait être présentée comme contre-preuve. Le corps trahit le dossier. Et lorsque la généalogie devient dangereusement floue, le langage se fait évasif.
Ainsi les enquêteurs examinent sa mère : « sa mère présente une morphologie tendant vers le type TUTSI, bien qu’elle soit inscrite comme HUTU sur sa fiche de recensement. »
Il s’agit d’une science raciale sans instruments. L’anthropologie est réduite au regard. C’était l’imaginaire racial colonial réemballé par des bureaucrates postcoloniaux.
L’histoire sexuelle d’un individu devient également une preuve : « après le décès du père de NDEREYIMANA, sa mère a eu d’autres enfants, tous nés de pères TUTSI. »
De là, le rapport tire sa conclusion : « sa mère manifeste une tendance TUTSI à travers ses partenaires. » L’ethnicité devient contagion et désir. Le désir lui-même acquiert une direction ethnique. Le désir devient culpabilité. La culpabilité devient héréditaire.
Pour maintenir l’anthropologie raciale au sein de l’armée, les tribunaux devinrent des champs de bataille ethniques. Le rapport indique que le lieutenant KARERANGABO a cherché réparation en justice. Le rapport ne le nie pas. Il le pathologise.
Selon les enquêteurs, le Lt KARERANGABO s’est rendu au tribunal : « par crainte de NE PAS être renvoyé des FAR pour avoir falsifié sa carte d’identité. »
La justice n’est pas présentée comme un droit, mais comme une tactique d’évasion. Lorsque le tribunal statue en sa faveur, l’explication est révélatrice : « le procureur est lui-même TUTSI, de même que ses adjoints. » L’implication est évidente. La justice a une ethnicité. Et elle est suspecte.
La correction proposée est inquiétante : « s’il y avait un substitut du procureur HUTU … le tribunal devrait être amené à réviser le jugement. » Il ne s’agit pas d’un appel à abolir les tribunaux. Il s’agit d’un appel à les aligner ethniquement. C’est le moment où le droit se plie pour servir l’exclusion.
Le rapport se conclut avec une netteté bureaucratique, en joignant des lettres, des fiches de recensement et des annexes : « J’attache à la présente note la lettre n° 112/04.05/1 du préfet de KIBUNGO … ainsi que des copies des fiches de recensement établies en 1982 et en 1988. »
Tout est en ordre. Tout est documenté. Et c’est peut-être l’aspect le plus terrifiant du document : sa normalité. Il n’y a ici ni colère. Ni hystérie. Ni soif de sang. Seulement la procédure.
Raul Hilberg, dans son étude de l’Holocauste, avertissait que le génocide n’est pas d’abord l’œuvre de fanatiques, mais de bureaucrates. Ce rapport est un chef-d’œuvre de bureaucrate. Le rapport de BUJYAKERA n’était pas un signal d’alarme. C’était un rapport d’étape, car le génocide ne commence pas avec les tueries. Il commence lorsqu’une société accepte que certaines personnes doivent être en permanence expliquées, classifiées, suspectées et corrigées - et que ce travail est administratif, rationnel, voire patriotique.
Pratiquer le génocide
Le document ne crie pas. Il n’incite pas au son des tambours ni des slogans. Il mesure. Il inspecte. Il raye des cases avec des stylos différents. Il scrute des pommettes, interroge des mères, dissèque des mariages et parcourt des arbres généalogiques comme un expert-comptable médico-légal du sang. Et ce faisant, il révèle une société déjà régie par des tendances génocidaires, bien avant que le génocide n’ait besoin d’être nommé.
Il ne s’agit pas d’une opinion griffonnée dans une marge. C’est un principe opérationnel. L’armée n’est plus une institution nationale ; elle est une enceinte ethnique. Le mariage lui-même devient une menace pour la sécurité. L’amour et l’union conjugale sont reclassés comme infiltration.
Ce rapport a été soumis près de deux ans et demi avant le génocide perpétré contre les Tutsi. Pourtant, l’architecture du génocide est déjà complète : l’ethnicité comme destin, les tribunaux comme fronts ethniques et la survie comme crime.
Aucune machette n’apparaît ici. Aucune milice. Aucun ordre de mise à mort. Seulement des dossiers, des collines, des anciens et des « tendances ». Mais le génocide ne commence pas par les tueries. Il commence lorsqu’un État décide que certains citoyens doivent être en permanence expliqués, surveillés, corrigés et purifiés - et que ce travail est patriotique.
Ce rapport n’est pas un signal d’alarme. C’est une répétition. Et comme toutes les répétitions, elle nous dit exactement ce que les acteurs ont l’intention de faire lorsque le rideau se lèvera enfin.
Suspects pour toujours
Le 20 février 1993, alors que le Rwanda se rapprochait de la catastrophe, le colonel Déogratias NSABIMANA, chef d’état-major des Forces armées rwandaises, adressa une lettre apparemment routinière au ministre de la Défense nationale. Son objet semblait anodin : « Accès aux installations militaires. » Ses implications ne l’étaient pas.
La lettre s’ouvre avec une courtoisie bureaucratique : « Monsieur le Ministre, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les nommés MUSHINZIMANA Théogène, KANYAMAHANGA KABANDANA et NSENGIMANA Jean de Dieu ont été désignés par le MINIFIN pour effectuer des inspections dans nos camps militaires. »
Il n’y a pas la moindre accusation d’acte répréhensible. Aucune référence à l’espionnage. Aucune allégation de violation du protocole. Ces hommes étaient des inspecteurs financiers civils, officiellement mandatés par le ministère des Finances pour réaliser des audits dans des camps militaires — une fonction parfaitement normale dans un État qui prétendait encore disposer d’un contrôle civil.
Puis vient le tournant. « Ces individus, dont les photocopies des cartes d’identité sont annexées, sont devenus suspects et N’INSPIRENT PLUS CONFIANCE, surtout en cette période de guerre contre les Inkotanyi. »
L’insistance n’est pas accidentelle. « Sont devenus suspects » appelle une question évidente : sur quelle base ? La lettre n’en donne aucune. Elle renvoie plutôt discrètement à l’annexe : les photocopies des cartes d’identité.
Ces photocopies révélaient une chose, et une seule : ils étaient tutsi. De ce seul fait découle la demande : « Pour cette raison, je sollicite votre intervention afin que ces trois individus soient remplacés par d’autres moins suspects. »
« Moins suspects » ne signifie pas plus qualifiés. Cela ne signifie pas plus discrets - ni plus dignes de confiance par leur conduite. Cela signifie d’une autre ethnicité. La suspicion n’est plus une conclusion tirée de preuves ; c’est une condition préchargée, activée par l’identité.
La lettre transforme ensuite cette logique en politique : « En outre, pour des raisons de sécurité de nos installations, toute personne appelée à y accéder devra d’abord être agréée par l’autorité militaire compétente. »
Il ne s’agit pas simplement de contrôle d’accès. Il s’agit d’une habilitation ethnique. Le contrôle civil est redéfini comme infiltration. L’audit devient espionnage. Les propres documents de l’État deviennent un filtre destiné à exclure les citoyens jugés intrinsèquement indignes de confiance.
Ce qui rend cette lettre troublante, c’est sa sérénité. Il n’y a ni colère ni emphase propagandiste. Juste une prose administrative qui met en œuvre une exclusion silencieuse. La guerre « contre les Inkotanyi » devient la justification universelle pour transformer l’identité tutsie en passif sécuritaire.
En février 1993, le Rwanda ne demandait plus ce que les gens faisaient. Il demandait ce qu’ils étaient - et considérait que la réponse suffisait.
C’est ainsi que les systèmes génocidaires mûrissent : pas toujours par les cris, mais par les notes de service ; pas toujours par la violence, mais par le refus de la confiance. Bien avant que l’on refuse la vie à des personnes, on leur avait déjà refusé l’accès, la crédibilité et l’appartenance.


















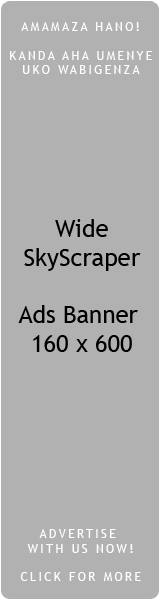
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!