Le 13 janvier 2026, l’un des relais de propagande de Kinshasa, Onésha Afrika, a publié un article au titre captivant : « L’héritage des orchidées : entretien exclusif avec Jean-Luc Habyarimana ». Pour quiconque étudie l’idéologie du génocide et son déni, ce texte n’est pas seulement révélateur ; il est instructif.
On se sent presque tenu de remercier Jean-Luc Habyarimana - non pour ses objectifs, mais pour sa franchise. Il dit tout haut ce que les idéologues du génocide expriment habituellement en code, à voix basse ou sous des formulations stratégiquement ambiguës. Il pratique le déni non comme une absence de mémoire, mais comme une conviction.
Ce qui suit n’est pas une indignation gratuite. C’est une dissection. Car le discours génocidaire ne fonctionne pas uniquement par des mensonges grossiers ; il opère par inversion morale, nostalgie sélective, naturalisation théologique du racisme et recyclage du ressentiment en droit politique. L’entretien de Jean-Luc Habyarimana en offre un cas d’école.
L’idéologie comme caractère, l’exil comme alibi
Jean-Luc Habyarimana déclare : « Je suis un homme de convictions, lent à les former, mais indéfectiblement loyal une fois que mon esprit est arrêté. »
Pris à la lettre, cela se veut un signe d’intégrité. En réalité, c’est un aveu. Non pas la conviction comme vertu, mais la conviction comme refus de toute révision éthique. Comme l’observait Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal (1963), le danger ne réside pas seulement dans le fanatisme, mais dans l’absence de pensée l’incapacité ou le refus d’interroger ses propres prémisses.
Jean-Luc approche de son cinquantième anniversaire. Pourtant, il se vante - indirectement - de convictions formées très tôt et jamais remises en question. À 18 ans, il aurait souhaité tirer sur la Première ministre Agathe Uwilingiyimana, pourtant déjà assassinée. Il ne s’agit pas là d’un excès adolescent, mais d’une socialisation idéologique précoce. Les étapes du génocide décrites par Gregory Stanton nous rappellent que l’endoctrinement précède la participation, et que la certitude morale précède souvent la violence physique.
Dans cette perspective, sa trajectoire ultérieure - son appartenance à Jambo Asbl, sa proximité ou son soutien aux FDLR, et son négationnisme génocidaire constant - n’a rien de surprenant. La « conviction » n’est pas ici une force morale ; elle est une rigidité idéologique sacralisée et présentée comme un trait de caractère.
Ce que Jean-Luc présente comme une fermeté morale constitue, d’un point de vue analytique, un système épistémique fermé. Les chercheurs qui étudient les systèmes de croyances extrémistes relèvent que ces acteurs transforment le doute en vice et la rigidité en vertu. Une fois que la « conviction » devient une identité plutôt qu’une conclusion, la preuve ne fonctionne plus comme un correctif, mais comme une menace.
Cela explique pourquoi les idéologues du génocide racontent souvent leur biographie comme une histoire d’éveil précoce : plus la croyance est ancienne, plus elle paraît pure. Dans cette logique, grandir devient une trahison et changer une déloyauté. L’autoportrait que dresse Jean-Luc accomplit donc un travail idéologique précis : il l’immunise contre toute responsabilité en requalifiant la stagnation morale en héroïsme éthique.
Jean-Luc Habyarimana affirme : « Mon exil n’est pas un choix. C’est une condition de survie. J’ai quitté le Rwanda parce que ma sécurité et mes droits de citoyen n’y étaient plus garantis - une réalité qui, loin de s’améliorer, s’est durcie avec le temps. » Cette phrase est l’une des plus révélatrices de l’entretien, car elle superpose deux discours en un seul, agencés pour induire en erreur.
Historiquement, sa famille a fui le Rwanda le 9 avril 1994, précisément le jour où le gouvernement intérimaire génocidaire - dirigé par Théodore Sindikubwabo - prêtait serment. Si l’exil était réellement une « condition de survie », la menace ne provenait pas de l’Armée patriotique rwandaise, comme le prétendent les génocidaires et leurs soutiens. Elle émanait de l’intérieur même du camp génocidaire, dans un contexte de luttes factionnelles autour de la responsabilité de l’attentat contre l’avion présidentiel.
Ici, le déni opère par inversion victime-bourreau, un mécanisme analysé en profondeur par Stanley Cohen dans States of Denial : Knowing about Atrocities and Suffering (2001). La famille du pouvoir fuit non parce que le génocide est en cours, mais parce que la proximité avec son orchestration devient dangereuse. La rhétorique de l’exil est un ressort classique du négationnisme post-génocide. Elle permet aux anciennes élites de requalifier la perte de l’impunité en persécution et le contrôle judiciaire en menace existentielle. Dans cette économie narrative, la survie n’est plus biologique mais politique : survivre, c’est échapper à la justice.
La formulation de Jean-Luc efface délibérément la chronologie, écrasant avril 1994 en un danger intemporel censé émaner du Rwanda d’aujourd’hui. Cet effondrement du temps est stratégique. Il dissout les relations de cause à effet pour leur substituer une victimisation permanente, ressource émotionnelle centrale de la nostalgie génocidaire.
Lorsque Jean-Luc Habyarimana affirme que « la réalité s’est durcie », il ne décrit pas une répression. Il déplore la reddition des comptes. La réalité s’est en effet durcie - contre le déni, contre la nostalgie déguisée en deuil, contre les lamentations théâtrales de ceux qui confondent la perte du pouvoir avec la perte de la paix.
Sa phrase suivante est donc cruciale, car elle expose en un souffle toute l’architecture du discours sur l’après-génocide : « Chaque jour, des Rwandais de tous horizons me contactent - nous contactent - pour exprimer leur sympathie envers -notre famille, mais surtout leur nostalgie d’une époque où la vie humaine avait de la valeur, où la paix n’était pas un slogan mais une réalité vécue. » Il s’agit d’un déni déguisé en sentimentalité, d’une idéologie adoucie comme une berceuse pour enfant. L’expression « des Rwandais de tous horizons » n’est pas descriptive ; elle est incantatoire, hypnotique. Elle fonctionne de la même manière que « le peuple » dans le discours autoritaire populiste : un chœur moral vague et invérifiable, convoqué pour remplacer les preuves. Pas de noms, pas de marqueurs sociaux - seulement un murmure imaginaire de l’approbation nationale, soufflé à l’oreille de l’héritier.
Mais soyons attentifs. Parmi ces appelants quotidiens, ces porteurs de nostalgie et de sympathie, on peut être sûr de qui est absent. Il n’y a aucun survivant du Génocide contre les Tutsi qui appelle Jean-Luc Habyarimana pour se remémorer le bon vieux temps. Il n’y a pas de veuves de Nyamata, pas d’orphelins de Murambi, pas de familles dont les proches ont été traqués, violés, mutilés et exterminés sous l’autorité du régime que sa famille incarnait et finançait. Les morts ne ressentent aucune nostalgie pour les bottes et les grenades qui les ont écrasés. Le monde social évoqué ici n’est pas le Rwanda ; c’est une chambre d’écho fermée de coupables, de complices, de fugitifs et de cousins idéologiques. Les oiseaux de même plume volent effectivement ensemble - surtout quand le nid lui-même est une scène de crime.
Il n’est pas nécessaire de spéculer avec excès. La sœur de Jean-Luc était mariée au fils de Félicien Kabuga, principal financier du génocide contre les Tutsi. Son oncle, Protais Zigiranyirazo, est un génocidaire reconnu. Sa tante, sœur Godelive Barushywanubusa, a fui la justice des Gacaca et reste en fuite. Ce ne sont pas des associations périphériques ; ce sont des généalogies de pouvoir, d’argent et de sang. Lorsque Jean-Luc parle de « notre famille », il n’invoque pas le lien du sang au sens sentimental ; il invoque un clan politique dont le traumatisme collectif n’est pas la perte de vies, mais la perte de l’impunité.
Et qu’est-ce exactement que ce « temps où la vie humaine avait de la valeur » qui suscite une telle nostalgie ? C’est là que la déclaration franchit la frontière entre le déni et la farce absurde. Un régime qui a institutionnalisé des quotas ethniques, orchestré des pogroms, normalisé l’exil, criminalisé l’existence tutsi, et finalement planifié et exécuté l’extermination d’un million de personnes est rétrospectivement couronné âge d’or de la paix. Ce n’est pas le révisionnisme historique habituel ; c’est de la nécromancie morale.
Dans Politics and the English Language (1946), George Orwell mettait en garde contre un langage politique conçu pour « faire paraître les mensonges véridiques et rendre le meurtre respectable ». Jean-Luc Habyarimana va plus loin encore : il rend le meurtre nostalgique. La paix, dans ce lexique, n’est pas l’absence de violence, mais l’absence de résistance. Sous la direction de son père, Juvénal Habyarimana, la vie humaine avait de la valeur, apparemment, à condition d’être hiérarchisée, comptabilisée et rendue jetable. C’est là une logique génocidaire classique : la vie est sacrée - pourvu qu’elle appartienne à la bonne catégorie.
La tristesse et la frustration qu’il dit éprouver ne sont rien d’autre que les résidus émotionnels d’un projet suprémaciste et génocidaire vaincu. Ce sont les larmes de ceux qui se sont réveillés dans un Rwanda où les Tutsi ne sont plus traqués, où l’État n’appartient plus à une faction « raciale » artificielle, où l’histoire refuse obstinément d’oublier. Leur douleur n’est pas celle d’une injustice subie, mais celle d’une injustice interrompue.
C’est pourquoi cette déclaration compte tant. Elle n’est pas anecdotique ; elle est diagnostique. Jean-Luc fournit, sans le vouloir, une ethnographie parfaite de la nostalgie génocidaire. Les appelants ne pleurent pas les victimes ; ils pleurent la perte de leur pertinence. Ils font le deuil de l’effondrement d’un ordre racial qui leur garantissait autrefois innocence morale, privilège politique et certitude métaphysique.
Parler ici d’« anesthésie psychologique » est indulgent. Il s’agit plus justement d’une pathologie de l’appropriation, où la perte de la domination est vécue comme un traumatisme existentiel. Que Jean-Luc présente cette pathologie comme un sentiment national n’a rien d’accidentel. Il ne nie plus le crime de façon frontale. Il déplore l’inconfort de sa remémoration.
Et c’est précisément pour cela que ce passage est le plus important de tout l’entretien. C’est ici que le déni cesse de feindre la confusion et se révèle pour ce qu’il est : une nostalgie dont le nombre de morts a été soigneusement effacé.
C’est le déni dans sa forme la plus pure - non pas le silence, mais la reconstruction affective. La nostalgie n’est pas la mémoire ; c’est une idéologie enveloppée de sentiment. Svetlana Boym, dans The Future of Nostalgia (2001), distingue la nostalgie réflexive de la nostalgie restauratrice, cette dernière cherchant à reconstruire un passé mythique tout en en effaçant la violence. La nostalgie de Jean-Luc est restauratrice et racialisée.
La nostalgie y remplit une double fonction : elle anesthésie le jugement moral tout en mobilisant le ressentiment. En esthétisant le passé, Jean-Luc invite le lecteur à compatir avant de penser. Les chercheurs en propagande soulignent que la résonance émotionnelle précède souvent la persuasion idéologique. Une fois que le lecteur pleure un passé fictionnalisé, il devient réceptif à sa restauration politique. C’est pourquoi la nostalgie est si centrale dans les après-génocides : elle transforme les bourreaux en témoins mélancoliques d’un Éden perdu, blanchissant ainsi la responsabilité historique par la sentimentalité.
Façade idéologique
Jean-Luc Habyarimana insiste sur le fait que son « engagement » envers le Rwanda n’est pas idéologique mais moral. C’est une manœuvre bien connue. L’idéologie - surtout celle qu’il chérit - a mauvaise réputation, en particulier lorsqu’elle a déjà conduit à des fosses communes. Il faut donc la blanchir, la reconditionner en devoir, de préférence parental.
Il déclare ainsi, avec une gravité solennelle : « En tant que père, je refuse de transmettre à nos enfants un héritage d’injustice banalisée, de mémoire confisquée et de conflits régionaux exportés. »
L’ironie est ici tout sauf subtile. Tout ce que Jean-Luc prétend rejeter est précisément ce qu’il reproduit, transmet et embaume. Mémoire confisquée ? Il nie la spécificité du génocide contre les Tutsi. Injustice normalisée ? Il aspire à un État racial. Conflits exportés ? Il soutient des forces comme les FDLR, dont l’existence même déstabilise la région des Grands Lacs.
L’héritage que ses enfants sont le plus susceptibles de recevoir n’est pas la justice, mais une ignorance soigneusement cultivée. Ils grandiront familiers du discours de haine, allergiques aux faits, et profondément protégés de la réalité selon laquelle leurs grands-parents paternels n’étaient pas des patriotes tragiques, mais des Interahamwe. On ne leur dira jamais que la maison d’enfance de leur père n’était pas une simple résidence familiale, mais un poste de commandement génocidaire - un lieu d’où irradiaient des ordres de mort avant que les forces françaises n’exfiltrent la famille vers la sécurité. La mémoire est bel et bien confisquée dans ce foyer - non par l’État rwandais, mais par le déni.
Le discours génocidaire se drape souvent dans le langage de la parentalité et de l’avenir. Comme le notent les chercheurs en analyse du discours, invoquer les enfants est une manière de blanchir moralement la haine : celle-ci est requalifiée en protection. La posture parentale figure parmi les tropes les plus cyniques de la rhétorique extrémiste. En invoquant les enfants, Jean-Luc désarme par avance toute critique : qui s’opposerait à un père agissant « pour l’avenir » ?
La rhétorique parentale de Jean-Luc ne vise donc pas à protéger les enfants ; elle vise à protéger la lignée. L’avenir qu’il imagine est celui d’une histoire réécrite afin de préserver l’innocence familiale. C’est la forme la plus familière du déni : non pas la propagande publique, mais la pédagogie domestique. Le génocide y est déformé, dilué, externalisé, jusqu’à devenir un malentendu malheureux survenu autour de la famille - jamais à cause d’elle.
Lorsqu’il affirme que des compatriotes lui demandent constamment « d’intervenir », « d’attirer l’attention du monde », nous revoilà pleinement dans le registre classique du messianisme Hutu-Power. « Ce lien permanent avec mon peuple m’ancre dans la réalité », dit-il. Il s’agit là d’une circonscription imaginaire, une technique prisée des démagogues pour substituer l’anecdote à la légitimité. « Mon peuple » ne désigne pas la nation ; il désigne le sujet politique ethnicisé de l’idéologie Hutu-Power.
La réalité, ici, est définie comme un circuit fermé d’affirmation ethnique. « Mon peuple » ne signifie pas citoyens ; il renvoie à une communauté morale imaginée de Hutu supposément lésés - éternellement victimes, perpétuellement ignorés, et à jamais autorisés à gouverner. Dans Imagined Communities (1983), Benedict Anderson avertissait que les nations sont des communautés imaginées. Les mouvements génocidaires, eux, imaginent quelque chose de bien plus étroit : une communauté raciale sanctifiée par le ressentiment.
Ce qui frappe n’est pas tant la revendication d’un soutien populaire que son imprécision. Aucun chiffre, aucune institution, aucun mécanisme vérifiable - seulement des voix, des murmures et des contacts permanents. Cette ambiguïté est délibérée. Elle permet à l’orateur d’occuper le centre symbolique d’une communauté impossible à contester empiriquement. Dans le discours génocidaire, la légitimité ne procède pas du consentement mais d’une authenticité ethnique présumée. Jean-Luc se positionne en réceptacle plutôt qu’en acteur, échappant ainsi à la responsabilité tout en revendiquant l’autorité.
Ce n’est pas de l’engagement ; c’est du ventriloquisme politique. Des voix anonymes parlent, et Jean-Luc interprète. Les liens affectifs sont transmutés en « responsabilité morale », laquelle ressemble opportunément à une autorité héritée. On y perçoit l’écho indéniable du règne de son père : le dirigeant comme traducteur de la souffrance ethnique, la nation réduite à un récit unique de grief, la dissidence disqualifiée comme manipulation étrangère. La différence est cosmétique. La grammaire, elle, est identique.
Son accusation selon laquelle le Rwanda d’aujourd’hui « repose sur une tragique instrumentalisation du génocide », produisant ce qu’il appelle « l’apartheid mémoriel », n’est pas une critique intellectuelle, mais une contre-mémoire idéologique. Ce concept est soigneusement conçu pour effacer toute asymétrie. Comme l’a souligné depuis longtemps Deborah E. Lipstadt, spécialiste du génocide et auteure de Denying the Holocaust (1993), le négationnisme contemporain ne nie que rarement la mort : il nie le sens, l’intention et la responsabilité. Jean-Luc fait exactement cela.
Bourreaux et victimes sont regroupés dans la même catégorie morale, l’histoire aplatie en chagrins concurrents. Il ne s’agit pas de réconciliation, mais de blanchiment moral. Le génocide devient une ressource rhétorique plutôt qu’un crime doté d’architectes, de financeurs et d’exécutants.
L’usage d’un vocabulaire émancipateur comme « apartheid » est avant tout méprisant. Il cherche à s’approprier le capital moral de la lutte anti‑raciste pour saper la mémoire du génocide. Cette transposition repose sur l’effacement des rapports de pouvoir : ceux qui ont organisé la violence se présentent comme des endeuillés marginalisés. Un tel discours ne convainc que si l’asymétrie historique est occultée - exactement l’objectif poursuivi par le déni.
Lorsque Jean-Luc affirme qu’« une partie de la population » est privée du droit de pleurer ses morts « massacrés dans les années 1990 », il exécute l’astuce centrale du négationnisme contemporain : transformer ceux tués pendant la guerre, la poursuite judiciaire ou l’effondrement d’un régime génocidaire en victimes équivalentes de l’extermination. Ici, l’intention disparaît. La planification s’évapore. La responsabilité se dissout. Il ne reste que le ressentiment sans culpabilité.
Son récit de l’invasion du 1er octobre 1990 par le FPR relève directement du catéchisme Hutu-Power. Pas de réfugiés. Pas de décennies d’exil. Pas de discrimination institutionnalisée. Juste un Rwanda paisible, cruellement perturbé par des envahisseurs avides de pouvoir. L’histoire est amputée dès qu’elle devient gênante.
Chaque affirmation a été contredite par des décennies de recherches, les archives et les dossiers du TPIR. Pourtant, le déni persiste, car, comme l’observait Zygmunt Bauman dans Modernity and the Holocaust (1989), le mal moderne est bureaucratique et répétitif. Il prospère dans la répétition et la mise en scène.
La répétition n’est pas redondance ; c’est une stratégie. Chaque réitération normalise le mensonge, surtout lorsqu’il est présenté dans un langage poli, adapté aux interviews. L’objectif n’est pas de convaincre les experts, mais d’épuiser l’attention du public, créant l’illusion d’une controverse là où règne un consensus académique. C’est le déni en tant que production de bruit.
Enfin, nous arrivons au fantasme du sauveur : « Le jour viendra où les exilés reviendront… au Rwanda sur des bases justes, humaines et durables. » Le langage est presque humanitaire. On s’attend à ce qu’une conférence de donateurs suive. Pourtant, sous ce velours se cache l’acier ancien : retour, refondation, purification morale. Jean-Luc ne s’imagine pas citoyen rentrant chez lui, mais rédempteur venu corriger l’histoire.
Il ne s’agit pas d’un devoir moral. C’est de la politique eschatologique, où l’héritier d’un ordre génocidaire se requalifie en alternative éthique. La tragédie est que le déni, lorsqu’il est poli et paternel, trouve encore des micros.
Le rêve de Jean-Luc Habyarimana d’un Rwanda couronné d’« une armée républicaine » qui « protège le peuple » mérite d’être lu non comme une vision politique, mais comme une archéologie linguistique. Chaque mot est emprunté, vidé de sens et réutilisé pour masquer un projet racial. Dans le lexique Hutu Power, « républicain » n’a jamais signifié neutralité civique, loyauté constitutionnelle ou protection des citoyens à égalité. Cela voulait dire quelque chose de bien plus létal : une armée de la majorité, pour la majorité, contre l’ennemi désigné à l’intérieur. Lorsque Jean-Luc parle du « peuple », il ne parle pas des Rwandais ; il parle des Hutu - ceux comptés, reconnus et protégés selon l’ancien système de comptabilité raciale.
L’histoire ne laisse ici aucune place à l’ambiguïté. L’armée que présidait son père était déjà « républicaine » dans ce sens : filtrée ethniquement, disciplinée idéologiquement et intégrée opérationnellement aux milices. Les Interahamwe n’ont pas émergé en opposition à l’armée ; ils en constituaient un bras auxiliaire. Invoquer aujourd’hui une « armée républicaine » n’est donc pas une nostalgie réformiste — c’est un retour en arrière, un désir d’un temps où uniformes et machettes parlaient le même langage.
Obscénité
Incapable de défendre cette vision sur le plan politique, Jean-Luc Habyarimana fait ce que les idéologues génocidaires ont toujours fait : il convoque Dieu. « On ne peut défaire ce que Dieu a établi. Hutu, Tutsi et Twa constituent l’identité du Rwanda. »
Ce n’est pas de la théologie ; c’est du fatalisme racial baptisé dans les Écritures. L’écho biblique paraphrasé - « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » (Matthieu 19:6, Marc 10:9) - est appliqué de manière profondément inappropriée. Un verset sur le mariage est enrôlé pour sanctifier une taxonomie raciale coloniale, comme si les ethnographes belges étaient des apôtres et les cartes d’identité des sacrements.
Ce n’est pas seulement blasphématoire ; c’est obscène. Ici, le racisme est naturalisé et sanctifié. Dieu devient le garant de la hiérarchie ethnique. C’est ce que les chercheurs en génocide appellent la légitimation cosmique. Dieu est réduit à un officier d’état civil ethnique et le génocide devient la défense de l’ordre divin.
Le langage théologique est particulièrement puissant car il interdit le débat. Si Dieu a décrété la hiérarchie, la contestation devient hérésie. Dans cette théologie, l’égalité est un sacrilège, l’unité nationale une rébellion contre Dieu, et la citoyenneté un affront à la création. Ce déplacement politique dans le domaine sacré l’immunise contre tout examen éthique.
Historiquement, cette sacralisation de l’identité a accompagné certains des pires crimes de masse, précisément parce qu’elle convertit le préjugé humain en nécessité divine. Une fois la différence déclarée sacrée, la hiérarchie s’ensuit inévitablement. C’est pourquoi Jean-Luc affirme que l’abolition des catégories ethniques « n’a jamais créé l’égalité ; elle a seulement déplacé les lignes de domination » : autrement dit, les mauvaises personnes ne sont plus au sommet.
Ce qu’il déplore ici n’est pas l’injustice, mais la perte d’un système efficace d’exclusion, de discrimination, de persécution et d’extermination. Le passé qu’il romantise est celui où la domination était claire, lisible et bureaucratiquement appliquée - où les cartes d’identité accomplissaient le travail moral de décider qui vivait et qui mourait. Sa nostalgie n’est donc pas abstraite ; elle est administrative. Elle aspire au retour d’un État capable de trier les corps avec précision.
Son admiration pour le Burundi suit la même logique. Il loue « l’honnêteté » consistant à reconnaître les composantes de la société, présentant l’arithmétique ethnique comme réalisme et l’unité comme déni. Mais ce qu’il appelle honnêteté n’est que l’institutionnalisation de la suspicion. Les cycles tragiques de violence au Burundi ne sont pas le fruit d’une reconnaissance ethnique insuffisante, mais de sa surpolitisation. Le modèle de paix de Jean-Luc est celui dans lequel les citoyens sont d’abord comptés, puis gouvernés - jamais dignes de confiance.
Pour lui, l’unité nationale est une anathème car elle dissout l’autorité héritée. L’unité signifie que le pouvoir n’est plus garanti par la naissance. L’unité exige la responsabilité. L’unité menace les dynasties bâties sur le ressentiment. Les différences, au contraire, sont « nobles » parce qu’elles sont utiles : elles peuvent être mobilisées, hiérarchisées, et utilisées comme armes.
L’ironie finale est presque insupportable. Dans l’entretien scénarisé, Jean-Luc affirme que son père était prêt à adhérer à l’Accord de paix d’Arusha. Pourtant, ce sont bien les Accords d’Arusha qui ont ordonné la suppression des cartes d’identité ethniques - ces mêmes instruments que les extrémistes du Hutu Power méprisaient précisément parce qu’ils gênaient l’extermination. Les cartes d’identité n’étaient pas symboliques ; elles étaient des outils logistiques du génocide. Détester leur abolition revient à pleurer la perte d’une infrastructure de meurtre efficace.
Jean-Luc ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. On ne peut pas louer Arusha tout en regrettant sa disposition la plus humanisante. On ne peut pas invoquer Dieu tout en défendant les hiérarchies raciales coloniales. On ne peut pas rêver d’« une armée républicaine » tout en aspirant à une force ethniquement purifiée.
La puanteur sous les orchidées
Pourquoi des orchidées ? Parce que le déni aujourd’hui est esthétique. Il recherche la beauté, le raffinement, la mélancolie poétique. Mais sous les orchidées se cache la même idéologie qui justifiait le meurtre de masse.
Jean-Luc Habyarimana n’a ni mal parlé ni exagéré. Il a révélé. Son entretien n’est pas une déviation ; il constitue une continuité - de la famille, de l’idéologie et de l’ambition politique. Jean-Luc Habyarimana n’invente pas un nouveau Rwanda ; il tente de ressusciter l’ancien - lavé dans les Écritures, parfumé de nostalgie, et présenté comme un renouveau moral. Mais l’histoire se souvient de ce qu’il souhaite rétablir. Et le Rwanda, ayant survécu, a choisi de ne jamais revenir en arrière. Irréversiblement.
La tragédie n’est pas que Jean-Luc ne voie pas cela. La tragédie est que des plateformes continuent de faire semblant que son discours relève d’un débat légitime plutôt que de ce qu’il est vraiment : l’après-vie polie de la pensée génocidaire.
Soyons impitoyablement clairs. Jean-Luc Habyarimana n’est pas un exilé incompris, un intellectuel nostalgique ou une conscience persécutée. Il est l’héritier d’une tradition politique trempée dans le sang, maintenant embaumée dans la métaphore. Ses orchidées ne sont pas des symboles de paix ; ce sont des décorations funéraires placées sur une tombe sans repentir. Il parle de valeurs humaines avec la sérénité de quelqu’un qui n’a jamais eu à rendre compte de qui comptait comme humain et de qui était déclaré excédentaire.
Il y a quelque chose d’à la fois amer et presque poétique à voir un homme invoquer Dieu, les enfants, la paix et la moralité pour défendre une vision du monde qui s’est effondrée sous le poids de ses propres crimes. Sa rhétorique ressemble à un musée de mensonges d’autrefois : soigneusement éclairé, soigneusement mis en scène, et complètement détaché de la réalité. Le Rwanda a avancé. Les survivants ont reconstruit. Les coupables ont été jugés. L’histoire a progressé. Jean-Luc est resté derrière, poliant de vieux slogans comme des héritages, convaincu que la répétition pourrait ressusciter sa pertinence.
Ce qui rend ce spectacle obscène, ce n’est pas seulement le déni, mais l’appropriation - la prétention que le monde doit une fois de plus se plier à la nostalgie génocidaire comme à « une autre perspective ». Non. Il y a des perspectives, et il y a des post-mortem idéologiques. Cet entretien appartient à la seconde catégorie. Et aucune orchidée, aussi exotique soit-elle, ne pourra parfumer éternellement la puanteur indéniable du déni.


















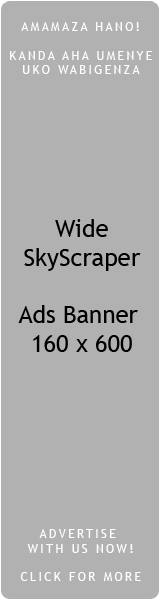
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!