La République démocratique du Congo est un pays à l’échelle continentale. Plus de deux millions de kilomètres carrés. Des fleuves qui pourraient irriguer la moitié de l’Afrique. Une richesse en minéraux, forêts et terres fertiles suffisante pour en faire l’un des pays les plus riches du monde. Si la géographie seule décidait du destin, le Congo serait une superpuissance.
Et pourtant, discours après discours, rassemblement après rassemblement, le géant semble obsédé par un voisin plus petit que l’une de ses petites provinces : le Rwanda.
Est-il juste que le Congo se compare sans relâche au Rwanda ? Est-il pertinent que la politique étrangère congolaise semble déterminée - à tout prix - à rivaliser, suivre de près ou dénoncer cet État géographiquement plus petit ? Comment interpréter la psychologie d’un vaste pays qui cherche à se mesurer à quelqu’un de plus petit, et qui s’offusque lorsque ce voisin plus modeste propose des leçons de gouvernance, de discipline ou de gestion économique ?
On est tenté de se tourner vers le psychanalyste Sigmund Freud avant de prendre un manuel de géopolitique.
Le géant et le miroir
Si la RDC cherchait des pairs, elle pourrait regarder au nord vers l’Algérie, le plus grand pays d’Afrique par sa superficie. Elle pourrait se comparer à l’Afrique du Sud, première économie industrielle du continent. Elle pourrait invoquer l’Éthiopie, fière de sa forte identité nationale et de la singularité d’avoir largement résisté à la colonisation.
Ou encore se mesurer à l’Égypte, au Maroc ou au Ghana - des nations qui disposent de moins de ressources naturelles que le Congo, mais qui le surpassent souvent en matière de gouvernance, d’infrastructures ou de cohérence institutionnelle.
Mais non. L’énergie rhétorique du système administratif congolais semble irrésistiblement attirée vers l’est, vers Kigali.
Norman Fairclough a écrit dans son livre ’Language and Power’ (1989) que « le discours est une pratique non seulement de représentation du monde, mais aussi de signification du monde, constituant et construisant le monde en sens. » Si le Rwanda est omniprésent dans le discours politique congolais, alors le Rwanda est construit non seulement comme un acteur étranger, mais comme l’axe central autour duquel tourne le sens politique congolais. Et c’est exactement le problème.
Le philosophe du langage J. L. Austin a notamment soutenu dans son livre ’How to Do Things with Words’ (1962) que « dire quelque chose, c’est faire quelque chose. » Le discours est action. Nommer, c’est exercer le pouvoir. Évoquer, c’est animer.
Lorsque les responsables congolais, qu’il s’agisse de Patrick Muyaya, du président Félix Tshisekedi, de Martin Fayulu ou même de Denis Mukwege, invoquent le Rwanda comme explication de tout, de l’insécurité à l’est à la stagnation économique à Kinshasa et dans tout le pays, ils ne se contentent pas de décrire la réalité. Ils la façonnent.
Ils construisent un récit dans lequel le Rwanda devient : le problème ; l’obstacle ; le saboteur et la main cachée.
Toutefois, voici la contradiction : si le Rwanda est la cause de tout ce qui dysfonctionne au Congo, alors le Rwanda devient central dans toute solution concevable. On ne peut avoir un problème sans impliquer la nécessité de le résoudre. Et on ne peut résoudre un problème impliquant le Rwanda sans le Rwanda.
Ainsi, en essayant de diaboliser, le discours politique congolais centralise involontairement. Plus le Rwanda est présenté comme omnipotent, plus il commence à apparaître - psychologiquement, symboliquement - comme indispensable.
L’état d’esprit du bouc émissaire
René Girard a soutenu dans Le ’Bouc émissaire’ (1982) que les sociétés en crise externalisent souvent les tensions internes en projetant la faute sur un « autre » désigné. « La victime, » écrivait-il, « ne doit être ni trop différente ni trop identique. »
Le Rwanda correspond à cette douloureuse proximité. Voisin. Enchevêtrement historique pour des raisons évidentes. Pourtant, suffisamment différent pour servir de réceptacle à la culpabilité.
Cependant le bouc émissaire est une thérapie risquée. Il soulage à court terme tout en corrodant l’auto-examen structurel. Erich Fromm avertissait dans ’Escape from Freedom’ (1941) que les sociétés submergées par l’anxiété abandonnent souvent la pensée critique au profit d’ennemis simplifiés.
Il est psychologiquement plus facile pour la RDC de blâmer un acteur externe que d’affronter la corruption endémique, la prédation des élites et l’effondrement institutionnel. Et le dysfonctionnement de la RDC n’est pas discret.
Lorsque Transparency International publie son classement de la corruption et que le Congo obtient de mauvais résultats, de nombreux citoyens congolais ne contestent pas le classement. Ils acquiescent avec habileté parce qu’ils savent.
Lorsque les entourages présidentiels entreprennent des voyages somptueux pour de brèves réunions à Washington ou à Bruxelles, les gens savent. Lorsque les élites politiques célèbrent des anniversaires à Dubaï dans un luxe ostentatoire tandis que des millions de personnes luttent pour survivre, les citoyens savent.
Lorsque des rapports circulent indiquant qu’un million de dollars ou plus a été alloué pour financer un concert à Paris du musicien Fally Ipupa, les gens savent. Et cette connaissance engendre une humiliation silencieuse. Dans ce climat, la rhétorique anti-Rwanda fonctionne comme un déplacement émotionnel.
Il devient facile de remarquer la création discursive de « l’indomptable ». Michel Foucault écrivait dans ’Power/Knowledge’ (1980) que « le pouvoir produit du savoir… le pouvoir et le savoir s’impliquent directement l’un l’autre. » En parlant constamment du Rwanda comme de l’architecte des malheurs du Congo, le discours congolais produit le Rwanda comme puissant, peut-être même hyper-puissant.
Lors des manifestations à Kinshasa, pendant les grèves des médecins pour salaires impayés, certains panneaux affichaient : « Nous allons au Rwanda. » Oui, ce n’était pas de la satire. C’était du symbolisme.
Le Rwanda devient, dans l’imaginaire partagé, et à juste titre, l’État qui paie ses fonctionnaires à temps. L’État qui impose la discipline. L’État où la corruption est punie par des conséquences visibles. L’État où l’ordre semble fonctionner.
Pierre Bourdieu a observé dans ’Language and Symbolic Power’ (1991) que « le pouvoir symbolique est le pouvoir de constituer le donné par les énoncés. » En attaquant le Rwanda, les responsables congolais renforcent paradoxalement sa stature symbolique.
Plus le Rwanda est diabolisé, plus il apparaît redoutable. Plus il est accusé, plus il devient central. Plus il est présenté comme omniprésent, plus il commence à sembler invincible. Ce n’est pas une bonne stratégie. C’est une auto-sabotage narrative.
Le satellite dans le ciel
Considérons, encore une fois - et cette fois plus sérieusement - un enfant à Boma ou à Matadi, là où la brise de l’Atlantique apporte le sel et la mémoire, mais pas l’écho des tirs venus des collines de l’est. Ou imaginons des élèves vivant dans les villes de Bandundu, Basankusu ou Gemena. Ces enfants n’ont jamais vu la frontière rwandaise.
Un enfant à Boma ne connaît pas la géographie du Nord-Kivu. Il ne peut pas situer Kigali sur une carte avec précision. Le Rwanda, pour lui, n’est pas une réalité vécue. Ce n’est qu’un mot. Et pourtant, ce mot flotte partout.
Il l’entend à la radio. Il l’entend dans les discours politiques. Il l’entend dans la voix solennelle des annonces nationales. Il l’entend lorsque les enseignants se plaignent des salaires en retard. Il l’entend lorsque l’électricité tombe en panne. Il l’entend lorsque l’eau ne coule pas. Il l’entend lorsque les routes s’effondrent dans une résignation boueuse.
L’enfant grandit dans un pays aux rivières immenses et aux promesses énormes. Mais la route qui mène à son école est fissurée. La craie se fait rare. Les manuels scolaires se partagent un banc pour deux. Quand les lumières s’éteignent - ce qui arrive souvent - la classe revient à un siècle ancien.
Si le discours, comme le soutenait Norman Fairclough (1989), construit la réalité sociale, quelle réalité est en train de se construire dans l’esprit de cet enfant ? Si les figures d’autorité invoquent fréquemment un pays lointain comme l’architecte caché du dysfonctionnement, l’enfant commence à intérioriser une cosmologie étrange : quelque part au-delà de l’horizon - au-delà des montagnes et des forêts - existe une force assez puissante pour décider si sa classe aura de l’électricité.
Il ne connaît pas le Rwanda. Mais il connaît son nom. Et voici l’ironie, si tranchante qu’elle coupe dans les deux sens : en essayant de diminuer le Rwanda par la rhétorique, la classe politique congolaise l’a magnifié psychologiquement.
Lorsque les dirigeants politiques répètent que le Rwanda est la source de l’instabilité, de la corruption, de l’infiltration, du sabotage - lorsqu’ils le présentent comme omniprésent, stratégique, rusé, implacable - ils l’élèvent à des proportions mythiques. Il devient moins un État voisin et plus une présence omnisciente. Presque… céleste.
Le Rwanda commence à ressembler à un satellite. Un satellite extraordinaire en orbite au-dessus de la RDC. Observant. Calculant. Manipulant.
C’est la « fausse peur » qui prend racine silencieusement : le Rwanda comme œil omniscient suspendu dans le ciel, ajustant les leviers du destin congolais depuis les hauteurs. Un dieu mécanique avec une intonation de Kigali.
L’illogisme serait amusant s’il n’était pas politiquement corrosif. L’enfant de Boma ou de Mbandaka, à des milliers de kilomètres de la frontière orientale, pourrait légitimement se demander : comment fonctionne ce satellite ? Envoie-t-il la corruption dans les ministères ? Reprogramme-t-il les marchés publics ? Fait-il disparaître les salaires impayés dans le vide ? S’introduit-il la nuit dans les bureaux pour gonfler les budgets de déplacement ? Ou n’est-il pas plus facile, voire plus simple, d’admettre que les échecs qu’il constate au quotidien viennent de chez lui ?
Michel Foucault (1980) a expliqué comment le pouvoir circule à travers le discours, façonnant ce qui peut être dit et ce qui peut être pensé. Si le Rwanda est constamment décrit comme omniprésent et omnipotent, il devient concevable comme omnipotent. La répétition lui confère une élévation supplémentaire. Le résultat est un paradoxe : le Rwanda devient à la fois le méchant et le point de référence.
Revenons au message : « Nous allons au Rwanda. » C’est une déclaration extraordinaire. D’un côté, c’est une protestation. De l’autre, c’est une confession. Ainsi, le récit anti-Rwanda produit simultanément deux images : le Rwanda comme saboteur. Le Rwanda comme alternative efficace.
Cette dualité est psychologiquement instable. Comme l’a observé René Girard (1982), des pays comme la RDC oscillent souvent entre diaboliser et mythifier une même figure. Le bouc émissaire devient à la fois maudit et central. Haï et nécessaire. Pour l’enfant de Boma ou de Matadi, cette contradiction devient formatrice.
Il sait que son pays possède du cobalt, des diamants, de l’or et du cuivre. Il sait qu’il a des fleuves capables d’alimenter des continents. Il se rend compte que les politiciens possèdent des millions de dollars alors que les écoles s’effondrent. Il entend que la corruption n’est pas tolérée au Rwanda et souvent punie de manière visible. Il entend que l’ordre existe et que la discipline existe ailleurs.
Et ainsi, la métaphore du satellite se renforce : le Rwanda est là-haut, en orbite autour du Congo, le surveillant, le contrôlant, peut-être même le jugeant. Mais voilà le danger.
Une société qui s’imagine constamment observée et hantée par un voisin commence à perdre confiance en elle. Elle intériorise l’idée que son destin est déterminé de l’extérieur. Elle nourrit un fatalisme discret : nous réussirions, si seulement ce satellite cessait de transmettre. C’est psychologiquement débilitant.
Comme l’a soutenu Erich Fromm (1941), les individus et les sociétés fuient parfois la responsabilité parce que la liberté entraîne l’anxiété. Accepter que ses échecs soient générés en interne est terrifiant. Cela exige action, sacrifice, réforme et responsabilité.
Blâmer un satellite imaginaire est plus facile. Pour l’enfant de Matadi, les conséquences sont subtiles mais profondes. Si le Rwanda est responsable du dysfonctionnement du Congo, alors le Congo devient victime d’un sabotage cosmique. Les victimes ne réforment pas les systèmes. Les victimes endurent.
Mais si le dysfonctionnement est interne - si les enseignants impayés, les routes délabrées, les budgets opaques sont le produit d’une mauvaise gestion interne - alors la responsabilité revient au pays. Et la responsabilité exige du courage.
Teun A. van Dijk, dans ’Elite Discourse and Racism’ (1993), a montré comment les récits des élites façonnent la cognition publique. Lorsque les dirigeants présentent à plusieurs reprises un groupe externe comme menaçant et omniprésent, ils structurent la manière dont les citoyens interprètent les événements quotidiens. Une panne d’électricité n’est plus un incident technique. C’est géopolitique. Un scandale de corruption n’est plus administratif. C’est de l’infiltration.
Ce cadrage cognitif est puissant. Il détourne l’attention de la réforme structurelle et l’oriente vers une vigilance perpétuelle contre une omnipotence imaginée.
En revanche, les satellites ne détournent pas de fonds. Les satellites ne signent pas de contrats gonflés. Les satellites ne célèbrent pas des extravagances à l’étranger pendant que les fonctionnaires font grève chez eux. Ce sont les humains qui le font, et les systèmes le permettent.
La tragédie profonde est la suivante : plus le Rwanda est décrit comme omniscient et omniprésent, plus il paraît redoutable. Plus il paraît redoutable, plus les dirigeants congolais semblent comparativement impuissants. Et plus les dirigeants paraissent impuissants, moins les citoyens font confiance à leurs institutions.
Ainsi, le discours anti-Rwanda risque de miner la souveraineté même du Congo dans le domaine psychologique. L’enfant de Boma mérite mieux que la mythologie.
Il mérite des routes construites non pas en opposition au Rwanda, mais au service des citoyens congolais. Il mérite une électricité produite non comme preuve de défi géopolitique, mais comme fonction essentielle de la gouvernance. Il mérite un récit national qui parle davantage de réforme interne que de fantômes extérieurs.
Car si le Rwanda était vraiment un satellite planant dans le ciel, observant chaque ministère et influençant chaque erreur, alors le Congo serait géopolitiquement condamné.
Mais le Rwanda n’est pas un satellite. C’est un État voisin. Le hantement, s’il existe, ne vient pas du ciel, mais de l’intérieur. Et tant que le géant ne comprend pas que l’ombre qu’il craint est projetée par sa propre posture, l’enfant de Boma ou de Moanda continuera de grandir sous un ciel encombré non pas de satellites, mais d’excuses.
La psychologue politique Karen Stenner a soutenu dans ’The Authoritarian Dynamic’ (2005) que les menaces perçues peuvent activer des réflexes d’exclusion et de défense au sein des sociétés. Si le Rwanda est présenté à plusieurs reprises comme une menace existentielle, la politique intérieure peut se durcir, la dissidence peut être délégitimée, et la critique interne peut être qualifiée de collaboration étrangère.
Ce schéma n’est ni unique ni accidentel. Teun A. van Dijk (1993) a noté que les récits des élites peuvent « légitimer et reproduire l’inégalité et les préjugés » en structurant la perception publique autour d’ennemis simplifiés.
Lorsque le Rwanda est constamment invoqué comme la cause du chaos, de la corruption et de l’effondrement, il devient plus qu’un voisin. Il devient un outil narratif, une explication universelle. Or, les explications universelles sont l’ennemi de la réforme.
Le peuple congolais n’est pas naïf. Il sait que la corruption ne vient pas en contrebande de Kigali. Il sait que les fonds publics mal gérés ne sont pas transférés de l’étranger. Il sait aussi que les fonctionnaires impayés ne sont pas victimes d’un sabotage salarial rwandais. Il sait qui sont les voleurs. Et la connaissance, une fois mûrie, peut être explosive.
Besoin de réexamen national
Le véritable défi pour la RDC n’est pas d’effacer le Rwanda du discours. C’est de le décentrer, de manière chirurgicale, délibérée et permanente. Mais, malheureusement, cela exigerait une révolution de maturité politique. Une denrée rare à Kinshasa.
Imaginez, un instant, une réunion de cabinet à Kinshasa où le mot « Rwanda » serait interdit pendant 24 heures. L’agenda paraîtrait soudain terriblement dépouillé. Les coupures d’électricité ne pourraient plus s’expliquer géopolitiquement. L’effondrement des routes nécessiterait des ingénieurs plutôt que des conférences de presse. L’opacité budgétaire exigerait des auditeurs plutôt que des ambassadeurs. Effrayant.
Frantz Fanon avertissait dans Les ’Damnés de la Terre’ (1961) que les élites postcoloniales « remplacent l’ancien colon étranger, mais ne transforment pas la structure. » Autrement dit, le drapeau change, l’hymne change, mais la logique prédatrice demeure.
La tragédie de la RDC n’est pas seulement d’avoir été colonisée. C’est qu’elle risque d’être administrée de manière perpétuelle par une classe qui préfère la rhétorique à la réforme. Un réexamen national signifierait affronter des vérités inconfortables : que la corruption est systémique et non importée ; que l’extravagance des élites insulte une population en souffrance ; que la richesse minérale, sans discipline institutionnelle, devient une malédiction ; que la souveraineté sans responsabilité n’est que théâtre.
Mais, le théâtre est addictif. Accuser le Rwanda est politiquement efficace. Cela unit temporairement des factions. Cela offre un méchant. Cela évite les audits. Cela repousse le moment du règlement des comptes. La réforme, en revanche, exige des sacrifices. Elle exige que les ministres fassent l’objet d’enquêtes. Que les sénateurs soient scrutés. Que les contrats soient ouverts. Que les marchés publics soient transparents. Que les fonds publics cessent d’être une opportunité privée.
En résumé, elle exige du courage. Et le courage est plus rare que le cobalt. Un géant ne devient pas puissant en criant sur son voisin. Il devient puissant en se disciplinant lui-même. Tant que le Congo n’acceptera pas l’autocontrôle interne, la condamnation extérieure restera ce qu’elle est : du bruit.
Conclusion
La RDC n’est pas pauvre en ressources. Elle est extrêmement pauvre en gouvernance intelligible. Elle n’est pas géographiquement petite. Elle est trop faible en intégrité institutionnelle. Incriminer le Rwanda n’a construit aucune centrale électrique. Cela n’a pas pavé d’autoroutes de Lubumbashi à Kisangani ni de Goma à Bukavu. Cela n’a pas assuré l’eau potable dans les villages ruraux situés à des milliers de kilomètres de toute frontière. Cela n’a pas transféré magiquement la responsabilité dans des ministères allergiques à la transparence. Et pourtant, le rituel rhétorique continue.
Hannah Arendt avertissait dans Les ’Origines du totalitarisme’ (1951) que « le sujet idéal du régime totalitaire… est un peuple pour lequel la distinction entre fait et fiction… n’existe plus. » Lorsque le discours politique brouille la frontière entre incompétence interne et complot externe, il cultive précisément cette confusion.
Il devient possible de croire que les nids-de-poule sont géopolitiques. Que le détournement de fonds est une agression étrangère. Que la paresse administrative est un sabotage stratégique. Quelle doctrine phénoménale. Elle absout tout le monde.
Michel Foucault (1980) reconnaîtrait immédiatement le schéma : le pouvoir produisant un système de savoir qui se soutient lui-même. Le Rwanda comme explication. Le Rwanda comme omniprésence. Le Rwanda a un alibi pratique.
Toutefois, les citoyens ne sont pas dupes. Ils comprennent que pendant que les discours rugissent sur la souveraineté, les modes de vie luxueux prospèrent. Ils comprennent que pendant que les officiels condamnent l’ingérence étrangère, les contrats opaques prolifèrent. Ils réalisent que pendant que la fierté nationale est invoquée, la richesse nationale s’évapore dans des mains privées.
La tragédie n’est pas la comparaison. La comparaison peut inspirer la réforme. La tragédie est l’obsession sans introspection. Un État mature étudie son voisin pour apprendre. Un État en insécurité étudie son voisin pour nourrir le ressentiment.
Si la RDC sous Tshisekedi continue à se définir principalement en opposition au Rwanda, elle risque de rétrécir psychologiquement alors qu’elle demeure vaste territorialement. L’histoire n’est pas tendre avec les géants qui blâment les autres pour leurs propres trébuchements.
La voie à suivre est brutalement simple et politiquement insupportable : auditer honnêtement. Punir la corruption et le langage haineux de manière cohérente. Investir de façon transparente. Gouverner avec compétence. Aucune conférence de presse à Kinshasa ne remplacera la réforme. Aucune dénonciation dans les forums internationaux ne remplacera la discipline institutionnelle.
Le miroir attend. Le géant doit décider s’il veut continuer à lui crier dessus, ou enfin s’y analyser. Car les miroirs, contrairement aux discours, n’applaudissent pas.


















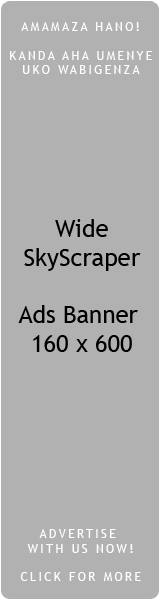
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!