Saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies, conformément aux articles 96 de la Charte et 65 de son Statut, la CIJ s’est prononcée avec gravité et précision sur la nature juridique, l’étendue normative et les implications concrètes des obligations qui incombent aux États dans la lutte contre les changements climatiques anthropiques. Par son ampleur, sa profondeur et sa méthodologie, cet avis s’inscrit résolument comme un moment de refondation pour l’ordre juridique international.
Une initiative inédite, issue de la société civile transnationale
La genèse même de cette saisine atteste d’un changement paradigmatique : le droit international ne procède plus seulement d’une diplomatie d’États, mais se nourrit désormais des aspirations d’une société civile globalisée. C’est d’une initiative d’étudiants de l’Université du Pacifique Sud qu’est née cette mobilisation historique.
En sollicitant le gouvernement de Vanuatu, ils ont enclenché une dynamique diplomatique vertueuse, fédérant autour de leur démarche une coalition composite d’États vulnérables (Angola, Bangladesh, Maroc, Costa Rica, Viêtnam…) et de puissances industrialisées engagées (Allemagne, Nouvelle-Zélande).
De cette alliance improbable mais exemplaire est née la résolution A/RES/77/276, adoptée sans heurts par une majorité écrasante de l’Assemblée générale (133 voix sur 193), révélant ainsi l’émergence d’un consensus mondial sur l’impératif climatique.
Une démonstration fondée sur la science, adossée au droit et dictée par l’urgence
L’avis rendu par la CIJ s’illustre par une remarquable densité argumentative : nourri de 91 contributions écrites, de 62 observations d’organisations internationales et d’audiences réunissant 96 États, il constitue à lui seul une somme jurisprudentielle et documentaire inestimable. Ce travail colossal s’appuie avec autorité sur les analyses du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), que la Cour qualifie de « meilleures données scientifiques disponibles », érigées en véritable assise probatoire. En cela, l’avis s’inscrit dans une nouvelle épistémologie du droit international, où la science climatique n’est plus simple auxiliaire, mais fondement incontournable de la normativité juridique.
La Cour y reprend sans ambages les alertes du GIEC sur l’imminence de l’irréversibilité : elle rappelle que des milliards d’êtres humains se trouvent déjà dans une situation de vulnérabilité extrême, que les politiques d’adaptation demeurent notoirement insuffisantes, et que la fenêtre d’opportunité pour préserver un avenir viable se referme inexorablement. Ces constats, réaffirmés avec solennité, confèrent à l’avis la portée d’un rappel à l’ordre juridique et moral de la communauté des nations.
Une architecture normative complexe, mais cohérente et cumulative
L’un des apports doctrinaux majeurs de cet avis tient à la clarification minutieuse du régime juridique applicable. La CIJ opère une articulation méthodique entre les sources conventionnelles (Convention-cadre sur les changements climatiques, Protocole de Kyoto, Accord de Paris), les normes coutumières, et les grands principes généraux du droit international.
Elle consacre en particulier le principe de non-utilisation dommageable du territoire, étendu désormais aux atteintes environnementales globales, et l’érige en obligation coutumière universelle.
Loin de cloisonner les régimes juridiques, la Cour affirme la complémentarité et non la substitution entre les obligations issues des traités climatiques et celles découlant d’autres corpus juridiques, notamment le droit des droits humains et le droit de la mer.
Elle rappelle que les principes de précaution, d’équité intergénérationnelle, de développement durable ou de responsabilités différenciées doivent guider l’interprétation des normes applicables. Il en résulte un agencement normatif polyphonique, mais remarquablement cohérent, où les obligations climatiques s’entrelacent avec les fondements les plus essentiels du droit international.
Des obligations renforcées, une responsabilité étatique repensée
Au cœur de l’avis se trouve l’élaboration rigoureuse des obligations positives qui pèsent sur les États, ainsi que la définition affûtée des manquements susceptibles d’engager leur responsabilité.
L’obligation de diligence requise est élevée au rang de principe cardinal : elle impose à chaque État de prendre, sur la base d’indicateurs scientifiquement fondés, les mesures propres à prévenir des atteintes graves au système climatique. La simple adoption de politiques publiques ne suffit plus : celles-ci doivent être objectivement aptes à atteindre les objectifs fixés par les traités, au premier rang desquels la limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C.
La Cour va plus loin encore, en attribuant à ces obligations climatiques le caractère d’obligations erga omnes, c’est-à-dire opposables à l’ensemble de la communauté internationale, indépendamment de toute démonstration de préjudice particulier. Elle précise que tout État, lésé ou non, est fondé à engager la responsabilité d’un autre État en cas de manquement à ces obligations, conférant ainsi à la protection du climat une dimension objectivée et universelle. Elle réduit en outre la portée des obstacles traditionnels liés à l’attribution de la responsabilité, en considérant que l’octroi de subventions aux énergies fossiles, l’encouragement à leur extraction, ou même l’inaction, peuvent constituer des faits internationalement illicites.
L’aurore d’un nouvel ordre juridique environnemental
S’il ne lie formellement aucun État, l’avis rendu par la CIJ n’en demeure pas moins doté d’une force juridique et symbolique considérable. Il balise avec clarté les contours d’un nouvel ordre normatif international, conférant aux obligations climatiques une légitimité universelle et une justiciabilité accrue. Il constitue un levier pour les juridictions nationales et régionales, qui y trouveront matière à conforter leur jurisprudence sur la justiciabilité des politiques climatiques. Il ouvre également la voie à une multiplication de recours internationaux fondés sur l’inaction climatique, y compris à l’initiative d’États tiers.
L’avis du 23 juillet 2025 s’inscrit ainsi dans une dynamique de réhabilitation du droit international face à la crise climatique, en érigeant la protection du climat au rang de bien juridique commun de l’humanité. Il ne se borne pas à constater l’urgence : il en déduit des obligations contraignantes, mobilisables et universalisables. Malgré certaines zones d’ombre en particulier sur le sort des États insulaires voués à la submersion, il impose une vérité juridique nouvelle : la survie du système climatique n’est plus affaire de diplomatie ou de volontarisme politique, mais de légalité.
Il appartient désormais aux États, aux juridictions, aux peuples et aux générations futures de s’en emparer. Car cet avis, s’il n’est pas encore un tournant juridique contraignant, est indéniablement un tournant civilisationnel.










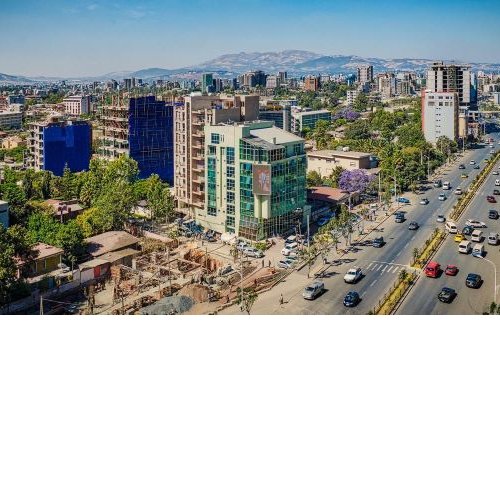








AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!