Cette réplique, loin d’être une réponse factuelle, constitue une insulte à la dignité humaine et s’apparente à un aveuglement délibéré, voire à un désir de maintenir un statu quo oppressif. Cette réaction laisse entrevoir la volonté de dissimuler un agenda caché, visant à détourner l’attention des véritables enjeux de justice sociale et de reconnaissance des droits. Il s’agit là d’un mécanisme insidieux pour préserver des rapports de force inégaux, sans se soucier des souffrances humaines et des aspirations légitimes des peuples concernés.
Il serait illusoire de prétendre appréhender la crise endémique qui secoue la République Démocratique du Congo en se limitant à un survol de sa vaste étendue territoriale, de son exceptionnelle biodiversité et de l’abondance de ses ressources naturelles.
Une telle approche, réductrice et superficielle, occulte les véritables ressorts du chaos qui s’y perpétue. En effet, c’est dans l’exploration minutieuse de son histoire tourmentée, de la complexité de ses dynamiques sociologiques et de l’érosion progressive des valeurs politiques que se dessine la trame profonde de cette instabilité chronique.
La manipulation cynique des identités à des fins partisanes, l’instrumentalisation systématique du tutsi congolais en bouc émissaire par les pouvoirs successifs et l’instauration d’une gouvernance délibérément défaillante laissent entrevoir un dessein sous-jacent, où l’anarchie devient un levier de contrôle et où la fragmentation sociale sert d’outil de domination.
L’Alliance Fleuve Congo AFC/M23 ne constitue nullement la cause première des turbulences qui secouent la République Démocratique du Congo ; elle en est plutôt l’une des manifestations les plus éloquentes.
Réduire la complexité du conflit congolais à cette seule rébellion relève d’une lecture simpliste qui occulte les véritables dynamiques à l’œuvre.
Le M23 s’inscrit dans un cycle de crises récurrentes, nourries par l’inconstance étatique, la gouvernance déliquescente, la fragmentation identitaire savamment exploitée à des fins politiques et l’échec structurel des processus de pacification.
Ce mouvement armé, loin d’être une aberration isolée, illustre la faillite d’un État qui, incapable d’assurer son autorité sur l’ensemble de son territoire, voit émerger en son sein des entités contestataires aspirant à une meilleure représentation ou à la survie face aux persécutions institutionnalisées.
Ainsi, l’AFC/M23 ne saurait être appréhendé comme un simple acteur perturbateur, mais plutôt comme le symptôme d’un mal profond, révélateur des dysfonctionnements systémiques qui gangrènent le pays depuis des décennies.
Il est difficile de comprendre la prolifération de plus de 250 groupes armés sans se pencher sérieusement sur les véritables commanditaires et leurs motivations profondes. Cette explosion de groupes armés, loin d’être le fruit du simple hasard, découle d’une conjoncture complexe où les véritables instigateurs demeurent souvent invisibles, tapis dans les sphères du pouvoir.
Or, leur dénonciation reste inopérante, inaudible, et souvent étouffée par un système de relations qui protège les intérêts des puissants. Cette situation soulève une question fondamentale : pourquoi les véritables responsables, ceux qui orchestrent et financent ces conflits, échappent- ils à toute forme de justice ?
La réponse réside sans doute dans un ordre établi qui préfère préserver ses propres intérêts au détriment de la vérité et de la paix, permettant ainsi à ces acteurs obscurs de continuer leurs manipulations, tout en laissant les peuples souffrir des conséquences de leurs actions.
Au nom de quels intérêts peut-on justifier l'accommodement avec un discours de haine, alimenté par les structures mêmes du pouvoir, qui se nourrit de la stigmatisation et de la persécution ouverte des tutsi congolais ?
Comment peut-on accepter la banalisation de la vie humaine, alors que la souffrance des innocents est instrumentalisée à des fins politiques et stratégiques ?
Cette complaisance, qui refuse de s’indigner, de dénoncer et d’agir, est une abjection morale et éthique. Elle trahit les principes fondamentaux de justice et de dignité humaine.
En laissant prospérer cette impunité et cette violence institutionnalisée, on se condamne à une dérive incontrôlable, où les principes de réconciliation et de paix sont sacrifiés sur l’autel des intérêts égoïstes.
A l’instar d’autres institutions en République Démocratique du Congo, l’armée congolaise se trouve fragmentée, dépourvue d’un commandement unifié et souvent confinée à la défense de positions isolées, sans aucune stratégie militaire cohérente. Cette situation, aussi déconcertante qu’inquiétante, mérite une réflexion approfondie sur les causes profondes des crises récurrentes qui minent le pays.
Comment en est-on arrivé là ? Cette question, complexe et fondamentale, appelle une réponse qui explore non seulement les carences structurelles et organisationnelles au sein de l’armée, mais aussi l’inefficacité d’une gouvernance marquée par l’instabilité, la corruption et la gestion chaotique des ressources humaines et matérielles.
L’absence de cohésion dans les rangs militaires trouve ses racines dans une politique de manipulation des forces armées, alimentée par des rivalités internes et des ingérences extérieures, qui ont fragmenté la nation.
Cette déliquescence institutionnelle, alimentée par des intérêts partisans et la négligence de la souveraineté nationale, a conduit à un état d’impréparation systémique, où la défense des frontières et la préservation de l’ordre public deviennent des défis quasi insurmontables.
Qui, en effet, pourrait expliquer la présence persistante des troupes onusiennes depuis près de 25 ans sans qu’aucun résultat probant n’ait été atteint ?
Comment justifier l’inertie face à la présence des FDLR, dont l’idéologie haineuse continue d’alimenter le cycle de violence, et l’incapacité manifeste de neutraliser cette menace ?
Ces questions soulignent des manquements flagrants qui frappent l’esprit et interrogent la légitimité des missions internationales en République Démocratique du Congo. L’échec à résoudre ces crises, malgré des décennies d’intervention étrangère, ne peut se réduire à de simples insuffisances opérationnelles ou stratégiques.
Il devient impératif de scruter les causes profondes de cette inefficacité, qui semblent résider dans une combinaison d’intérêts géopolitiques contradictoires, d’un manque de volonté politique et d’une gestion désastreuse des ressources et des moyens déployés.
Ces éléments dessinent un tableau inquiétant où les engagements internationaux semblent incapables de dépasser le stade de la rhétorique, laissant les populations dans une souffrance interminable et exacerbée par l’inaction de ceux censés protéger la paix et la stabilité.
Plutôt que d’affronter les causes réelles, profondes et structurelles des crises qui ravagent le pays, on préfère recourir à des raccourcis simplistes et réducteurs. Il est plus facile de falsifier l’histoire et de manipuler les récits pour camoufler l’inaction et l’échec, tout en s’accommodant de la légèreté et de l’indifférence de certains cercles du pouvoir.
Dans ce contexte, l’option la plus commode semble être de désigner un bouc émissaire, dans le but de se donner bonne conscience et de détourner l’attention des véritables responsabilités.
Cette démarche, motivée par des intérêts mesquins et égoïstes, masque les véritables enjeux et empêche toute avancée vers une véritable réconciliation et résolution des problèmes.
C’est là, précisément, où réside le mal : dans cette tendance à esquiver les questions fondamentales au profit de solutions superficielles qui, loin d’apporter la paix et la stabilité, ne font que perpétuer le cycle de violence et de division.









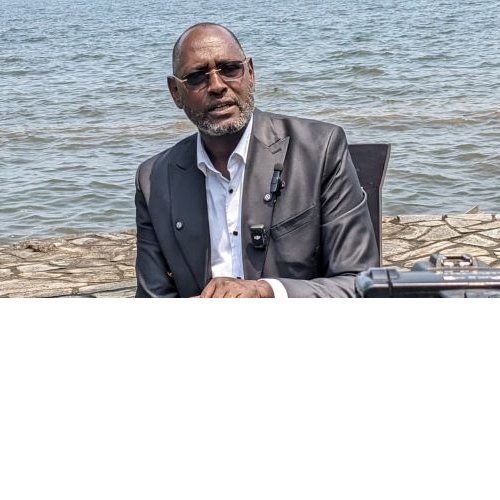









AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!