L’un de ces chefs-d’œuvre est le chant Ese Mbaze nde ? (« À qui puis-je demander ? »), composé au début de l’année 1996, un an et demi après la fin du génocide contre les Tutsi.
Ce n’est pas simplement une chanson ; c’est un cri, un hurlement porté par la mélodie, une lamentation enracinée dans le langage de l’exil et de l’angoisse.
C’est une confrontation spirituelle avec l’incompréhensible : comment vivre lorsque la mort est passée si près, si totalement ?
Peu d’artistes dans le monde ont su saisir une telle profondeur de tragédie humaine avec autant de justesse non physique. Mariya Yohana Mukankuranga en fait partie ; Nyiranyamibwa en est une autre.
Toutes deux, désormais octogénaires, sont les gardiennes de la mémoire. Dans ses paroles, Suzanne ne parle pas seulement des survivants ; elle parle en tant que survivante.
Elle les incarne. Sa voix s’élève avec leur douleur et s’abîme dans leur solitude. Son art est sacré.
La flûte qui ouvre Ese Mbaze nde ? n’est pas ornementale. C’est le son de la solitude, d’un silence si profond qu’il fait pleurer les arbres.
Et lorsque Nyiranyamibwa commence par ce cri prolongé, « Ayiiii ! », suivi de « Ngire nte ? » (« Que puis-je faire, comment faire ? »), ce n’est pas une question rhétorique. C’est une interrogation lancée dans le vide.
Dans la tradition rwandaise, Ngire nte ? était la deuxième question posée lors d’un rituel divinatoire, destinée à aider le souffrant à découvrir quel péché ou quel malheur avait provoqué le désastre.
Mais pour le survivant du génocide, il n’y a ni devin, ni réponse, ni personne à qui poser la question.
Ese Mbaze nde ? — À qui puis-je demander ? Qui reste pour être mon miroir, pour témoigner de ma perte ? La réponse est immédiate et bouleversante : Uwo nabajije atakiriho — Celui à qui je devrais poser la question n’est plus là.
En une seule respiration, Suzanne nous rappelle que le génocide ne détruit pas seulement des vies, mais anéantit toute continuité.
Le meurtre des grands-parents, des parents et des enfants n’est pas seulement physique. Il est généalogique.
Un enfant grandit sans photo de sa mère, sans souvenir de la voix de son père, sans village où retourner.
« J’entre au Rwanda et je ne reconnais plus rien,
C’est comme si son cœur avait été arraché.
Je suis étourdie, désorientée, comme vidée de tout sens,
Puis ma poitrine se serre comme si j’allaitais, mais ce n’est pas le cas, ayiweeeee. »
Cette strophe, tirée d’un traumatisme spirituel profond, est un psaume du déracinement. Une femme qui était partie en exil revient pour découvrir un Rwanda qui ressemble à un corps sans âme. C’est un cadavre de pays.
La métaphore de la poitrine qui se serre sans allaitement évoque une douleur fantôme — le deuil de ce qui aurait dû être : des enfants à tenir, à nourrir, à élever. La douleur persiste, même en l’absence.
« Quand je suis sortie, il n’y avait pas d’oiseaux… Il y avait du soleil et une odeur de mort. »
Ce sont les mots d’une survivante citée dans l’introduction du livre Leave None to Tell the Story, un titre emprunté à la terrible menace des génocidaires eux-mêmes : Ntihazagire n’uwo kubara inkuru — « Qu’il ne reste personne pour raconter l’histoire. »
Ce n’était pas seulement une menace, c’était une consigne — un ordre apocalyptique visant à effacer tout un peuple et à imposer le silence.
C’est dans ce silence calciné que le déni du génocide s’aggrave. Et ceux qui nient le génocide contre les Tutsi, ou qui en minimisent la gravité, ne sont pas simplement dans l’erreur — ils sont complices.
Ils sont fossoyeurs dans un autre sens : ils enterrent la vérité.
La puissante lamentation de Suzanne Nyiranyamibwa en 1996, Ese Mbaze Nde ? (« À qui puis-je demander ? »), résonne à travers les cendres d’un peuple presque anéanti.
Elle est rentrée au Rwanda après le génocide et a trouvé un pays méconnaissable : des collines autrefois pleines de vie réduites au silence par le massacre, des églises transformées en charniers, des sentiers envahis par la végétation, comme honteux de mener quelque part.
Son chant pose la question que chaque survivant a criée en silence : Où aller avec ce chagrin ?
Qui reste pour répondre ? Et aujourd’hui encore, alors que les survivants chantent, des voix s’élèvent — chercheurs, blogueurs, youtubeurs, exilés comme Jambo Asbl, Christine Coleman, Claude Gatebuke ou Gaspar Musabyimana — pour déformer les faits, ridiculiser la douleur et masquer la haine sous un vernis intellectuel.
Eux aussi souhaiteraient qu’il ne reste personne pour raconter l’histoire — non par la machette, mais par le mensonge.
Il n’y a aucune distance morale entre la main qui brandit la lame et la bouche qui en justifie le geste.
Le chant de Nyiranyamibwa passe du deuil personnel à l’oraison funèbre collective :
« Tous les sentiers ont été envahis par la broussaille,
Les belles collines d’autrefois sont désormais couvertes de ruines,
Là où les enfants jouaient, ce sont les vautours qui se reposent, ayiii. »
C’est une poésie née de l’horreur. La métaphore d’une terre elle-même en décomposition reflète le dépérissement de la vie communautaire.
Le Rwanda bien-aimé des souvenirs est englouti par la broussaille et hanté par les charognards. Les collines qui résonnaient autrefois des rires des enfants résonnent désormais des pleurs des orphelins.
« Les pleurs des orphelins t’empêcheront de dormir,
La mère qui a enfanté est à jamais réduite à une vie sans enfants.
Tant de veuves sont malades de leur chagrin indicible, ayiiiiii. »
Pour ceux qui ont survécu, le monde n’est pas silencieux. Il est rempli de cris qui transpercent la nuit. Le deuil est devenu une seconde peau.
Une mère sans enfants est un vase vide, un univers effondré dans le silence. Un orphelin sans personne à appeler « Maman » ou « Papa » est un fil arraché au tissu de l’ascendance.
Nyiranyamibwa ne détourne pas le regard de la réalité grotesque du génocide :
« Les églises de Dieu débordent de cadavres,
Le pays est infesté de mines,
Quand tu survis à la nuit, rien ne te garantit que tu survivras au jour, ayiweeee. »
C’est une théologie de l’abandon. Les sanctuaires sont devenus des abattoirs. Les lieux destinés à la prière sont devenus des tombeaux.
L’auditeur ressent le désespoir de celle qui remet en question jusqu’au rythme le plus fondamental du temps : la nuit et le jour, la sécurité et le danger.
Rien ne peut être digne de confiance. C’est cela, survivre au traumatisme : se réveiller, c’est trahir ceux qui ne se sont jamais réveillés.
Nyiranyamibwa dirige alors le regard avec force vers le mal qui a été déchaîné :
« Ils ont conduit des êtres humains comme du bétail,
Les menant à la mort, ces criminels,
Ayant décrété qu’être Tutsi était un crime absolu, ayiweeee. »
La chanson nous rappelle que le crime de génocide ne se résume pas à l’acte de tuer. C’est la redéfinition d’un être humain en problème à résoudre par la mort.
Les Tutsi ont été déshumanisés, transformés en une infection à éradiquer. Nyiranyamibwa nous rappelle la cruauté avec laquelle cette idéologie a été mise en œuvre :
« Tout Hutu qui n’a pas tué ne méritait pas de vivre,
Déclaré complice des Inkotanyi, il méritait de mourir,
Peu de membres de sa famille ont échappé à la mort. »
Cette rime démantèle le faux binaire souvent propagé par les négationnistes du génocide : l’idée qu’il s’agissait d’une guerre. Ce n’était pas le cas.
C’était un extermination minutieusement planifiée, si complète dans sa cruauté que même ceux qui s’opposaient au côté des tueurs étaient déclarés ennemis.
« Ils (les tueurs) se sont amusés à leurs dépens alors qu’ils n’étaient vêtus que de honte.
Ils les ont dépouillés de tout sur les collines,
C’était comme le chemin de croix vers Golgotha. »
L’utilisation de l’imagerie chrétienne, bien que pas vraiment exacte, est délibérée. Le Rwanda, perçu comme un pays profondément religieux, a vu ses églises transformées en Golgothas.
Nyiranyamibwa évoque la crucifixion comme un moyen de décrire la souffrance collective des Tutsi — humiliés, dépouillés de leur dignité, parés pour la mort.
« Quiconque n’a pas été tué à la machette est mort d’une petite houe usée,
Il fallait payer pour être tué par balle,
Si tu n’achetais pas ta mort, tu étais découpé en morceaux.
C’était impensable, personne n’aurait jamais pu l’imaginer. »
Payer pour une balle était considéré comme une miséricorde — plutôt que d’être tué à la machette.
Que dit cela d’un monde où le prix d’une mort humaine devient un privilège ? Cette chanson porte ces réalités avec une brutalité sans détour.
Et Nyiranyamibwa, après avoir vu cela, retourne en Belgique après 1994 portant non seulement son propre chagrin, mais celui de plus d’un million de personnes.
Son père, Phillip Karahamuheto, a été tué lors des pogroms anti-Tutsi de 1963. Elle avait déjà vécu le génocide avant le génocide.
Elle était déjà en deuil avant 1994. C’est un deuil générationnel. Et pourtant, elle ne finit pas dans la haine.
Suzanne Nyiranyamibwa termine sa chanson non pas par la vengeance, mais par un appel profond — une supplique — à « combattre la haine et le ressentiment. »
C’est un acte de courage de demander à un monde brisé de guérir. Mais la guérison ne peut coexister avec le déni.
Et ceux qui nient le génocide contre les Tutsi — ou qui déguisent ce déni en euphémisme, révisionnisme et faux équilibre — infligent une deuxième mort aux victimes et une nouvelle blessure aux survivants.
Leave None to Tell the Story n’était pas seulement une documentation des atrocités — c’était une accusation prophétique.
Les génocidaires ne visaient pas seulement à tuer des gens ; ils visaient à tuer la mémoire. C’est pourquoi ils ont profané les corps, écrasé les crânes, brûlé les maisons et incinéré les cartes d’identité.
C’est pourquoi ils ont pourchassé les femmes enceintes et les nourrissons. C’est pourquoi ils ont planifié cela dans les écoles, dans les bureaux gouvernementaux, dans les églises.
Et c’est pourquoi le titre du livre est si percutant : parce que les survivants sont sortis des cimetières seuls, sans personne pour leur demander : « Qui étaient mes parents ? Où est mon frère enterré ?
Est-ce que quelqu’un a vu le visage de ma sœur avant qu’elle ne soit emmenée ? » Nyiranyamibwa a donné voix à ce cri : « Ese mbaze nde ? »
L’humanité ne doit pas accorder d’attention à ceux qui feignent l’objectivité tout en hébergeant le déni. Le monde ne doit pas excuser l’ignorance qui devient idéologie.
Toute personne saine d’esprit ne doit pas permettre que la mémoire soit tuée une deuxième fois.
Nier le génocide — ou l’oublier — c’est accomplir la mission des tueurs.
Déformer la vérité, c’est brandir la même machette — mais cette fois, contre la vérité, contre la justice, et contre la dignité des survivants.
Il n’y a pas d’innocence dans le silence.
Voici le principe du survivant : ne pas régler des comptes, mais résister par la vérité. C’est la clarté morale.
Les survivants ne demandent pas de pitié ; ils commandent le souvenir. Ils ne demandent pas de vengeance ; ils exigent des comptes et la justice.
Le lamentation de Nyiranyamibwa n’est pas unique en elle-même. Elle appartient à des milliers de survivants. Des milliers qui sont sortis de la cachette pour ne trouver personne.
Qui ont cherché le chemin du retour et l’ont trouvé envahi. Qui ont attendu d’entendre la voix d’un être cher et n’ont entendu que le silence.
Des enfants qui n’ont plus de nom de famille à transmettre. Des hommes et des femmes qui portent le traumatisme dans leurs os.
Le cri « Ngire nte ? » doit résonner dans chaque conscience rwandaise. Que faisons-nous de ce passé ? Comment l’honorer sans être engloutis par lui ? Comment faire en sorte que « Plus jamais ça » soit plus qu’un slogan ?
La chanson de Nyiranyamibwa semble avoir inspiré ce titre Leave None to Tell the Story. Elle chante parce qu’il reste encore des personnes pour raconter l’histoire. Elle chante pour que nous écoutions.
Le Rwanda ne doit jamais oublier. Le monde ne doit jamais oublier. Car si nous oublions, nous retournons dans l’abîme.
Nyiranyamibwa chante non seulement pour le passé, mais aussi pour l’avenir. Son cri n’est pas seulement rétrospectif ; il est visionnaire.
Il y a des survivants aujourd’hui qui ne savent toujours pas où leurs familles sont enterrées. Qui ne connaissent pas les visages de leurs mères, les voix de leurs pères, ni l’odeur de leurs foyers.
Il y a des enfants nés de viols, maintenant adultes, qui demandent : « Ese mbaze nde ? » Il y a des orphelins qui sont devenus parents sans avoir jamais été parentés eux-mêmes. Il y a des âmes qui errent encore dans les ruines de la mémoire.
Chanter, c’est défier l’oubli. Se souvenir, c’est guérir. Pleurer ensemble, c’est reconstruire ce qui devait être détruit.
La voix de Nyiranyamibwa, brisée par le temps et le chagrin, reste le son le plus authentique de la conscience du Rwanda. Qu’elle résonne à travers notre politique, nos églises et mosquées, nos salles de classe et nos familles.
Que son cri devienne notre appel à l’action. Que son chant soit l’hymne de chaque personne qui choisit l’amour à la haine, la vérité au déni, la mémoire au silence.
Car nous devons nous poser la question, en tant que nation et en tant qu’humanité :
« Ese Mbaze nde ? » À qui puis-je demander ?
La réponse, aussi douloureuse soit-elle, pourrait bien être : Toi.
C’est toi qui dois raconter l’histoire. C’est toi qu’ils doivent interroger. Tu es le gardien de la mémoire.
Que l’histoire ne meure jamais. Que le silence ne revienne jamais. Que la musique de la vérité résonne plus fort que les tambours de la haine.
Suzanne Nyiranyamibwa a chanté, et en le faisant, elle nous a donné le courage de répondre :
« Ngire nte ? »
Voici comment : Nous nous souvenons. Nous protégeons la vérité. Nous élevons une génération qui s’incline devant l’histoire sacrée de la survie et se lève pour dire :
Plus jamais, ce n’est pas négociable. Plus jamais, c’est maintenant.

















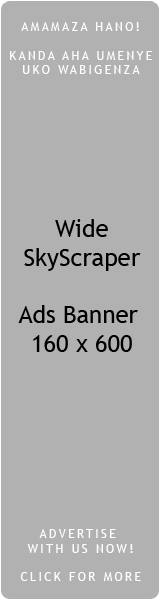
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!