Face aux multiples crises sécuritaires, sociales, morales qui gangrènent la République Démocratique du Congo, le pouvoir en place semble avoir choisi, non pas le chemin de la vérité ni celui de la réforme, mais la stratégie du renversement accusatoire, transformant chaque mise en cause en prétexte pour brandir l’épouvantail d’un complot imaginaire.
À mesure que les scandales s’accumulent, que les affaires de corruption éclaboussent jusqu’aux plus hauts sommets de l’État, que des figures infréquentables et parfois judiciairement compromises deviennent les pivots de l’architecture présidentielle, la rhétorique victimaire s’intensifie.
L’on ne gouverne plus par la vertu, mais par l’anathème. Toute critique devient “discours de haine”, toute mise en lumière devient “manœuvre de déstabilisation”.
Ce glissement inquiétant traduit une volonté manifeste de substituer à l’examen des responsabilités une rhétorique de la persécution, où le pouvoir se rêve en bastion assiégé, au lieu de répondre à l’épreuve des faits.
Mais de quoi Tshisekedi est-il donc victime, sinon de son propre système ?
Un système où le tribalisme a remplacé la compétence, où les réseaux parallèles se substituent aux institutions, où les contorsions juridiques valent signature, et où l’impunité s’érige en doctrine d’État. Ce pouvoir qui s’offusque d’être questionné est pourtant celui-là même qui conteste ses engagements, renie ses propres signatures, piétine la parole donnée et s’arroge une immunité morale qui défie toute logique républicaine.
Dans ce paysage confus, le débat public est volontairement faussé. Les véritables enjeux, la délitescence de l’administration publique, la dépravation des mœurs au sein de l’élite, l’inversion des valeurs citoyennes, les persécutions ciblées, notamment à l’égard des tutsi congolais sont relégués à la périphérie du discours officiel.
Dans une fuite en avant de plus en plus manifeste, le pouvoir s’emploie à saturer l’espace public d’éléments de langage creux, de slogans martelés à l’envi, vidés de leur substance mais lourds d’intentions manipulatrices.
Ces mots, répétés comme des mantras, ne visent pas à éclairer la conscience nationale, mais à l’endormir. La parole officielle, loin d’être un outil de transparence, devient un instrument d’occultation, une arme rhétorique utilisée non pour édifier, mais pour dissimuler l’effritement progressif du socle républicain.
À cela s’ajoute l’instrumentalisation méthodique des médias, domestiqués ou intimidés, réduits à de simples caisses de résonance d’une vérité d’État dictée par les convenances du moment. Une armée de porte-voix dociles et convenus, parfois parés des atours du journalisme ou de l’expertise, se déploie pour relayer l’illusion d’un ordre maîtrisé, pendant que les fractures internes s’approfondissent.
Derrière cette façade savamment mise en scène, le réel gronde, indocile, et expose les dissonances structurelles d’un régime qui se délite à mesure qu’il s’accroche aux oripeaux d’une légitimité sans fondement éthique.
Ainsi, au lieu de faire face à l’impératif de moralisation de la vie publique, on distrait l’opinion avec des polémiques secondaires, on fabrique des ennemis fictifs, on sanctuarise les mensonges et l’outrance. Le tout au nom d’un pouvoir dont l’exercice semble désormais échapper à toute exigence de rigueur, de transparence et de responsabilité.
Faut-il alors rappeler à Tshisekedi comme à ceux qui s’accrochent à ses pas qu’il n’est pas de justice sans morale, et qu’en politique, c’est pareil ?
Gouverner ne saurait être réduit à l’exercice d’un privilège ou à la jouissance d’une position hiérarchique. C’est, avant tout, une charge solennelle, un mandat de conscience confié par le peuple à ceux qui prétendent parler en son nom.
Ce devoir transcende les intérêts particuliers, les fidélités claniques ou les stratégies de conservation du pouvoir. Il exige hauteur de vue, probité intransigeante, et sens aigu de la chose publique. Gouverner, c’est consentir à l’exigence de l’exemplarité, c’est répondre à l’appel silencieux de l’Histoire qui n’élève durablement que ceux dont les actes réconcilient l’autorité et la vertu.
C’est pourquoi le véritable homme d’État n’usurpe pas la République : il l’incarne. Il n’en détourne ni les symboles ni les institutions à des fins personnelles, mais s’efface humblement devant l’idéal qu’elle représente.
Travestir la République, c’est trahir le pacte fondateur ; s’en servir pour asseoir un pouvoir personnel, c’est en corrompre l’essence même. La République n’est ni un paravent pour l’arbitraire, ni un théâtre pour les ambitions sans frein : elle est une exigence morale, un engagement de chaque instant au service du bien commun et de la justice partagée.
L’histoire, elle, n’a cure des justifications de circonstance. Elle ne retient que les actes et les renoncements. Et à l’allure où les digues institutionnelles cèdent, il est à craindre que ce régime, plus prompt à nier qu’à réparer, soit moins victime d’un complot que de sa propre architecture du déni.









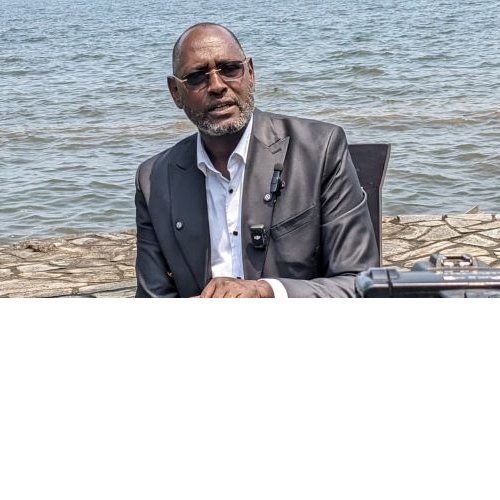









AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!