Aucun crime préalable, aucune menace, aucune faute : seulement un visage, une apparence, une assignation identitaire devenue, dans un climat délétère, un verdict irrévocable.
Cet assassinat n’est pas seulement un fait divers tragique ; il est le symptôme aigu d’une décomposition morale et politique. Il révèle un basculement inquiétant : celui d’une société où l’appartenance réelle ou fantasmée supplante la citoyenneté, où l’humanité se dissout dans la suspicion ethnique, où le corps même devient une preuve à charge.
Le meurtre au motif du faciès marque l’effondrement du pacte social le plus élémentaire : celui qui reconnaît à chaque être humain une dignité inaliénable, indépendamment de son origine supposée.
La gravité de la situation ne saurait être minimisée. Nous ne sommes plus dans l’exception, mais dans une dynamique répétitive, annonciatrice de dérives plus vastes. Lorsqu’une mère est exécutée chez elle pour ce qu’elle « ressemble » être, c’est toute la société qui se trouve placée devant un miroir sans indulgence, révélant l’abîme où mène la banalisation de la haine.
La chaîne de la haine : responsabilité des élites et faillite de l’État protecteur
Il serait non seulement naïf, mais intellectuellement malhonnête, de considérer cet acte comme isolé. Il s’inscrit dans la droite ligne d’un discours de haine méthodiquement alimenté, légitimé et relayé au sommet de l’État.
Du Président de la République à son porte-parole Patrick Muyaya, en passant par l’ancien porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, et le député et ancien ministre Justin Bitakwira, une parole publique dangereuse a prospéré, désignant, stigmatisant, essentialisant.
Certes, la brochette n’est pas complète. Mais l’échantillon est suffisamment représentatif pour établir une responsabilité politique et morale écrasante. Car les mots, surtout lorsqu’ils émanent des plus hautes sphères du pouvoir, ne sont jamais neutres. Ils façonnent les perceptions, légitiment les pulsions, désinhibent les passages à l’acte.
A force de désigner un groupe comme suspect, étranger ou intrinsèquement hostile, on finit par produire ce que l’on prétend combattre : la violence nue, livrée à elle-même, débarrassée de toute retenue.
L’État, qui devrait être le rempart contre l’arbitraire, devient alors son amplificateur. L’autorité, au lieu de protéger, expose. La parole officielle, au lieu d’apaiser, enflamme. Et lorsque l’impunité s’ajoute à l’incitation, le crime cesse d’être une transgression : il devient, pour certains, un acte toléré, sinon encouragé.
Ce qui s’est produit à Uvira est une alerte tragique. Il ne s’agit plus seulement de condamner avec des formules creuses, mais de rompre clairement avec la politique de la désignation, de rappeler que la République ne reconnaît ni faciès coupable ni citoyenneté conditionnelle.
Faute de quoi, la spirale de la violence continuera d’engloutir des vies innocentes, pendant que l’histoire, implacable, consignera la responsabilité de ceux qui savaient et ont choisi de se taire ou de parler pour attiser le feu.


















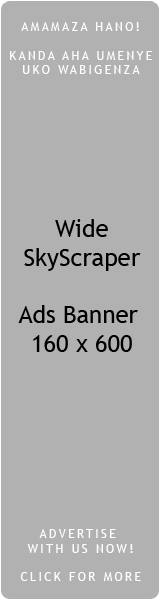
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!