Selon le ministre de la Communication du gouvernement, Patrick Muyaya, le président de la République a exprimé son « regret et sa vive désapprobation » à l’égard des propos tenus par le général-major Sylvain Ekenge, les jugeant « incompatibles avec les valeurs républicaines et la cohésion nationale ». On en viendrait presque à attendre un accompagnement de violons pour souligner cette soudaine élévation morale.
Sauf que ce qu’a livré le général Ekenge n’était ni un simple dérapage verbal, ni une maladresse de langage, ni un excès d’ardeur patriotique lors d’un défilé. Il s’agissait d’une diatribe venimeuse et structurée, diffusée sur la chaîne nationale RTNC, mobilisant la haine contre un groupe clairement identifiable, les Tutsi, et déshumanisant spécifiquement les femmes tutsi.
Ce ne sont pas de simples « propos ». C’est un discours de haine inscrit dans une tradition, porteur d’une généalogie idéologique et de conséquences historiquement meurtrières dans la région des Grands Lacs.
Pourtant, devant la plus haute instance morale de la RDC, la Présidence, cela se transforme en une affaire d’indiscipline. La sanction ? Une suspension de ses fonctions de porte-parole. Ni arrestation. Ni poursuites judiciaires. Ni saisi d’un tribunal. Juste une mise à l’écart professionnelle, comme si le général avait manqué un briefing ou omis de saluer un supérieur.
Il faut saluer une telle retenue. Lorsque la parole constitue un danger réel pour la vie de centaines de milliers, voire de millions, de personnes dans une région déjà hautement inflammable, le commandant en chef ne brandit pas la loi, mais une stratégie de communication.
Ainsi, le président Tshisekedi a « ordonné la mise en place immédiate d’une communication publique coordonnée afin d’éviter tout nouveau dérapage ». Traduction non diplomatique : le problème n’est ni l’idéologie, ni l’incitation, ni l’autorité en uniforme qui la profère. Le problème, c’est le message. Le général est simplement sorti du script.
Voici la parodie exacte. Le général Ekenge s’exprimait en uniforme militaire, orné d’insignes officiels, incarnant le monopole étatique de la violence légitime. Pourtant, l’infraction, nous dit-on, ne serait pas de nature pénale mais rhétorique. Il n’aurait pas fauté sur le fond, mais sur la forme.
Il ne l’a simplement pas dit « comme il fallait ». S’il avait murmuré ses propos dans un langage codé, les avait délégués à des milices, ou les avait enveloppés de chants nationalistes, peut-être auraient-ils été jugés acceptables.
Cette minimisation transforme le droit en une simple affaire d’étiquette. C’est précisément ce que les normes internationales ont été conçues pour empêcher.
Le droit n’admet pas les euphémismes
L’interdiction de l’incitation à la haine n’est pas une question de sensibilité ou de convenance : c’est une obligation juridique contraignante. L’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) impose aux États de criminaliser la diffusion d’idées fondées sur la haine raciale ainsi que toute incitation à la discrimination ou à la violence.
L’article 20, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) exige que soit interdite par la loi « toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».
Pour préciser la manière dont ces obligations s’articulent avec la liberté d’expression, des juristes ont élaboré les Principes de Camden sur la liberté d’expression et l’égalité. Le principe n° 12 est sans ambiguïté : « Tous les États devraient adopter une législation interdisant toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (discours de haine). »
Le principe 12.1 définit ces notions avec une précision quasi chirurgicale. La « haine » et « l’hostilité » renvoient à des « émotions intenses et irrationnelles de mépris, d’inimitié et de détestation à l’égard du groupe ciblé ». L’« apologie » suppose l’intention de promouvoir publiquement la haine. L’« incitation » désigne des déclarations qui créent un risque imminent de discrimination, d’hostilité ou de violence à l’encontre des personnes appartenant au groupe visé.
À l’aune de ces normes, ce que le général Ekenge a fait sur la RTNC le 27 décembre 2025 ne souffre d’aucune ambiguïté. Il s’agit d’une incitation à la haine, rien de moins. Lorsque de tels propos sont tenus par un général de l’armée, diffusés sur une chaîne nationale, dans un pays profondément marqué par les violences ethniques et les milices transfrontalières, le seuil du « risque imminent » n’a rien de théorique. Il est un fait historique.
Le principe 12.2 ajoute une autre garantie contre l’amnésie stratégique : « Les États devraient interdire la justification ou la négation des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, mais uniquement lorsque de telles déclarations constituent un discours de haine tel que défini par le principe 12.1. »
Cela est fondamental, car la négation et la banalisation ne sont jamais des actes neutres ; dans la région des Grands Lacs africains, elles agissent comme des accélérateurs. Lorsque Kinshasa invite et soutient un négationniste condamné pour génocide tel que Charles Onana, ou héberge et tolère une organisation génocidaire comme les FDLR, elle viole sciemment l’esprit et la lettre de ces principes, en normalisant des récits qui préparent les crimes de demain tout en jouant la comédie de l’engagement pour la paix.
Par ailleurs, le cadre normatif de l’UNESCO dissipe toute ambiguïté résiduelle. Dans ses travaux sur la lutte contre le discours de haine et la prévention des atrocités de masse, l’UNESCO souligne que les États ont une obligation positive non seulement de s’abstenir de tout discours de haine, mais aussi d’en empêcher activement la diffusion, en particulier lorsqu’elle émane de responsables publics ou de médias contrôlés par l’État.
Les orientations de l’UNESCO de 2015 et de 2022 sur le discours de haine insistent sur le fait que les expressions qui déshumanisent des groupes protégés, surtout dans des sociétés fragiles ou en sortie de conflit, constituent une menace directe pour la paix et doivent entraîner une responsabilité juridique, et non de simples corrections administratives.
L’UNESCO avertit en outre que le silence de l’État, l’usage d’euphémismes ou une communication prétendument « équilibrée » face à l’incitation équivalent à une complicité institutionnelle. La mémoire, rappelle l’UNESCO, est vide de sens sans justice. Et, de la même manière, la prévention est difficile, voire impossible, sans désigner clairement les responsables. Une paix fondée sur la neutralité rhétorique n’est rien d’autre qu’une violence ajournée.
Le langage génocidaire réduit à une question de ton
Pour le président Tshisekedi, semble-t-il - du moins veut-on nous le faire croire - son général aurait improvisé. Il n’en est rien. Le discours d’Ekenge s’inscrit dans un canon parfaitement rodé : le répertoire idéologique du Hutu Power rwandais, affiné sur plusieurs décennies, exporté, adapté et déployé partout où la responsabilité pénale est fragile ou inexistante. Ce n’est pas l’ignorance qui parle ici, mais la maîtrise. Et la maîtrise d’une idéologie génocidaire ne se soigne pas par une suspension de micro.
Poussez d’un cran le raisonnement présidentiel, et l’histoire elle-même devient obscène. Si l’incitation au génocide n’est qu’un manquement à la discipline, alors les architectes des pages les plus sombres de l’humanité n’étaient pas des criminels, mais de piètres communicateurs.
Si le président Tshisekedi avait siégé comme juge au TPIR, la justice aurait été expéditive et inexistante. Théoneste Bagosora n’aurait pas été un planificateur de l’extermination, mais un homme imprudent dans ses propos, insuffisamment formé à la retenue verbale. Jean Kambanda aurait été jugé non comme le chef d’un gouvernement génocidaire, mais comme un responsable ayant trahi les valeurs républicaines. Pour Tshisekedi, Kambanda aurait simplement échoué à aligner sa rhétorique sur la « cohésion nationale ».
Et Hassan Ngeze ? Son crime, selon cette logique, n’aurait pas été d’avoir transformé la haine en imprimé, mais d’avoir publié sans modération éditoriale, faisant preuve d’un zèle excessif. Le général-major Augustin Bizimungu ? Suspendu de ses fonctions. Aucun d’entre eux, après tout, n’a personnellement manié une machette ou lancé une grenade. Dans un tel univers moral grotesque, le génocide n’est pas illégal : il est seulement inélégant.
En suivant ce même raisonnement, on frémit à l’idée de la manière dont le président Tshisekedi aurait jugé les propagandistes les plus tristement célèbres de l’Europe. Josef Goebbels n’a gazé personne de ses propres mains ; Julius Streicher maniait l’encre, pas le pistolet ni les balles. Tous deux auraient sans doute été convoqués devant un conseil des ministres, solennellement informés que leur langage était regrettable, invités à tempérer leur ton, à diversifier leurs métaphores, et à soumettre leurs futurs éditoriaux à validation préalable.
Peut-être Der Stürmer aurait-il été suspendu, et non interdit. Peut-être Goebbels aurait-il été invité à adopter une « stratégie de communication coordonnée » afin d’éviter les excès, tout en continuant à préparer psychologiquement la population à l’anéantissement.
Au sein de l’univers éthique de Kinshasa, ces deux hommes auraient pu échapper à la justice au prix d’une sévère remontrance sur la modération du langage, invités à tempérer leur vocabulaire, affiner leurs métaphores et aligner leur rhétorique sur la « cohésion nationale ». Leur faute, semble-t-il, n’aurait pas été d’avoir préparé le terrain à l’Holocauste, mais d’avoir parlé trop fort, trop ouvertement, et sans une retenue communicationnelle suffisante.
Nous touchons ici à l’aboutissement ultime du blanchiment idéologique par les bonnes manières. Lorsqu’une forme extrême de violence de masse est réduite à une entorse à la bienséance, l’État devient complice, non par l’action, mais par la reformulation.
C’est ainsi que l’idéologie survit : non par la négation, mais par la dégradation procédurale. Quand le droit se replie sur l’étiquette, le meurtre de masse n’a plus besoin de justification. Il exige seulement une meilleure formulation.
La propagande en vitesse de croisière
Encore vive dans la mémoire collective - et manifestement encore trop sonore dans les couloirs du pouvoir - la tentative d’étouffer le scandale Ekenge a entraîné le gouvernement congolais dans une nouvelle démonstration de médiocrité spectaculaire. Et dans ce registre, il faut le reconnaître, l’administration du président Félix Tshisekedi n’a pas d’égale. Face aux crises de crédibilité, elle ne corrige pas le cap ; elle s’enfonce dans la farce.
Ainsi, aux premières heures du samedi 3 janvier 2026, la propagande est passée en vitesse de croisière. Les FARDC ont exhibé des prisonniers devant la presse, vêtus d’uniformes militaires, solennellement présentés comme des soldats capturés des Forces de défense rwandaises (RDF).
La chorégraphie était connue, le jeu d’acteurs maladroit, le scénario famélique. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a résumé le spectacle avec une économie de mots dévastatrice sur X : « Ce que nous voyons est une grossière mise en scène médiatique, à laquelle même ses propres metteurs en scène ne croient plus. » Ce n’était pas de la diplomatie, mais un diagnostic.
En effet, la mise en scène s’est effondrée sous le poids de son propre recyclage. L’un des prétendus soldats RDF présentés ce jour-là n’était autre que Ndayambaje Abuba, une figure déjà connue du public. Le 16 février 2024, le colonel Guillaume Ndjike Kaiko, alors porte-parole des FARDC au Nord-Kivu, avait présenté à la presse ce même jeune homme émacié comme un soldat RDF « originaire d’un lieu appelé Kayonza », commodément dépourvu de matricule, et vêtu d’un uniforme visiblement flambant neuf. L’authenticité, apparemment, peut se confectionner du jour au lendemain.
Ce que le colonel Ndjike avait soit oublié, soit supposé que le public oublierait, c’est que le même individu avait déjà été exhibé environ un ans plus tôt, à la mi-janvier 2024, vêtu de haillons civils, pieds nus, avec des pieds manifestement étrangers à la discipline - et à l’inconfort - des bottes militaires. La transformation d’un civil en haillons en soldat des RDF n’a nécessité ni entraînement, ni enrôlement, ni temps. Il suffisait d’un uniforme et d’un récit complaisant.
Il ne s’agit pas d’un échec du renseignement ; c’est du mépris. Mépris des preuves, de la mémoire et de l’intelligence des citoyens congolais comme des observateurs internationaux. Lorsque des États recyclent des acteurs en différents costumes, ils ne se contentent pas de mentir : ils testent combien la vérité compte encore peu.
Le même jour, la MONUSCO a pris la parole sur X pour manifester son indignation rituelle : « La MONUSCO est profondément préoccupée par les informations faisant état d’une frappe de drone à Masisi Centre. Elle condamne fermement toute attaque, y compris par drones, visant ou affectant des civils et des infrastructures civiles. » Les larmes étaient publiques ; les responsables, non.
Cette amnésie institutionnelle perd moins de mystère lorsque l’on se rappelle que le président Tshisekedi avait déjà promis de « recalibrer » la stratégie de communication de son gouvernement. Dans cette nouvelle doctrine, la clarté cède la place à la préoccupation, et la responsabilité à la grammaire.
La condamnation à demi-mesure, évitant soigneusement de mentionner les FARDC comme auteurs de ce crime de guerre contre les civils congolais, est parfaitement compréhensible. Le 4 novembre 2025, la MONUSCO annonçait fièrement sur X avoir formé 120 soldats des FARDC en Ituri, y compris à l’usage de drones et d’armes lourdes. Lorsque les diplômés de cette formation ont appliqué leurs nouvelles compétences non pas contre des ennemis armés, mais contre des habitations civiles à Masisi Centre, la discrétion est devenue le dernier refuge : condamner l’acte, effacer l’auteur.
C’est ainsi que se comportent les alliés lorsque la responsabilité menace le partenariat. Ou que se comportent les complices lorsqu’une exposition se profile. La propagande, bien huilée et honteusement répétitive, poursuit son œuvre - non pour persuader, mais pour épuiser. Dans un tel système, la vérité n’est pas vaincue par de meilleurs mensonges ; elle est ensevelie sous des couches de médiocrité, jusqu’à ce que la fatigue remplace l’indignation et que le spectacle se substitue à la justice.
Médecins Sans Frontières a fait écho à l’indignation, compté les blessés, soigné les corps brisés, tout en refusant également de nommer la main qui les a brisés. Ainsi, la doctrine fut perfectionnée : la violence sans auteurs, les victimes sans agresseurs, la souffrance sans responsabilité. Ce n’est pas de la neutralité ; c’est de la gestion narrative. Lorsque les bombes tombent et que personne n’est nommé, la communication ne prévient pas les excès - elle les efface. Et l’effacement, l’histoire nous l’enseigne, n’est pas l’opposé de la violence. Il en est le complice.
L’impunité baptisée unité
On nous dit à Kinshasa que la cohésion nationale se préserve en gérant la parole plutôt qu’en confrontant son sens. La leçon est sans équivoque : la haine peut être diffusée, tant qu’elle est correctement emballée. Des vies peuvent être mises en danger, tant que la cohésion est affirmée rhétoriquement.
Aucune stratégie de communication n’a jamais stoppé un génocide. Seuls le droit, la responsabilité et la clarté morale y parviennent, et seulement lorsque les dirigeants les choisissent au détriment du confort.
Les spécialistes de la violence de masse alertent depuis des décennies : Gregory Stanton a identifié la déshumanisation comme une étape décisive du génocide ; Jacques Sémelin a montré comment le langage normalise l’impensable ; Martha Minow a démontré que l’absence de poursuites constitue un signal de permission. Ce ne sont pas des abstractions : ce sont des avertissements gravés dans les tombes à travers toute la région.
À Kinshasa, le confort a triomphé. L’uniforme du général a été délicatement plié. Le micro a été retiré. L’idéologie est restée intacte. L’incitation a été requalifiée d’indiscipline. La loi a été remplacée par la police du ton. Et l’histoire - patiente, précise et implacable - a pris note.
Si les valeurs « républicaines » doivent avoir un sens en RDC, elles doivent être appliquées lorsque cela est inconfortable, et non invoquées seulement lorsqu’il est commode. Autrement, le « regret et la vive désapprobation » de Tshisekedi n’est pas une position morale, mais une répétition pour le déni.
À Kinshasa, le confort n’a pas seulement remporté la journée, il a été intronisé comme doctrine. L’uniforme a été soigneusement plié, le micro discrètement retiré, et l’idéologie préservée avec attention, comme un dangereux trésor familial enveloppé dans un langage « républicain ».
L’incitation a été requalifiée en indiscipline ; la haine a été présentée comme un excès ; et la loi a été remplacée par la police du ton. C’est une gouvernance par code, où la violence de masse n’est jamais niée, seulement adoucie grammaticalement. L’histoire, en revanche, a une oreille impitoyable. Elle n’écoute pas la civilité ; elle écoute les conséquences.
Ce qui en ressort, c’est un État qui ne nie pas le danger, il choisit de le gérer de manière cosmétique. Un État qui croit que le génocide ne commence pas par l’idéologie, mais par une mauvaise formulation. Un État qui traite les uniformes comme une absolution et le silence comme une sagesse.
Dans un tel pays, les auteurs ne sont pas poursuivis ; ils sont repositionnés. Les victimes ne sont pas protégées ; elles sont gérées pour les violences à venir. Et la justice n’est pas refusée ouvertement, elle est indéfiniment reportée au nom de la cohésion.
Mais une cohésion bâtie sur le déni n’est pas l’unité ; c’est une trêve avec la vérité. « Regret et vive désapprobation », répétés suffisamment, deviennent un rituel - accompli après le discours, après les bombes, après les funérailles. Et l’histoire, patiente et impitoyable, n’enregistre pas les mots prononcés dans les conseils des ministres, mais les choix faits lorsque la loi exigeait du courage et que les dirigeants ont choisi le confort.
Leçons d’une indignation sélective
Ce qui rend l’épisode Ekenge véritablement révélateur, ce n’est pas ce qui a été condamné, mais ce qui ne l’a jamais été. Pendant des années, des individus comme Justin Bitakwira et d’autres ont multiplié des incitations sans retenue contre les Tutsi.
Leur langage est si catégorique, si répétitif et venimeux qu’il n’a même plus besoin de masquer son intention. Pourtant, le président Tshisekedi ne les a jamais publiquement admonestés. Aucun regret. Aucune vive désapprobation. Aucune inquiétude soudaine pour les « valeurs républicaines » ou la cohésion nationale. Au contraire un silence long, délibéré, instructif.
La honte, apparemment, ne résidait pas dans les mots caustiques. Elle résidait dans l’uniforme militaire sur la RTNC. Le discours de haine, lorsqu’il est prononcé par des politiciens, des prétendus activistes ou des démagogues civils, est tolérable - voire utile. Mais lorsqu’il est proféré par un général en tenue complète, diffusé au monde entier, il vient perturber la fiction soigneusement cultivée. Il révèle ce qui est généralement externalisé : la continuité idéologique entre les incitateurs civils, les extrémistes anti-Tutsi tolérés et la force armée qui finit par agir.
Rien de tout cela n’est nouveau. Cela suit un schéma si documenté qu’il frôle désormais la farce. Chaque grand échec de prévention du génocide commence de la même manière : l’incitation est détectée, contextualisée, minimisée, puis finalement normalisée.
Le président Tshisekedi connaît bien ce calcul. Il sait aussi que le monde lève rarement le petit doigt. Il publie des déclarations, exprime son inquiétude, appelle à la retenue et évite de nommer les responsables. Le silence n’a jamais été puni ; il a été récompensé par la patience diplomatique.
Et le message est parfait : la haine n’est pas le problème - c’est sa visibilité. Dites-la discrètement, répétez-la souvent, prononcez-la hors uniforme, et l’État détournera le regard. Dites-la trop ouvertement, trop officiellement, et vous serez suspendu - non pour ce que vous avez voulu dire, mais pour avoir rendu impossible la feinte d’ignorance.
Au Rwanda, le génocide contre les Tutsi a été précédé par des incitations publiques, prononcées ouvertement et à maintes reprises par des responsables, mais considérées comme non poursuivables.
Le propre bilan des Nations unies est accablant. La doctrine du « plus jamais » s’est à plusieurs reprises effondrée en « pas encore », puis en « trop tard ». Le génocide n’éclate pas dans le chaos : il naît de la permission, accordée lorsque les dirigeants traitent son idéologie comme un discours, le discours de haine comme un excès, et l’excès comme le problème de quelqu’un d’autre.


















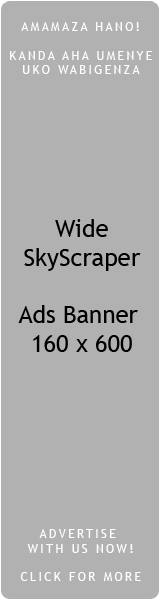
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!