Le 15 octobre, la plus haute juridiction administrative de France a opposé une fin de non-recevoir au recours formé par la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, contestant l’application immédiate de sa peine d’inéligibilité consécutive à sa condamnation dans l’affaire retentissante des assistants parlementaires européens.
Cette décision, dont la portée politique est considérable, verrouille pour l’heure l’accès de Mme Le Pen à toute compétition électorale d’envergure, qu’il s’agisse de législatives anticipées ou de la présidentielle de 2027.
Rappelons que, le 31 mars, le tribunal correctionnel l’avait reconnue coupable d’avoir été l’architecte d’un système ayant permis, entre 2004 et 2016, de rémunérer avec des fonds communautaires à hauteur de 4 millions d’euros des salariés travaillant en réalité pour le parti.
Elle a été condamnée à quatre années d’emprisonnement, dont deux fermes aménagées sous bracelet électronique, à une amende de 100 000 euros et à une peine d’inéligibilité de cinq années assortie de l’exécution provisoire. Son procès en appel est prévu du 13 janvier au 12 février, et la décision de la cour devrait intervenir avant l’été 2026, à l’orée de la campagne présidentielle.
Dans son recours, Mme Le Pen contestait sa radiation des listes électorales, intervenue en avril, et demandait au Conseil d’État de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, estimant que les dispositions légales encadrant cette radiation portaient atteinte à la liberté de candidature et à celle des électeurs.
Le Conseil d’État a opposé un raisonnement limpide : la requête ne tendait pas à l’abrogation d’un simple acte réglementaire, mais à une modification législative, ce qui excède les compétences du Premier ministre et, partant, celles de la juridiction administrative. Le rapporteur public avait par ailleurs jugé que les dispositions invoquées ne trouvaient pas à s’appliquer dans le cadre du contentieux électoral relatif à l’inscription sur les listes.
Dès lors, le Conseil d’État, exerçant son rôle de filtre des QPC, a rejeté la demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de sérieux et d’applicabilité requises pour une transmission. Ce faisant, il confirme que la sanction d’inéligibilité reste immédiatement exécutoire, sauf revirement en appel hypothèse sur laquelle l’intéressée fonde manifestement ses espoirs.
Mais au-delà de la technicité juridique, cette affaire révèle une tendance structurelle du débat public français : nombre de responsables politiques, acculés par des procédures judiciaires, adoptent une posture de défiance systématique à l’égard des magistrats.
Plutôt que d’assumer la gravité des faits qui leur sont reprochés, ils s’emploient à délégitimer l’institution judiciaire, en l’accusant d’acharnement, de partialité, voire de complotisme institutionnalisé. Ce réflexe pavlovien d’inversion des responsabilités a pour effet d’éroder la confiance dans l’État de droit tout en confortant une culture politique de l’impunité.
En se présentant en victime de l’appareil judiciaire, Mme Le Pen s’inscrit dans une longue lignée d’hommes et de femmes politiques français pour lesquels la justice n’est tolérée qu’à condition de ne jamais les atteindre. Ce jeu dangereux, qui consiste à transformer les juges en boucs émissaires d’affaires judiciaires solidement étayées, témoigne d’un mépris latent pour les institutions républicaines et pour les principes mêmes de la responsabilité publique.
En somme, cette décision n’est pas seulement un épisode judiciaire : elle éclaire crûment un travers récurrent de la vie politique française, cette inclination persistante à contester non pas les faits reprochés, mais l’existence même de la sanction, comme si le droit, dans sa rigueur, devait s’effacer devant le privilège politique.











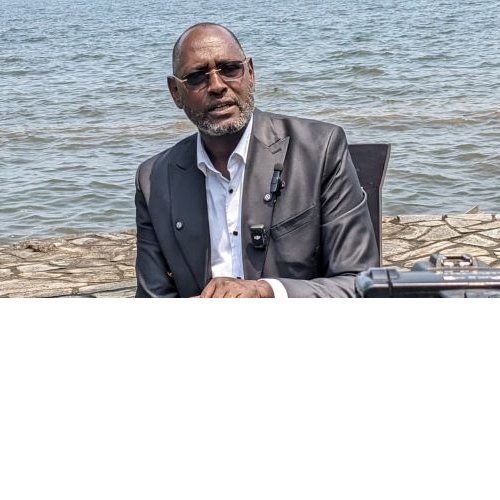







AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!