Les bourreaux de 1994, qui ont orchestré la plus grande tragédie humaine de la fin du XXe siècle, peuvent se travestir, changer d’identité, s’abriter derrière des complicités savamment organisées ou des réseaux diplomatiques bien huilés rien n’y fait. L’impératif moral et judiciaire de leur reddition est désormais inscrit dans le marbre du droit international comme dans la conscience universelle.
Au fil des ans, plusieurs de ces criminels, jadis puissants dans l’ombre des machettes et des transistors appelant au massacre, se sont éparpillés aux quatre coins du monde. L’Europe, l’Amérique, l’Afrique centrale et australe ont vu passer, ou s’installer, des figures clés du génocide, qui ont tenté de se fondre dans les sociétés d’accueil, souvent avec le concours de réseaux diasporiques bien implantés, parfois même avec la mansuétude de certains États, sous prétexte de procédures d’asile ou de considérations politiques.
Ce cynisme diplomatique n’a pourtant pas résisté à la persévérance de la justice rwandaise, à la détermination de ses institutions mémorielles, et à la mobilisation d’une société civile qui ne cesse de réclamer que justice soit rendue.
Le dernier épisode en date illustre avec éclat cette implacable volonté de vérité : l’extradition vers Kigali, depuis la Suède, d’un des génocidaires présumés, qui pensait avoir trouvé dans la froideur scandinave un anonymat protecteur. Peine perdue.
Le voile de l’impunité se déchire toujours, tôt ou tard, devant le regard inflexible de la mémoire. Ce transfèrement n’est pas un acte banal de coopération judiciaire : il est un rappel solennel que les crimes contre l’humanité ne se prescrivent pas, que les États démocratiques ne peuvent accueillir dans leurs plis les vestiges de la barbarie, et que la justice, même lente, finit toujours par frapper à la porte de l’oubli.
Car il ne s’agit pas seulement de juger des hommes. Il s’agit de défendre un principe fondamental : celui selon lequel l’inhumanité ne peut jamais être un passeport vers l’oubli. Les génocidaires n’auront ni havre, ni répit, ni silence complice. La République du Rwanda, épaulée par un réseau international de justice et de mémoire, s’emploie, depuis trente ans, à déconstruire ce mythe de l’inaccessibilité.
Chaque arrestation, chaque extradition, chaque procès, même tardif, est une victoire contre la fatalité de l’impunité. C’est aussi un acte de fidélité envers les plus d’un million de victimes qui gisent dans la terre de leur pays ou dans la mémoire de leurs descendants.
À ceux qui, en coulisses, continuent de les protéger, de leur offrir des relais financiers ou diplomatiques, il faut rappeler que protéger un génocidaire, c’est prolonger le génocide. Fermer les yeux sur ces présences clandestines, c’est trahir la morale universelle. Il est grand temps que toutes les nations sans exception fassent de la traque des génocidaires un devoir de justice et un acte de respect envers la mémoire de l’humanité tout entière.
Il n’y aura pas de sanctuaire. Il n’y aura pas d’amnistie tacite. Tant que l’un d’eux respirera quelque part en homme libre, le combat pour la mémoire et la justice continuera. Car un monde qui tolère les génocidaires est un monde complice. Et l’histoire, inlassablement, jugera.














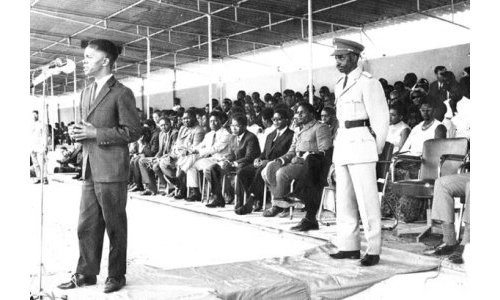




AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!