Et trônant au-dessus de ce défilé de relents coloniaux se trouve le professeur belge Filip Reyntjens, un homme qui persiste à se comporter comme si son passeport lui conférait un mandat à vie pour décider de l’histoire, de l’identité et de la politique rwandaises. Il s’est autoproclamé grand prêtre de l’histoire du Rwanda, peut-être le dernier missionnaire convaincu que les nations africaines requièrent éternellement sa tutelle intellectuelle.
Voici un homme dont l’« expertise », si tant est que le terme s’applique, ne s’est pas forgée dans le creuset d’une étude objective, mais dans les couloirs feutrés du régime génocidaire de Juvénal Habyarimana, où il servit de conseiller de confiance, d’interlocuteur privilégié et parfois même de représentant sur la scène internationale.
Il incarne parfaitement l’arrogance coloniale. Imaginez le missionnaire persuadé que Dieu ne parlait qu’à lui ; l’administrateur colonial convaincu que les Africains devaient être « civilisés » à la pointe du fusil. Imaginez aussi l’ethnographe colonial qui classait les êtres humains comme on épingle des papillons dans un laboratoire ; le « savant » prétendant connaître les sociétés africaines mieux que les Africains eux-mêmes. Imaginez cette caste survivre encore, donnant des leçons, tweetant, sermonnant et admonestant longtemps après la fin officielle de l’époque coloniale.
Reyntjens incarne un paradoxe propre à certains universitaires européens qui ont autrefois joui d’un accès privilégié aux dictatures africaines : celui de l’expert désormais impuissant, incapable d’accepter son insignifiance actuelle. Tel un monarque déchu privé de son trône, il continue de croire que le Rwanda devrait s’agenouiller lorsqu’il parle. Et, à l’image de tous les intermédiaires coloniaux qui l’ont précédé, missionnaires, administrateurs, commissaires de district, il peine à comprendre une vérité pourtant simple : le Rwanda ne lui répond plus.
Mais la nostalgie coloniale est une maladie tenace. Et dans le cas de Reyntjens, elle a évolué en un véritable syndrome, qui se manifeste dans ses écrits, ses déclarations, et plus encore dans son extraordinaire conviction que les dirigeants politiques rwandais devraient encore se justifier devant lui.
À la recherche de pertinence sur Facebook
Le 2 janvier 2017, Reyntjens s’est tourné vers sa page Facebook pour accomplir ce qu’il imaginait être une consultation académique, mais qui ressemblait en réalité au geste d’un magistrat colonial convoquant les « indigènes » à comparaître. Il publia un projet d’article rédigé avec deux « collègues » non identifiés et annonça qu’il « recherchait l’avis des dirigeants actuels et anciens du FPR sur l’histoire précoloniale », en particulier sur les « institutions militaires et les valeurs dans le Rwanda d’après le génocide ». Le Front patriotique rwandais !
Comme l’observe Frantz Fanon dans son ouvrage classique Les Damnés de la Terre (1961), « l’autorité coloniale ne se renonce jamais sans résistance ; elle persiste dans l’esprit du colonisateur même après l’indépendance de la colonie ». La convocation lancée par Reyntjens en est l’illustration parfaite.
Dites-moi : quand a-t-on vu pour la dernière fois un chercheur sérieux publier en ligne une convocation à l’intention de dirigeants gouvernementaux, leur ordonnant de réagir à son brouillon ? Ce n’était ni une évaluation par les pairs, ni une consultation, ni même un échange. C’était un ordre. Le ton était sans équivoque : « Vous, dirigeants du FPR, vous viendrez ici vous expliquer. J’exige votre présence. » Le théâtre colonial était au complet. Il ne manquait que le casque colonial.
Seul quelqu’un habitué à être obéi par des responsables africains oserait lancer une invitation aussi absurde. Seul un homme nostalgique de l’époque où il murmurait à l’oreille des ministres d’Habyarimana pourrait imaginer qu’après avoir reconstruit le Rwanda sur les cendres d’un génocide, les dirigeants du FPR prendraient le temps de lui répondre.
C’est cette perte d’autorité, cet exil hors de la pertinence, qui alimente ses attaques obsessionnelles contre le gouvernement rwandais. Il n’a jamais pardonné au Rwanda d’après-génocide d’être devenu indépendant, non seulement politiquement, mais aussi intellectuellement.
Il est difficile de surestimer l’illusion nécessaire pour croire que les plus hautes autorités politiques du Rwanda, des hommes et des femmes responsables de la reconstruction nationale et du développement, mettraient leurs obligations de côté pour répondre à l’appel public d’un universitaire belge sur Facebook. Mais Reyntjens n’a jamais accepté que le Rwanda de 2017 ou de 2025 n’est pas celui de 1978 ou de 1987, à l’époque où il était le conseiller choyé du président Juvénal Habyarimana, le régime qui a ensuite orchestré le génocide perpétré contre les Tutsi.
Il fut un temps, dont il garde un souvenir ému, où les ministres rwandais et les hauts gradés de l’armée se référaient à lui. Où son approbation comptait. Où il représentait le Rwanda à des conférences internationales. Où il influençait les politiques dans les coulisses. Là se trouvait un jeune Belge capable d’avertir, de souffler des conseils, d’influencer, et d’être écouté. Cette époque est révolue. Mais il agit comme si c’était hier. En convoquant les dirigeants du FPR, il ne menait pas un travail universitaire. Il mettait en scène sa nostalgie.
Prédire le génocide
En novembre 2007, lors d’un témoignage devant un tribunal à Londres, Reyntjens a décrit son rôle de conseiller auprès du régime rwandais d’avant-génocide. Ses propos en disent bien plus qu’il ne le pensait : « Moi-même et d’autres avons averti que l’attaque du FPR le 1er octobre 1990 mettait la communauté tutsie en grand danger… Je veux dire, il existe une ligne claire allant de l’attaque du 1er octobre 1990 au génocide. »
Relisez cela. Lentement. Essayez d’imaginer une “ligne claire” reliant une guerre civile à un génocide ! Un professeur belge, fier conseiller d’un gouvernement qui sera plus tard responsable de l’extermination de plus d’un million de Tutsi, affirme avoir vu venir un génocide « inévitablement » à partir d’une attaque rebelle, comme si le génocide était un phénomène météorologique naturel, et non un projet politique méticuleusement planifié.
Seules deux catégories de personnes ont jamais tenu ce discours : les génocidaires, qui déclaraient « si les rebelles tutsi attaquent, nous exterminerons tous les Tutsi », et leurs héritiers idéologiques qui, plus tard, ont insisté sur le fait que le génocide était une conséquence inévitable de la guerre, disculpant ainsi les planificateurs de toute responsabilité. Dans quelle catégorie Reyntjens s’imagine-t-il appartenir ? L’arrogance est stupéfiante. Seul quelqu’un intimement lié aux planificateurs du génocide pourrait parler avec une telle certitude prophétique.
Le professeur laisse entendre que son statut de “spécialiste du Rwanda” lui aurait conféré une clairvoyance prophétique sur l’inévitabilité du génocide. Pourtant, les seules personnes qui ont « prédit » le génocide étaient celles qui l’ont soit planifié, soit soutenu. Rappelez-vous ce que disait Grégoire Kayibanda en 1964 : si les réfugiés attaquent Kigali, « ce sera la fin des Batutsi ».
Le gouvernement d’Habyarimana répétait la même menace. Les responsables et diplomates du président français François Mitterrand l’échoyaient depuis Paris et Kigali. Ces « avertissements apocalyptiques » n’étaient pas des extrapolations, c’étaient des déclarations de politique. Les prétendues prédictions annonçaient l’intention. Elles préparaient le terrain moral à l’extermination. Affirmer que la guerre a causé le génocide, c’est répéter la logique génocidaire elle-même. Son témoignage révèle un universitaire trop proche du pouvoir, non pas un analyste neutre, mais un acteur politique.
Histoire falsifiée
Le combat intellectuel que mène le professeur depuis des années se concentre sur un seul thème : nier que le Rwanda précolonial était unifié et saper les efforts du Rwanda moderne pour reconstruire l’unité. Il affirme que le Rwanda n’était pas une nation. Il soutient qu’il n’est devenu un État qu’au XXᵉ siècle. Il prétend que l’unité est un mythe fabriqué par le FPR. Ce n’est pas de la recherche : c’est un projet politique.
Si le Rwanda a toujours été divisé, alors le colonialisme est absous. Si l’unité est une invention, alors la réconciliation devient de la propagande. Si l’ethnicité est éternelle, alors le génocide devient inévitable. Et si le génocide était inévitable, alors personne, ni l’Église, ni l’État belge, ni les régimes Kayibanda ou Habyarimana, ne peut véritablement être tenu pour responsable. C’est une vision du monde extraordinairement commode.
Pour justifier cette thèse, Reyntjens s’appuie presque exclusivement sur Jan Vansina, un historien qui, malgré ses contributions universitaires, n’est ni infaillible ni omniscient. Pourtant, dans le récit de Reyntjens, Vansina devient l’autorité suprême dont chaque mot doit être obéi. Tous les autres chercheurs, y compris ceux qui utilisent des données anthropologiques, des découvertes archéologiques, des témoignages oraux et des éléments linguistiques, sont balayés d’un revers de la main comme des rêveurs. L’ironie est savoureuse : l’homme qui dénonce les « mythes » du FPR bâtit tout son récit sur des lectures sélectives, un moule eurocentrique et des convictions idéologiques.
Reyntjens nie obstinément que les puissances coloniales aient inventé des distinctions ethniques rigides au Rwanda. Il cherche à minimiser l’impact effroyable de l’ingénierie sociale belge et de l’idéologie missionnaire. Il ne nie pas l’existence du Manifeste des Bahutu. Bien qu’il ait été rédigé par un groupe d’intellectuels hutus, dont Grégoire Kayibanda, ses architectes conceptuels ou auteurs intellectuels étaient deux prêtres européens, Arthur Dejemeppe et le chanoine Ernotte, de l’Église catholique, la même Église par laquelle le colonialisme exerçait sa domination.
Reyntjens ne nie pas que Kayibanda ait été façonné par l’Église, il se contente simplement d’éviter d’analyser le rôle de l’Église. Il ne nie pas que la Belgique ait introduit des « cartes ethniques », il fait simplement semblant que ces catégories existaient déjà telles quelles.
Le Manifeste de 1957 fut l’embryon idéologique du génocide, une création coloniale, sanctifiée par des missionnaires chrétiens qui se voyaient comme des ingénieurs sociaux. Comme il est pratique pour Reyntjens de passer ces détails sous silence. Comme il est commode qu’il défende la vision du monde même que les prêtres avaient inscrite dans l’ADN politique du Rwanda.
Et comme il est utile pour lui d’affirmer que la division ethnique est intemporelle, alors même que le jugement du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en 1998 dans l’affaire Jean-Paul Akayesu le contredit formellement : « On pouvait passer d’un statut à un autre, à mesure que l’on devenait riche ou pauvre, ou même par le mariage… il est difficile de parler de groupes ethniques pour ce qui est des Hutu et des Tutsi, étant donné qu’ils partagent la même langue et la même culture. »
De plus, le TPIR a confirmé : « Au début des années 1930, les autorités belges ont introduit une distinction permanente… Il est devenu obligatoire pour chaque Rwandais de posséder une carte d’identité mentionnant l’ethnie. » Des cartes d’identité — inventées par les Belges. Cartes appliquées par l’Église et utilisées comme armes par les génocidaires. Mais Reyntjens veut faire croire aux non-informés que tout cela n’était qu’une ancienne tradition africaine.
Il est comme tout autre idéologue qui souhaite faire oublier au monde que l’État colonial a créé la « bombe atomique ethnique », puis a remis les détonateurs aux extrémistes locaux. Implicitement, il souhaite que les Rwandais continuent à se définir à travers le prisme colonial qu’il a hérité. Le Rwanda précolonial, comme beaucoup d’autres pays, était hiérarchisé, connaissait des inégalités, et oui, avait certains conflits. Mais la hiérarchie n’est pas l’ethnicité. L’inégalité n’est pas la division raciale. Et le conflit n’est pas le génocide.
Reyntjens insiste pour dire que le Rwanda a été façonné par des « guerres de conquête », comme si cela délégitimait l’État précolonial. Mais quelle nation n’a pas été façonnée par la conquête ? Si l’on demande à Reyntjens de clarifier : la France est-elle illégitime à cause de la guerre de Cent Ans ? La Grande-Bretagne est-elle un mythe à cause de l’invasion normande ? La Belgique reste-t-elle une construction artificielle parce qu’elle a été assemblée à partir de régions disparates en 1830 ? Mais lorsqu’il s’agit de l’Afrique, apparemment, les processus historiques normaux deviennent des signes de retard.
Son argument n’est pas historique. Il est colonial. Il repose sur la croyance que les États africains sont artificiels, tandis que les États européens sont naturels. Comme l’avertissait Julius Nyerere : « Le colonialisme laisse un héritage d’infériorité et de dépendance qui peut empoisonner l’âme du colonisateur comme celle du colonisé » (Nyerere, 1968, Ujamaa : Essays on Socialism).
Un homme laissé de côté
Peut-être aucune image ne traduit mieux le dilemme de Reyntjens que celle d’un homme debout devant une porte verrouillée, tenant une clé qui ne fonctionne plus, criant des instructions à des personnes à l’intérieur qui ont depuis longtemps tourné la page. Il ne comprend pas pourquoi le Rwanda l’ignore. Il ne supporte pas de ne plus être consulté. Il ne peut tolérer que son autorité se soit évaporée avec la chute du régime qu’il conseillait autrefois.
Et son amertume est amplifiée par un affront encore plus visible : la création de la Constitution rwandaise de 2003, amendée en 2015, sans lui, sans ses conseils, sans sa main « experte » pour façonner le texte selon la vision coloniale du Rwanda qu’il défendait jadis. La nostalgie de son rôle dans la Constitution rwandaise de 1978 est réelle. C’était son œuvre.
Cette nouvelle Constitution a démantelé le même édifice idéologique qu’il soutenait. Elle rejette les catégories raciales rigides et les hiérarchies coloniales que Reyntjens défendait autrefois. Elle codifie l’unité des Rwandais plutôt que les divisions qu’il affirmait éternelles. Elle consacre les droits et la dignité de tous les citoyens, et non le privilège d’une minorité façonnée par le paternalisme européen. Elle refuse de valider les récits de division auxquels il s’accrochait, construisant au contraire un cadre légal qui permet aux Rwandais de se définir eux-mêmes, plutôt que d’obéir aux diktats d’« experts » étrangers. Comme le souligne Kehinde Andrews dans Back to Black (2018) : « Les intellectuels occidentaux échouent souvent à percevoir l’agentivité émancipatrice des peuples anciennement colonisés, préférant des récits qui renforcent leur propre autorité. »
En résumé, la Constitution représente tout ce contre quoi Reyntjens a combattu : un Rwanda souverain dans son histoire, uni dans son identité et équitable dans sa gouvernance. Le fait qu’il n’ait été ni consulté ni même reconnu dans ce processus dépasse le simple affront professionnel, c’est la fin symbolique du monde où il exerçait autrefois une autorité incontestée. Son obsession de critiquer le FPR, sa convocation sur Facebook, ses attaques historiographiques sans fin, tout cela ressemble désormais à des crises de colère d’un universitaire qui a perdu le contrôle du récit qu’il croyait autrefois lui appartenir.
Imaginez-le marchant dans son bureau, entouré de notes jaunies de l’époque Habyarimana, soupirant de frustration : « Pourquoi ces Rwandais ingrats ne me laissent-ils plus définir leur histoire ? Pourquoi tiennent-ils à reconstruire leur pays en utilisant leurs propres sources ? Pourquoi n’acceptent-ils pas que moi, professeur belge, je connais mieux que eux leurs institutions précoloniales ? Où sont mes ministres ? Pourquoi ne viennent-ils pas quand je les appelle ? »
Imaginez sa tristesse lorsqu’il consulte les notifications Facebook, s’attendant à ce qu’un général de la RDF commente son projet d’article. Imaginez son incrédulité lorsqu’aucun ne le fait. Imaginez la crise existentielle.
Si la satire est destinée à exposer l’absurde, alors Reyntjens est le rêve d’un satiriste. Il est le missionnaire qui n’a converti personne. Il est l’administrateur colonial après l’indépendance. Il est le chef de chœur après que la chorale a quitté l’église. Il est un expert sans sujet. Cela pourrait être drôle si ce n’était pas si dommageable. Il n’a pas seulement mal interprété le passé du Rwanda, il a activement contribué à des récits qui excusent les génocidaires, induisent en erreur les décideurs politiques et perpétuent des incompréhensions coloniales sur les systèmes politiques africains.
Le pire crime du Rwanda, aux yeux de Reyntjens, n’est pas l’autoritarisme, ni les violations des droits humains, ni la démocratie imparfaite. Non, le véritable délit du Rwanda est autre : le Rwanda n’a plus besoin de lui.
Il ne peut l’accepter, et il ne l’acceptera pas. Ainsi, il mène une guerre intellectuelle non pas contre le gouvernement rwandais, mais contre le droit du Rwanda à s’interpréter lui-même. Sa lutte n’est pas contre les faits, mais contre l’indépendance. Pas contre l’histoire, mais contre la souveraineté. Pas contre le FPR, mais contre la perte d’une vision coloniale du monde dans laquelle les chercheurs européens siègent au sommet des sociétés africaines comme des juges omniscients.
La tragédie de Reyntjens est qu’il ne peut reconnaître que le monde a changé. La tragédie pour les Rwandais est que ses idées continuent de circuler, reprises sans critique par des journalistes, répétées par des décideurs politiques, et adorées par ceux qui idéalisent l’anthropologie coloniale.
La fixation de Reyntjens sur le refus de l’unité précoloniale du Rwanda n’est pas académique, elle est psychologique. Le Rwanda précolonial contredit sa vision du monde. Le Rwanda d’après-génocide l’ignore. Le FPR rejette clairement les catégories qu’il privilégie. Et ce qui est le plus intolérable : le Rwanda s’est relevé sans lui.
Il ne peut pardonner au FPR d’avoir sorti le Rwanda de l’orbite de l’académie coloniale. Il ne peut leur pardonner d’avoir construit une nation qui n’a pas besoin de la validation de professeurs blancs d’Anvers ou de Bruxelles. Il ne peut leur pardonner de refuser de se prosterner devant l’autel de l’évangile historique des universitaires à mentalité coloniale.
Ainsi, dans ses écrits, il revient sans cesse à sermonner le Rwanda, comme un directeur d’école corrigeant des enfants irrespectueux.
Peut-être devrions-nous demander pardon au professeur. Après tout, il doit être douloureux, agonisant même, de passer du rôle de consultant privilégié du régime d’Habyarimana, l’homme chargé de représenter le Rwanda dans les capitales européennes, à celui de réprimandeur en ligne dont les convocations sur Facebook sont ignorées par les dirigeants qu’il pensait pouvoir sermonner.
Reyntjens n’a pas compris que le Rwanda a tourné la page, et que les personnes qu’il croyait pouvoir regarder de haut ne lèvent plus les yeux vers lui. Il n’a pas compris que l’empire idéologique qu’il défend a disparu , enseveli sous les ruines de ses propres crimes. Ce qui reste n’est qu’un relâchement colonial déguisé en recherche académique. Et, comme tout relâchement, il est bruyant, instable, et totalement convaincu que l’importance d’hier compte encore aujourd’hui.











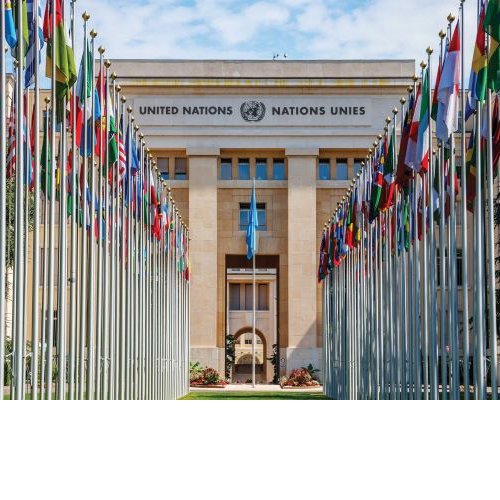







AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!