Dans un appel émotionnel intitulé « Un appel au président Trump : aidez ma mère à obtenir sa liberté au Rwanda », Rémy, se présentant comme le fils de l’« opposante politique » Victoire Ingabire Umuhoza, implorait le président américain de faire pression sur le Président rwandais pour libérer sa mère, une femme condamnée pour avoir promu l’idéologie du génocide.
Pause pour l’effet : un journal américain, dans un pays encore confronté à l’héritage de l’esclavage et du racisme systémique, offre sa tribune prestigieuse au fils d’une femme qui dirige un mouvement politique fondé par des génocidaires, des personnes qui, en 1994, ont tenté d’exterminer toute une population.
C’est comme si The Hill avait décidé de commémorer la Journée du souvenir de l’Holocauste en publiant un essai du petit-fils de Joseph Goebbels demandant au président Trump de « venir en aide aux néo-nazis pour qu’ils obtiennent leur liberté ». Et les rédacteurs se seraient dit : Oui, ça a l’air bien. Publions-le.
L’essai de Rémy déborde d’appel émotionnel. Il décrit sa mère comme une figure sainte, « une courageuse leader de l’opposition », « une championne du dialogue » et « un symbole de paix ». Il peint le tableau d’un cœur familial brisé : anniversaires manqués, câlins absents, et une petite-fille américaine de 10 ans confuse demandant : « Pourquoi grand-mère ne peut-elle pas venir me rendre visite ? » C’est si touchant, jusqu’à ce qu’on se rappelle qui est vraiment cette grand-mère.
Victoire Ingabire n’est pas la Nelson Mandela du Rwanda. Elle est l’ancienne tête du Rassemblement Républicain pour la Démocratie au Rwanda (RDR), un groupe créé dans les camps de réfugiés de l’est du Zaïre par les véritables architectes du génocide contre les Tutsi de 1994. Le RDR, puis plus tard le FDU-Inkingi, étaient des façades politiques pour les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), une milice armée composée d’anciens Interahamwe et ex-soldats des FAR qui avaient fui le Rwanda après avoir massacré plus d’un million de personnes.
La maison d’Ingabire, dont l’adresse est Postbus 3124, 2280 GC, Rijswijk, Pays-Bas, servait de quartier général pour ces organisations. Cela signifie que le salon où Rémy a grandi, courant partout, faisant ses devoirs, mangeant des biscuits hollandais, était également un centre où des génocidaires manœuvraient pour relancer leur idéologie. Une véritable pépinière du négationnisme, une crèche pour la désensibilisation morale. Imaginez la scène : des histoires du soir sur la démocratie lues au fils d’une femme qui coordonnait des séances stratégiques pour des personnes ayant massacré plus d’un million de civils innocents.
Grandir dans un tel environnement, entouré d’adultes défendant le massacre des Tutsi comme une « action politique » et arguant que le génocide est sujet à « débat », ne pouvait pas ne pas laisser de marque. L’empathie était visiblement optionnelle dans le programme moral de Rémy. Nehea, l’enfant américaine qu’il montre avec tant d’émotion, ignore qu’elle n’est qu’un accessoire dans un récit qui excuse les crimes de sa grand-mère. Pendant ce temps, Rémy présente sa propre cécité émotionnelle comme un appel sincère et émouvant.
Il est tentant de rire de l’absurdité de tout cela, mais les conséquences sont graves et potentiellement mortelles. Lorsqu’un média américain majeur comme The Hill amplifie de tels récits, il ne s’agit pas seulement d’un simple faux pas moral ou d’un mauvais journalisme, c’est de la complicité.
Le négationnisme entame ainsi sa seconde vie. Non plus dans l’ombre, sur des blogs haineux ou des sites obscurs, mais sur des médias raffinés qui brouillent la frontière entre propagande et « équilibre », relativisme moral et « liberté d’expression ».
Herbert Hirsch, dans son ouvrage profond ’Genocide and the Politics of Memory’, avertit : « Celui qui contrôle le récit du passé contrôle le jugement moral du présent. » L’observation de Hirsch capture exactement ce qui se passe ici. En donnant de l’espace à l’appel d’Amahirwa, The Hill a effectivement légitimé un mouvement qui passe des années à tenter de contrôler le récit du passé rwandais.
Pour le lecteur non informé de Philadelphie ou de Boston, l’article de Rémy ressemble à une histoire humaine : un fils aimant, une mère souffrante, un régime africain lointain réduisant au silence toute opposition. Mais pour quiconque connaît l’histoire du Rwanda, c’est un loup déguisé en empathie.
La politique des larmes et de l’égalisation des génocides
L’un des outils les plus efficaces des négationnistes du génocide est la manipulation émotionnelle. Le négationnisme n’a jamais eu besoin de vérité ; il a besoin de larmes. Il survit grâce à une empathie détournée, celle qui confond responsabilité et cruauté, conséquence et persécution.
Lorsque Amahirwa évoque les mariages et naissances que sa mère a manqués, sa douleur est compréhensible. La séparation familiale est toujours difficile. Mais ce qu’il omet de dire, et que The Hill n’a jamais interrogé, ce sont les familles irrémédiablement brisées par l’idéologie soutenue par sa mère.
Combien de survivants du génocide n’ont plus de mère, plus de père, plus de frères ou sœurs, aucune tombe à visiter ? Combien d’enfants sont nés dans un traumatisme si profond que l’odeur de la pluie leur rappelle la terre trempée de sang ? Ces familles n’ont pas « manqué des mariages ». Elles ont manqué l’existence même.
Équivaloir l’emprisonnement temporaire d’une idéologue à l’effacement permanent d’un million d’âmes n’est pas seulement désagréable ou offensant ; c’est obscène.
Comme l’a dit Deborah Lipstadt, célèbre spécialiste de la négation de l’Holocauste : « La négation du génocide est la dernière étape du génocide. Elle cherche à s’assurer que les victimes sont tuées deux fois : d’abord dans leur chair, puis dans la mémoire. » The Hill, peut-être sans le savoir, a remis la deuxième machette aux négationnistes.
La forme la plus insidieuse du négationnisme n’est pas le rejet pur et simple, c’est l’égalisation, cette fausse affirmation selon laquelle « toutes les parties ont commis un génocide ».
C’est l’arme rhétorique que Victoire Ingabire manie depuis des années. En 2010, elle est revenue au Rwanda et a exigé que le pays commémore les « victimes hutu » de ce qu’elle qualifiait de « crimes du FPR ». Ce n’est pas une demande innocente d’inclusivité, c’est une déformation délibérée destinée à diluer la clarté morale du génocide de 1994.
Il n’existe pas de « génocide égal » : il n’y a eu qu’un seul génocide, l’extermination systématique de la population tutsi, planifiée et exécutée avec minutie par un gouvernement, son armée et ses citoyens.
Hirsch avertit : « La requalification des auteurs en victimes, et des victimes en agresseurs, n’est pas simplement une distorsion de l’histoire ; c’est une invitation à la répéter. »
Lorsque le monde ne s’oppose pas à cette inversion, il autorise de futures atrocités sous couvert de confusion morale.
La fable de l’opposante réduite au silence
Rémy appelle sa mère une « leader de l’opposition pacifique réduite au silence derrière les barreaux ». Examinons ce mythe.
En 2013, la Cour suprême du Rwanda a déclaré Victoire Ingabire coupable de minimisation du génocide et de complot en vue de former un groupe armé. Elle n’a pas été condamnée pour « ses paroles », elle a été emprisonnée pour avoir promu un discours de haine ayant déjà coûté la vie à un million de personnes, et pour avoir collaboré avec des génocidaires connus. Ce n’est pas une persécution politique ; c’est de la justice.
Il est incroyable de voir comment les médias occidentaux continuent de romantiser de telles figures. Si aujourd’hui un politicien allemand créait un parti dédié à « donner la parole aux nazis oubliés », The Hill publierait-il l’appel de son fils pour sa liberté ? Apparemment, en Afrique, les standards sont différents.
L’une des caractéristiques les plus dangereuses du négationnisme est sa capacité à séduire les non-informés. Il n’a pas besoin de convaincre tout le monde, juste suffisamment de personnes ignorantes pour rendre le doute « à la mode ».
Comme l’a observé le sociologue Stanley Cohen dans States of Denial : « L’essence du déni n’est pas l’ignorance mais le refus de reconnaître ce que l’on sait. » Le négationnisme ne naît pas d’un manque de preuves ; il prospère sur la paresse morale et la commodité émotionnelle.
Pour un lecteur américain qui n’a jamais mis les pieds au Rwanda, le pays devient une scène lointaine sur laquelle se joue le drame familier du « dictateur contre le dissident ». Les nuances disparaissent, et l’histoire s’intègre parfaitement dans un scénario occidental sur la liberté et l’oppression. C’est ainsi que le négationnisme du génocide se rebrandit : en croisade pour les droits humains.
Profiter de l’analphabétisme émotionnel
Probablement, Rémy Amahirwa vit aux États-Unis, loin des fosses communes que sa grand-mère, Thérèse Dusabe, aurait contribué à remplir. Il parle le langage de la démocratie, met en avant des symboles de liberté et invoque les idéaux américains, tout en défendant une femme dont le mouvement politique a abrité ceux qui prônaient l’extermination.
Et puis il y a la « citoyenne américaine », la petite-fille innocente de 10 ans, nommée Nehea. Elle est le centre émotionnel de son essai, la ponctuation larmoyante censée faire fondre le cœur de Washington.
Mais, honnêtement : cette pauvre enfant n’a aucune idée que sa « chère grand-mère » était le visage d’une organisation dont les membres rêvaient de terminer ce que 1994 avait commencé. Elle ne sait pas que son arrière-grand-mère, Dusabe, est une génocidaire en fuite accusée d’avoir éventré des femmes enceintes et tué des nourrissons.
On peut presque imaginer le futur rassemblement familial : la petite-fille prend l’avion pour Kigali, s’attendant à des ballons et à un gâteau d’anniversaire, pour se retrouver face aux fantômes d’un million de Tutsi massacrés qui chuchotent : « Demande à Grand-mère ce qu’elle a vraiment fait en 1994. »
Rémy exhibe l’innocence de sa fille comme un gage moral, comme si la citoyenneté américaine pouvait laver la complicité héritée. Mais la citoyenneté ne sanctifie pas l’ignorance. Elle ne fait que changer l’adresse du négationnisme.
La carte Trump de la manipulation
Puis vient la pièce de résistance, la conviction de Rémy qu’il serait possible de persuader Donald Trump de défendre la cause de sa mère. Il faut presque admirer l’assurance. Il imagine l’homme qui a un jour confondu les Kurdes avec les Kardashians devenir soudain un ardent défenseur d’une idéologue du génocide condamnée.
Rémy écrit : « Le président Trump s’est montré un champion de la lutte pour la liberté de ceux détenus injustement. » Quitte à se demander s’il ne le confond pas avec quelqu’un d’autre, peut-être un personnage de Marvel.
C’est comme si Amahirwa pensait que Trump pouvait être manipulé émotionnellement par l’image d’une « petite-fille américaine » en pleurs, ce genre d’appât sentimental auquel les populistes ne peuvent résister.
Essayez d’imaginer la scène : Trump dans le Bureau ovale, penché en arrière avec ce fameux regard plissé, disant : « Victoire qui ? Elle a l’air sympa. Peut-être qu’on pourrait la mettre dans The Apprentice : Kigali Edition. »
Amahirwa a manqué un détail essentiel : Trump se laisse aisément manipuler, mais par la flatterie, non par le révisionnisme du génocide. Si Amahirwa cherchait à flatter son ego, il s’est trompé de scénario.
Et pourtant, le simple fait de croire que Trump pourrait être dupé pour défendre une promotrice de l’idéologie du génocide révèle quelque chose de profond, l’auto-importance de ceux qui pensent que le pouvoir occidental est un outil pour leur propagande.
C’est la vieille habitude coloniale sous un nouvel emballage : croire qu’une validation occidentale peut blanchir n’importe quel récit, même celui construit sur des ossements.
Le plus risible est l’imagination raciste sous-jacente : qu’un président américain pourrait « dicter » quoi que ce soit à un dirigeant africain, en l’occurrence le Président Paul Kagame, dont la légitimité repose sur la prévention du retour du génocide et la reconstruction d’une nation à partir de ses cendres. Amahirwa semble croire que le Rwanda n’est qu’une banlieue de Washington, prête à plier sous le poids des tweets américains. Cette fantaisie est un exemple de paternalisme colonial déguisé en appel à la justice.
Le silence des survivants et l’hypocrisie occidentale
Pour les survivants du génocide, chaque instance de négation est un tremblement de terre. Elle ébranle les fondements de la mémoire et insulte les morts.
Imaginez survivre à une campagne d’extermination, vous affairer à reconstruire votre vie, et voir le monde tendre des micros aux enfants de ceux qui ont justifié votre annihilation, tout cela au nom de « l’équilibre ».
Beaucoup de survivants ne prennent pas la parole, non pas parce qu’ils sont d’accord, mais parce que le silence est leur dernier refuge face à la douleur. Comme l’a confié un survivant à un journaliste il y a des années : « On peut reconstruire sa maison après l’incendie, mais pas son cœur. »
Les rédacteurs de The Hill, confortablement éloignés de cette douleur, ont probablement pensé qu’ils faisaient preuve d’« ouverture d’esprit ». Mais l’ouverture d’esprit envers le négationnisme n’est pas une vertu ; c’est une décadence morale déguisée en tolérance.
Appelons un chat par son nom : il s’agit d’un double standard déguisé en journalisme. En Occident, la négation de l’Holocauste est un crime dans plusieurs pays. On ne peut pas se tenir à un coin de rue en Allemagne et déclarer que « les deux camps ont tué » pendant l’Holocauste, on serait menotté avant de finir sa phrase.
Mais quand il s’agit de l’Afrique, le négationnisme devient soudainement une « liberté d’expression ». Les mêmes personnes qui reculeraient devant un article néo-nazi ne voient aucun problème à offrir une tribune aux révisionnistes du génocide contre les Tutsi. C’est pourquoi des négationnistes organisés comme Jambo Asbl reçoivent des subventions du gouvernement belge. Apparemment, certains génocides méritent d’être commémorés, tandis que d’autres sont sujets à débat. Cette hypocrisie constitue le racisme implicite des politiques mémorielles.
L’héritage de la haine
Il ne s’agit pas seulement de Victoire Ingabire. La pourriture va plus loin. Sa mère, Thérèse Dusabe, infirmière de profession, est une femme qui, selon des témoignages, a participé au meurtre brutal de femmes et d’enfants tutsi. Rémy Amahirwa, dans son article, omet commodément que les mains de sa « grand-mère innocente » sont trempées de sang.
Il écrit qu’une famille « paie le prix », mais ne mentionne jamais les familles qui ont payé le prix ultime de leurs vies à cause de sa grand-mère.
De la grand-mère Dusabe à la mère Ingabire, puis au fils Amahirwa, cette narration intergénérationnelle illustre parfaitement la manière dont l’idéologie du génocide se transforme sans jamais s’éteindre. Elle se modernise, troquant les machettes contre des micros, la radio haineuse contre les tribunes d’opinion, et la négation contre un discours plus subtil.
L’oubli est traître. Herbert Hirsch nous rappelle que « le génocide ne peut exister sans les structures sociales et politiques qui rendent l’oubli possible ». Le négationnisme n’est donc pas un post-scriptum du génocide, c’est sa continuation.
En oubliant, en laissant la distorsion s’immiscer dans le discours public, les sociétés préparent le terrain pour la prochaine atrocité.
Lorsque The Hill légitime un récit qui blanchit le passé, il devient partie prenante de cette structure de l’oubli. Il transforme le génocide d’un fait en opinion, quelque chose à « débattre » plutôt qu’à condamner. Ce n’est pas seulement un journalisme raté, c’est un vandalisme moral.
Et maintenant, des personnes comme Ingabire exploitent cette indifférence en se présentant comme les victimes du même Rwanda qu’elles ont autrefois tenté de détruire.
C’est une manœuvre habile : transformer la culpabilité occidentale en compassion occidentale. En s’adressant à Donald Trump, parmi tous les interlocuteurs possibles, Rémy ne plaide pas seulement pour la libération de sa mère ; il flatte l’ego américain du « défenseur de la liberté », espérant ainsi envelopper une idéologie toxique dans le vernis du discours libéral.
Mais une liberté sans responsabilité n’est plus qu’une licence, et, en l’occurrence, une licence pour mentir. Ceux qui invoquent le « dialogue » depuis l’exil sont rarement ceux qui ont affronté la justice ou le deuil. Ils parlent de « liberté », mais pensent à l’impunité ; ils prônent la « démocratie », mais réclament l’oubli.
Comme l’écrivait Hirsch : « Sans mémoire collective, la responsabilité morale se désintègre. »
Éduquer les non-initiés
Pour ceux qui ne connaissent pas la négation du génocide, voici ce qu’il faut comprendre : les négationnistes ne nient que rarement de manière directe. Ils déforment, ils contextualisent, ils « posent des questions », ils invoquent l’équité. Ils enveloppent la haine dans la civilité.
Ils disent : « Écoutons les deux côtés. » Puis : « Elle est une dissidente pacifique ; pourquoi la punir ? » Suivi de : « L’Amérique devrait intervenir, après tout, nous avons inventé la démocratie, non ? »
Et ils disent tout cela en ignorant commodément le million de voix réduites au silence à jamais.
C’est la stratégie type des négationnistes du génocide : envelopper le meurtre d’une ambiguïté morale, présenter les faits historiques comme débattables et transformer des actes criminels en persécution politique. Des chercheurs comme Herbert Hirsch ont maintes fois averti que « la manipulation de la mémoire est l’armement de l’oubli ». En clair : le passé est en train d’être réécrit et l’avenir est mis en danger, tandis que nous applaudissons poliment un article d’opinion bien tourné.
Revenons à la fantaisie centrale de Rémy : croire que Donald Trump, assis dans le Bureau ovale, pourrait d’une manière ou d’une autre « exiger » ou même « persuader » le Rwanda de libérer une promotrice d’idéologie génocidaire condamnée.
C’est absurde, et presque drôle. On pourrait presque voir la scène comme un dessin de presse : un jeune homme à Pittsburgh brandissant son iPhone, murmurant des leçons de morale à travers l’océan, tandis que le dirigeant d’une nation africaine souveraine hoche la tête en se demandant : « Sur quel aspect du droit international se trompe-t-il cette fois ? »
C’est là que l’humour rencontre l’horreur. La confiance de Rémy dans la manipulation occidentale est moins un appel à la justice qu’un reflet d’un esprit imprégné d’un négationnisme hérité. Ayant grandi dans la maison de l’idéologie du génocide, entouré des opérateurs du RDR et du FDU-Inkingi, avec une grand-mère qui a participé directement à des massacres de masse, il n’est pas surprenant que son imagination morale soit… disons, sous-développée.
L’idée qu’un président occidental pourrait dicter les choix moraux ou judiciaires d’un dirigeant africain n’est pas seulement fausse ; c’est le genre d’arrogance naïve qui a historiquement justifié le colonialisme. Voilà le monde fantasmatique d’Amahirwa : un monde où l’idéologie du génocide peut être blanchie par la sentimentalité et le soutien des célébrités.
Nehea, la jeune « citoyenne américaine » au centre de cette histoire, est innocente. Ses larmes sont réelles. Son désir de voir sa grand-mère est sincère. Et cette innocence est abusée.
Elle est présentée comme un symbole de clarté morale, un point d’exclamation vivant au service de l’argument d’Amahirwa. Pourtant, elle ignore tout de la vérité : sa grand-mère a promu une idéologie du génocide, son arrière-grand-mère était une génocidaire en fuite, et toute une population a vu sa vie détruite pour permettre à cette famille de comploter une revanche politique.
L’exploitation de son innocence est remarquablement habile : elle émeut, aveugle les rédacteurs et détourne momentanément l’attention du public de l’horreur de la réalité. Mais l’innocence mal employée ne disculpe pas les crimes. C’est un exemple saisissant de la manière dont le négationnisme manipule la mémoire et même les émotions.
Le jugement moral
Au bout du compte, ce que représentent Rémy Amahirwa et sa mère n’est pas « l’opposition pacifique » ni la « liberté d’expression ». Ils incarnent une tentative multi-générationnelle de blanchir l’impensable et de transformer les tueurs en victimes.
L’argument selon lequel « son arrestation est injuste » ignore la définition même de la justice. Ingabire et le réseau RDR/FDU-Inkingi n’ont pas été arrêtés pour avoir exprimé un dissentiment, ils ont été arrêtés pour avoir promu une idéologie génocidaire, collaboré avec des tueurs condamnés et sapé la fragile reconstruction post-génocide du Rwanda.
Il y a une différence profonde entre un dissident contestant une politique gouvernementale et un idéologue défendant le meurtre de masse. Cette différence, c’est la vie ou la mort, la mémoire ou l’amnésie, la responsabilité ou l’impunité.
Comme le souligne Hirsch : « Nier le génocide, c’est refuser aux victimes l’humanité même pour laquelle elles sont mortes. » Chaque article d’opinion comme celui d’Amahirwa érode cette humanité, même sous couvert d’appels émouvants.
Ce n’est pas seulement une histoire rwandaise. C’est une leçon globale sur les dangers du négationnisme, de la sentimentalité détachée des faits et des plateformes médiatiques incapables de distinguer la réalité morale de la commodité narrative.
Le négationnisme du génocide prospère lorsque le public est non informé, lorsque les émotions sont manipulées et lorsque la culture historique est faible. Les plateformes qui donnent une tribune aux négationnistes sous la bannière de « l’opinion » ou de « l’équilibre » ne sont pas neutres. Elles sont complices.
Mon appel à ceux qui ignorent ce qui s’est passé au Rwanda : informez-vous. Posez des questions. Regardez au-delà des larmes, de la douleur et de la citoyenneté américaine pour saisir les faits historiques qui comptent. La différence entre justice et impunité, mémoire et oubli, vie et mort, est trop grande pour être obscurcie par les artifices d’une prose sentimentale.
Et ainsi, nous revenons au point de départ, à cette absurdité qui ouvrait l’article. Imaginez un monde où un tweet d’un président américain suffirait à libérer des génocidaires, où l’innocence des enfants pourrait effacer des massacres, où des réunions familiales réécriraient la morale de l’histoire. Imaginez des colonnes d’opinion saturées de demandes d’absolution émotive des descendants de criminels.
C’est drôle, presque. Mais le rire est désagréable. Car derrière l’humour se cache une souffrance réelle. Derrière l’absurde se cachent de véritables conséquences. Plus d’un million de Tutsi réduits au silence pour toujours, et leur mémoire menacée d’être réécrite par le prochain article d’opinion, le prochain tweet, la prochaine supplique sentimentale.
Que The Hill et Rémy Amahirwa nous servent de leçon à tous :
Le sentiment sans vérité est dangereux. La sympathie sans responsabilité est complicité. L’innocence peut être manipulée, mais elle ne peut rétablir la justice. Le pouvoir peut être courtisé, mais ne peut réécrire l’histoire.
Nehea, la jeune citoyenne américaine, apprendra peut-être un jour la vérité. Qu’elle soit enseignée non pas par des articles qui blanchissent le meurtre, mais par l’histoire rwandaise, non déformée, douloureuse et moralement exigeante. Qu’elle sache que la liberté, la mémoire et la justice ne sont pas des dons accordés par des politiciens ou des publications, ce sont des obligations que nous devons aux morts, aux vivants et à l’avenir.
Le négationnisme du génocide n’est pas une rhétorique inoffensive. C’est une arme dangereuse. Il prospère grâce à la manipulation des émotions, à une idéologie héritée et à la crédulité occidentale. Il doit être affronté par le ridicule, la clarté morale et un engagement indéfectible envers la mémoire.
À Amahirwa et à d’autres comme lui : ni les larmes, ni les tribunes d’opinion, ni l’invocation de présidents américains ne réécriront l’histoire. Votre récit peut émouvoir, mais il ne modifie pas les faits. Vous pouvez espérer influencer, mais le pouvoir sans justice n’est qu’illusion. Un jour, seule la vérité, obstinée et solide, restera.
Car, au bout du compte, le sentiment ne peut ressusciter les morts, la fantaisie ne peut annuler les horreurs de l’histoire, et la sympathie ne peut remplacer la responsabilité. La vérité, le souvenir et le courage moral, voilà les héritages qui méritent d’être défendus.
Et pour ceux qui rient encore de l’absurdité d’un monde où le génocide pourrait se négocier via Twitter et les cordes sensibles des Américains : plaisantez, si vous voulez. Mais n’oubliez jamais que l’histoire, la mémoire et la morale ne sont pas des lignes de comédie.











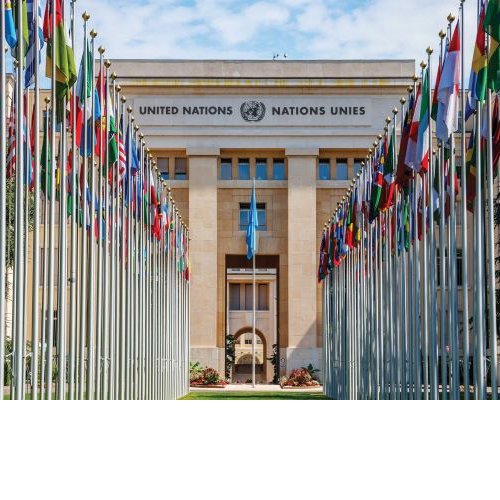







AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!