Des nations comme la Pologne, les États-Unis, la Corée du Sud ou encore le Japon, autrefois solidement arrimées à leurs traditions religieuses, enregistrent un déclin manifeste de la pratique et de la foi. Même dans certains pays à majorité musulmane tels que l’Iran, la Turquie ou les sociétés du Maghreb les enquêtes sociologiques récentes mettent au jour une distanciation croissante vis-à-vis de la croyance, au profit d’identités plus individuelles, parfois critiques, souvent silencieuses.
Cette dynamique désaffectionnelle n’épargne plus guère que quelques enclaves d’Afrique subsaharienne ou d’Amérique latine, où la religion continue d’imprégner la trame du lien social et politique. Mais partout ailleurs, on observe une montée en puissance des « sans religion », de ceux qui se revendiquent agnostiques, athées ou simplement indifférents.
Aux États-Unis, près d’un tiers de la population adulte n’affiche plus d’appartenance confessionnelle ; en Pologne, la participation hebdomadaire aux offices religieux s’est effondrée en l’espace de quelques années. L’anthropocentrisme moderne semble supplanter l’ancienne verticalité théologique.
La religion dépouillée de ses fonctions : quand l’État se substitue à l’Église
L’une des clefs majeures de cette mutation réside dans ce que les sociologues nomment la « différenciation fonctionnelle » des sociétés modernes. Autrefois, les institutions religieuses assuraient une multiplicité de fonctions sociales : elles éduquaient, soignaient, unifiaient le tissu communautaire, distribuaient assistance et consolation. Elles constituaient la grande matrice de sens à laquelle chacun venait puiser non seulement des repères spirituels, mais également un cadre matériel d’existence.
Or, avec l’émergence de l’État-providence, la montée de l’instruction publique, la généralisation des services de santé, la judiciarisation des conflits et l’essor des sciences, les fonctions autrefois assurées par le religieux ont été redistribuées entre des sphères autonomes, dotées chacune de leur propre rationalité. L’économie, le droit, l’éducation et la politique ont peu à peu affranchi leurs logiques de fonctionnement de l’emprise du sacré.
Dans cette configuration nouvelle, la religion se retrouve repliée sur la seule sphère du croire. Elle n’est plus que spiritualité privée, conviction intime, affaire de conscience. Privée de ses ancrages sociaux et politiques, elle perd de sa consistance dans l’espace public.
Ce dépouillement n’est pas nécessairement synonyme de disparition, mais il fragilise la foi en l’isolant de ses piliers historiques. Lorsque l’Église n’enseigne plus, ne soigne plus, ne protège plus, elle doit légitimer son rôle par la seule force de sa proposition spirituelle ce qui, dans une époque sceptique et pluraliste, s’avère être une gageure.
La crise de plausibilité du religieux : entre rationalisme et désenracinement
Au-delà de cette réorganisation fonctionnelle du social, la religion pâtit aussi d’une crise plus fondamentale : celle de sa crédibilité intrinsèque. Dans un monde saturé de savoirs scientifiques, de récits concurrents et d’exigences de preuve, les postulats religieux tels que l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme, la révélation divine apparaissent de moins en moins plausibles aux yeux d’un nombre croissant d’individus.
Le paradigme rationaliste, hérité des Lumières et accentué par la mondialisation numérique, rend suspecte toute vérité qui ne se laisse pas démontrer, expérimenter ou discuter.
En outre, l’universalisation des droits individuels, la montée de l’esprit critique et l’émancipation des consciences ont entamé l’autorité des institutions religieuses, souvent perçues comme figées, moralisatrices ou anachroniques. Là où elles imposaient jadis des normes collectives, elles doivent aujourd’hui composer avec des subjectivités en quête d’autonomie.
Même les récits eschatologiques, porteurs d’espérance pour les générations antérieures, peinent à mobiliser dans une époque où le salut semble davantage recherché ici-bas que dans l’au-delà.
Il ne s’agit pas d’un rejet frontal de la religion, mais d’un effritement progressif de sa pertinence existentielle. Pour nombre de contemporains, le religieux n’est plus ni oppressant ni salvateur : il est simplement dépassé.
« La croyance en Dieu ou en une vie après la mort n’est plus plausible », résume sans ambages le sociologue Detlef Pollack. Ainsi s’accomplit, silencieusement mais inexorablement, ce que Max Weber nommait le « désenchantement du monde ».
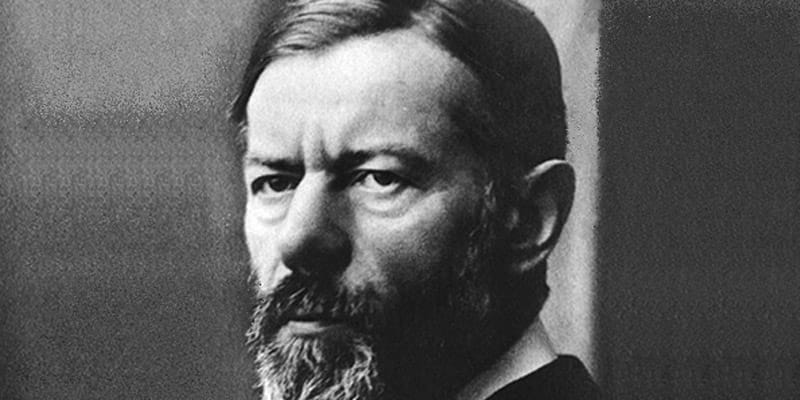








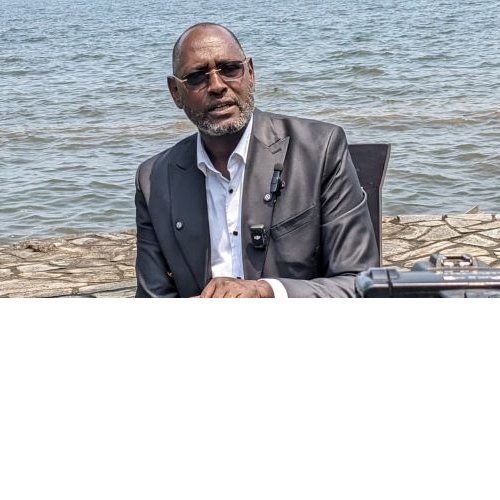









AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!