Ce livre aborde le génocide perpétré contre les Tutsi sous un angle féminin, en se basant sur les témoignages de treize membres fondatrices de l’Association des veuves du génocide, AVEGA.
Il propose une réflexion approfondie sur le viol en tant qu’arme du génocide, met en lumière la résilience du Rwanda à travers le prisme des femmes, et analyse la dynamique génocidaire.
Le livre contient également un appel à l’Humanité pour une progression réaliste dans les domaines du droit international et du droit de veto à l’ONU.
Lors d’une émission en compagnie de Jean-Claude Mugenzi, Daniel Le Scornet revient sur son livre et sur l’histoire du génocide contre les Tutsi perpétré en 1994 au Rwanda.
Il explique également sa collaboration avec ces femmes pour la rédaction de l’ouvrage.
Ci-dessous, vous trouverez la conversation intégrale entre le journaliste et Daniel le Scornet.
IGIHE : Bienvenue, M. Le Scornet.
Daniel Le Scornet : Bonjour.
Vous avez d’abord écrit sur la ville de Kigali. Qu’est-ce qui vous a attiré pour écrire sur cette ville ? Vous en êtes tombé amoureux ? Qu’est-ce qui s’est fait ? Comment cela est arrivé ?
Bien, nous étions à la période du Covid, donc un peu bloqués. Et comme j’arrivais aussi à Kigali, je connais le Rwanda depuis longtemps, mais j’ai décidé d’y vivre avec mon épouse.
Et je me suis dit, autant faire découvrir la ville qui est maintenant la mienne, le meilleur moyen de la découvrir, c’est de faire son histoire et de trouver la façon de la conter de façon la plus agréable possible, en l’illustrant d’ailleurs avec 30 dessins d’un rescapé rwandais. Et donc voilà, c’est une histoire simple. J’ai écrit le livre que j’aurais voulu lire.
C’était-il votre premier livre ?
Non, moi j’ai eu beaucoup de responsabilités syndicales, mutualistes, politiques, donc j’ai écrit plusieurs livres en France, mais à connotation politique et sociopolitique.
Et puis, j’ai écrit un livre avant d’arriver au Rwanda, avec Charles Habonimana, qui s’appelle « Moi, le dernier Tutsi ».
J’ai écrit ce livre qui témoigne de l’histoire d’un jeune garçon de 12 ans qui a vécu le génocide, avec cette idée du chef des interahamwe qui avait décimé le village, qui avait décimé ses parents, ses frères, ses soeurs, en lui disant que lui serait le dernier Tutsi qu’on tuerait sur ses collines pour faire voir à leurs enfants à quoi ressemblait un Tutsi.
Et cette prophétie, lui à la fois conduit à vivre avec les génocidaires, l’a préservé plus ou moins, parce qu’il aurait pu mourir plusieurs fois, et donc j’ai voulu raconter cette histoire assez exceptionnelle avec ce qui est devenu notre fils, vraiment, Charles Abunimana.
Impressionnant. Il semble y avoir un paradoxe ici, ou du moins quelque chose qui s’en approche. Vous êtes Français, vous avez exercé en politique en France, et vous choisissez de venir vous établir au Rwanda et de collaborer principalement avec les survivants du génocide contre les Tutsi. Charles Habonimana est devenu votre fils parce que vous avez travaillé ensemble, parcouru le pays et visité son village natal. Cela peut être difficile à comprendre pour beaucoup, compte tenu des relations entre la France et le Rwanda, notamment en ce qui concerne le génocide contre les Tutsi.
Vous savez, c’est une longue histoire de vie. On a tous une histoire de vie.
Moi, à l’âge de Charles, à 12 ans, c’est pour ça que j’avais beaucoup raisonné, je suis né à la vie politique en France contre la guerre d’Algérie. Et donc à 12 ans, je courais dans Paris, poursuivi par la police française, et l’Afrique m’a toujours intéressé. Je suis une génération des premières indépendances africaines.
Et donc quand la France a joué ce rôle infâme au Rwanda, je me suis levé pour essayer que la France au moins assume ses responsabilités.
Donc j’ai milité pour cela en France. Et c’est ce qui nous a conduits, voyant que la France ne bougeait pas, on s’est dit qu’il faut qu’on aille au Rwanda.
On avait une dette. J’ai toujours considéré qu’en tant que Français, j’ai une dette vis-à-vis du Rwanda. Et donc cette dette a fait que de fil en aiguille.
Ça ne s’est pas fait en un jour. Mais peu à peu, nous avons décidé de vivre avec vous et de partager, pas seulement l’histoire du génocide, mais de partager le développement du Rwanda, le rôle qu’il joue actuellement en Afrique et dans le monde.
Donc tout ça nous intéresse beaucoup. En tant que militant, ça m’a toujours beaucoup passionné.
Est-ce que c’est votre passé de syndicaliste qui vous a mis en contact avec les événements au Rwanda, à la fois avant, pendant et juste après le génocide ? Est-ce que c’est votre nature de combattant, de militant pour les droits de l’homme ? Qu’est-ce qui vous a attiré ?
Oui, c’est un engagement de toute une vie. Moi, j’ai été président de la Fédération des mutuelles de France dans mon pays. Donc j’ai toujours eu une activité pour les populations les plus démunies, pour les populations les plus pauvres, pour des accès aux soins élargis.
Donc oui, j’ai l’impression que je suis toujours le même, que je sois en France ou au Rwanda.
Avec le livre « Entendez-nous », vous contribuez énormément à porter la voix des veuves du génocide contre les Tutsi le plus loin possible. Est-ce que cela est en train de se réaliser ? Est-ce que les gens commencent à écouter ?
Le titre « Entendez-vous » ne vaut pas vraiment pour le Rwanda parce que ces femmes ont joué un rôle, elles ont été entendues dans leur pays, puisque ce sont elles qui ont les premiers reflets de société au Rwanda après le génocide.
Donc elles ont joué un rôle, elles continuent à jouer un rôle, y compris pour l’égalité des droits des femmes et des hommes. Mais on a voulu, là, avec les membres fondatrices, aborder deux aspects :
Celui du génocide du féminin, parce que ce génocide est un génocide qui a ciblé particulièrement les femmes, comme aucun autre génocide ne l’avait fait. Il semblait que, de façon universelle, on rejoint là la longue, trop longue histoire de domination des femmes qui a pu se... Même dans le crime des crimes, on a réussi à cibler encore plus les femmes, à faire qu’elles meurent dans des conditions effroyables, y compris après le génocide, en les ayant infectées du sida.
Il y a là, dans l’histoire universelle des femmes, quelque chose de très fort.
Et puis il y a l’aspect plus lumineux d’avoir eu ces femmes qui ont joué un rôle vraiment pionnier pour rassembler l’enfance du génocide, pour mener ces jeunes gens à ce qu’ils sont aujourd’hui, c’est-à-dire beaucoup de dirigeants du pays, beaucoup d’acteurs du pays. Donc tout cela... Et ce génocide qui apporte quelque chose de neuf au niveau de la connaissance humaine, il faut que ce soit l’humanité entière qui l’entendait.
Donc c’est un livre qui est tourné « Entendez-nous l’humanité ? », d’autant que les veuves du génocide prennent le flambeau, le relais, des victimes de la Shoah qui maintenant ont presque tous disparu.
Donc c’est à elles aujourd’hui, et on a voulu donner cette élévation pour que l’humanité en entier puisse entendre réellement les conditions qui peuvent se renouveler dans toutes les cultures, sur tous les territoires, de ce qu’est un génocide, et la façon, parce que ce génocide a aussi montré tout ce qui le rend possible, puisque c’était un génocide au vu et au su de tous.
Et donc qu’est-ce qu’on doit changer au niveau de l’ordre international ?
Et donc on fait un appel pour modifier, y compris, la convention de 1948, qui a été mise en échec par ce génocide, et pour faire un pas, alors que le monde est dans une situation...
Toutes les règles internationales sont foulées du pied depuis 1994, ça a été le signal aussi d’une vision délétère du droit international, donc qu’est-ce qu’on peut faire aujourd’hui pour faire un pas, pour redonner un sens à l’ordre international ?
Vous écrivez avec des femmes pour raconter le génocide féminin, ce qui n’était pas facile, même avant la publication du livre. Esther, ayant écrit de nombreux ouvrages, a parlé à beaucoup de femmes, mais cela n’a jamais été aisé, surtout durant les premières années après le génocide, de partager leur vécu, de raconter l’horreur subie. Et maintenant, en tant qu’homme, vous collaborez avec ces femmes pour écouter, raconter et transcrire le génocide féminin.
Vous savez, la littérature sert aussi à ça, elle permet d’être... Moi, je suis une veuve dans ce livre, je suis une veuve, elle permet justement d’approfondir toutes les connaissances qu’on a, et un homme peut le faire, je pense que je pouvais le faire.
Et puis, comment dire ? Les hommes aujourd’hui... Il y a quelque chose dans ce génocide, qui a ciblé spécifiquement les femmes, qui en dit beaucoup sur l’histoire de l’humanité, et des violences, de cette longue histoire des violences faites aux femmes, et qui redonne une vision un peu différente, même de l’histoire des génocides en général.
Parce que souvent, on a vu le génocide comme étant... qu’on ciblait un groupe humain en tant que tel, avec la race, avec la langue, avec la religion. Ça n’a pas été le cas au Rwanda, puisque les gens avaient les mêmes caractéristiques.
Ça nous fait dire que les violences faites aux femmes sont au cœur structurellement de la violence, et que toute l’ordre de la masculinité, toute l’ordre de la domination des hommes, toute la vision viriliste, toute la vision violente de l’humanité est la mise à jour.
Et donc, ce génocide apporte vraiment des choses très neuves, y compris pour la compréhension des génocides et des violences de masse en général. Et c’est une affaire d’hommes, je l’espère, vraiment, parce que ce génocide donne aussi la honte un peu d’être né homme.
Je pense qu’il était dans le foie assez naturel que ce soit un homme qui écrive cette histoire.
C’est vraiment important ce que vous avez fait, parce que moi, j’ai fait un film sur la violence aussi. Ce n’était pas facile. Je passais des nuits blanches après le tournage. Comment est-ce que vous avez vécu cette période pendant l’écriture ?
Premièrement, il faut bien voir que les femmes ont parlé du viol. Elles ont parlé du viol de façon frontale, en particulier lors des procès, où il fallait, devant des cours entières, dire. Et elles l’ont fait. Elles ont eu ce courage de le faire.
Souvent, on dit qu’on n’a pas parlé du viol. Je pense que les femmes ont parlé du viol. Il a fallu prendre la dimension que c’était des viols génocidaires, c’est-à-dire des viols dont l’intention et la programmation, ce n’étaient pas des hommes en ruite.
Non, c’était un programme pour détruire réellement les Tutsi et pour détruire toute capacité de production. Tout était sur la base sexuelle.
On ne peut pas parler du génocide sans parler du viol, et du viol de masse. Ça a été une arme du génocide. Ça a été l’arme principale pour les femmes du génocide.
Donc, je pense qu’elles-mêmes ont eu le courage de le faire. Et je pense qu’il faut avoir le courage de les entendre, le courage de décrire exactement ce qu’il en a été.
Et je n’ai pas trouvé de difficultés particulières. Immaculée, par exemple, dans notre livre, parle tout à fait du viol. Elle n’en a jamais parlé à sa fille, par exemple. C’est la première fois qu’elle l’exprime de façon... Mais, elle me dit, ma fille le sait. Parce que même les silences sont parlantes.
Je pense qu’on ne peut pas aborder, évidemment, cette phase tragique de l’humanité, sans aborder cette question du viol, et du viol systématique des femmes, bien sûr.
C’est la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis, et je crois que vous saluez le courage de ces femmes dans la gestion de l’après-génocide pour recouvrir la vie, réembrasser la vie, se refaire un toit et prendre soin des orphelins, malgré leurs propres manques. Mais, pendant ces conversations, ces entretiens, qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans leurs luttes, compte tenu de ce qu’elles ont accompli au cours de ces 30 dernières années ?
Vous savez, c’est un livre dont on a essayé de l’élever au niveau des grandes tragédies humaines.
Ce n’est pas seulement un livre qui agglomère des témoignages. C’est un livre qui essaie de faire un récit au plus haut niveau possible. Et ce qui est le plus frappant, c’est comment elles-mêmes, dès le début, s’autodéterminent pour déjà revenir à nous.
C’est-à-dire une communauté de femmes, déjà une communauté de larmes, déjà une communauté de gestes, une communauté de récits. C’est là qu’on voit que le récit devient...
C’est au-delà du témoignage, parce que souvent on a une vision du témoignage un peu juridique. Mais non, c’est la faculté... Nous sommes des êtres de parole.
C’est la faculté de revenir en humanité. Parce que même si chacune d’entre elles ne pouvait plus espérer pour elle-même, c’était la désolation totale, elles avaient perdu leurs enfants, elles avaient perdu leurs parents, elles étaient orphelines, elles n’étaient pas seulement veuves, c’était des jeunes, veuves de 20 ans.
Elles avaient mis au monde des enfants, parfois le jour même du déclenchement du génocide, ou durant le génocide, ou un mois avant.
Elles avaient tout perdu, elles n’avaient plus rien. Mais au moins, elles n’avaient plus d’espoir pour elles-mêmes. Et ce qui les guidait, ce qui pouvait arriver, c’était la folie, tout simplement.
Certaines, d’ailleurs, ont basculé dans la folie, bien sûr. Mais pouvoir espérer pour l’autre, que vous avez devant vous, qui elle-même vous dit son expérience, permet justement de retourner en humanité. Et c’est ce jeu, justement.
Elles ont créé une intériorité commune. C’est-à-dire, devient tout de suite une communauté de santé mentale. Il n’y a pas besoin de thérapeutes, c’est elles qui permettent de ne pas basculer dans la folie.
Chaque compagne permet de revenir à elle-même. Et quand on commence à avoir un espoir pour l’autre, l’humanité recommence.
C’est cette thérapie collective dont je vous parlais précédemment, peut-être était-elle la plus efficace, je ne sais pas, même si l’intervention de professionnels s’est avérée nécessaire. Mais les femmes avaient déjà commencé ce travail par elles-mêmes, bien avant. Retrouvez-vous le même processus chez les veuves, un peu partout dans le pays ? Est-ce uniquement dans la ville de Kigali ou aussi dans d’autres villes ? Est-ce un phénomène national que vous avez observé ?
Premièrement, les premières fondatrices m’ont dit que, ici ou là, ce n’est pas venu seulement de ce noyau-là. Ici ou là, d’autres femmes avaient commencé spontanément.
C’est très différent de ce qui s’est passé dans tous les autres génocides. Dans les autres génocides ou dans les massacres de masse qu’on a connus dans l’humanité, les victimes, souvent, deviennent un groupe le plus pauvre, le plus stigmatisé de la population, etc.
Moi, j’ai beaucoup travaillé avec mes amis japonais, après l’irradiation d’Hiroshima et Nagasaki, qui a des effets qui se mesurent encore aujourd’hui.
Au Japon, ce groupe-là a été stigmatisé. Là, c’est l’inverse qui s’est passé. C’est elles qui ont refait société.
Elles ne se sont pas senties comme victimes. Elles étaient victimes, bien sûr. Mais elles ont reconstruit les liens et reconstruit le pays.
Donc, c’est quelque chose qui a basculé. Et ça, ça s’est fait. Certes, les premières se sont organisées à Kigali, mais elles ont tout de suite décidé d’aller sur les collines.
Et ça n’a pas été une association centralisée. La première demande qu’elles ont faite, quand elles ont été reçues par le vice-président de la République, Paul Kigamé, à cette époque-là, c’est de lui dire, quand le vice-président demande « qu’est-ce que je peux faire pour vous aider ? »
On raconte dans le livre ces premières rencontres entre ces femmes et le couple, aujourd’hui présidentiel. Et le vice-président leur demande « mais qu’est-ce que je peux faire pour vous ? » Et la première réponse, elle dit « il faut qu’on ait les moyens d’aller sur les collines partout, parce qu’elles sont là-bas.
Nos sœurs, nos sœurs démunies, isolées, etc., sont là-bas. » Et donc, la première chose, ça va être une camionnette. Et ça va être la possibilité d’aller dans tout le Rwanda.
Ce n’est pas une organisation centralisée qui va faire des actions d’aide aux populations. C’est une organisation qui va auto-organiser partout la relation, la communauté de santé mentale, partout, sur l’ensemble des collines. Et c’est ça qui est admirable, bien sûr.
De nombreuses femmes ont été infectées par le VIH et ont mis du temps à obtenir des traitements adéquats. Cette situation représente-t-elle une partie importante de votre livre, dans les recherches que vous avez effectuées ? Quel était le combat ? Pouvez-vous nous parler de ce combat contre la maladie, alors que ces femmes manquaient de tout et luttaient pour leur survie ?
D’ailleurs, celles qui témoignaient dans les premiers procès, y compris au tribunal pénal international, témoignaient et en même temps n’avaient pas les thérapies.
Le TPIR ne leur a pas permis, y compris d’avoir les médicaments. Certaines ont témoigné et sont mortes dans des souffrances terribles après leur propre témoignage, etc. Et l’association a tout de suite essayé de faire un travail de recherche sur ces problèmes-là.
La première enquête faite par les femmes d’Avega porte justement sur cette... Pour prendre la dimension déjà de ce qu’étaient les viols collectifs, les viols génocidaires, il y a donc une enquête qui est faite en 1999 qui permet justement de qualifier et d’avoir une vision assez claire de ce qui s’est passé dans le pays, partout.
Avec cette dimension qui, moi, m’a beaucoup frappé, de ne pas rester seulement sur ces aspects-là, mais de prendre en compte toutes les violences faites aux femmes, y compris les violences intrafamiliales, parce que ça leur a permis, et ça a permis d’ailleurs au Rwanda, d’avoir une législation d’égalité, de lutte contre les violences faites aux femmes, quelles qu’elles soient dans tous les milieux sociaux, et d’avoir une législation tout à fait en avance.
Ce sont des femmes qui, en quelques années, ont fait basculer une société très patriarcale dans l’égalité femmes-hommes, en Afrique, ce qui était quand même assez... Alors que ce combat, sur d’autres continents, sur d’autres cultures, a mis des siècles à se...
Et là, elles l’ont fait en 30 ans, puisqu’aujourd’hui, on voit les résultats, on voit la place qu’ont les femmes au Rwanda, on peut parler d’égalité.
Ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de violences faites aux femmes, y compris dans la cellule familiale ou dans d’autres domaines.
Ça veut dire que le niveau de lutte contre les violences faites aux femmes ne s’est pas arrêté seulement aux violences génocidaires.
Quand je réfléchis à ce parcours, je perçois deux facteurs clés : l’activisme des femmes, incluant Esther, les cofondatrices d’AVEGA, et d’autres encore, actives dans les ONG et divers milieux. Il y a aussi la volonté politique de soutenir ces femmes, de les élever et de les accompagner.
Au cours de ces 30 dernières années, avez-vous observé que le rôle de ces femmes activistes a pris de plus en plus d’importance pour assurer la pérennité de leurs actions, étant donné que ce n’est pas le gouvernement qui se charge d’aider une catégorie spécifique mais pas une autre ?
Sont-elles devenues plus autonomes dans la conduite d’actions en faveur de ces veuves à travers le pays ? Y a-t-il des exemples de cette expérience dans leur lutte ?
Oui. Encore une fois, on est dans une situation très originale, parce qu’aucun génocide n’a été arrêté par les enfants du groupe humain ciblé en tant que tel.
C’est la première fois que ça arrive dans l’histoire humaine. Et donc, ces femmes et les soldats du Front Patriotique Rwandais, c’étaient leurs frères, c’étaient leurs sœurs.
Donc, l’harmonie, l’aide réciproque, il y a eu une aide, bien sûr, au niveau politique, au niveau de l’institution politique, mais il y a eu une aide des femmes pour l’institution politique aussi.
Ce n’était pas ascensionnique, ce n’étaient pas des politiques publiques qui tombaient sur les populations, c’était la population elle-même qui s’était saisie de sa propre autonomie pour progresser dans le sens que vous dites.
C’est très important, y compris pour aujourd’hui, parce que souvent, je vois les titres en Occident qui disent le miracle rwandais. Certes, Imana est avec nous, est avec vous, mais ce sont des activités humaines.
Par contre, on dit, oui, mais c’est un système coercitif, autoritaire, etc. Venez au Rwanda voir comment cela se passe, parce que justement, cette liaison entre populations et ceux qui ont arrêté le génocide était une liaison active, proactive. Les populations se sont prises en main pour aboutir à ces politiques-là.
Donc, ce n’est pas quelque chose qui tombe dehors, c’est quelque chose qui monte en haut. Donc, il y a une réciprocité entre les politiques publiques et l’autodétermination des populations.
Cela me ramène à ce que vous disiez précédemment, à savoir que le livre « Entendez-nous » ne s’adresse pas spécifiquement aux Rwandais, encore moins au gouvernement, puisque, selon vos explications, le gouvernement a déjà pris conscience et continue d’être à l’écoute.
Ainsi, s’agit-il de la communauté internationale qui, n’ayant pas encore pris pleinement conscience, ne prête pas encore l’oreille, alors que des conflits éclatent un peu partout et que des femmes sont toujours victimes de violences ? Avez-vous l’espoir que ce livre puisse réveiller ces consciences ?
Écoutez, un livre ne fait pas le printemps, hélas ! Mais pourquoi pas ? Tout va dépendre des lecteurs. Moi, quand je l’ai présenté lors du colloque international, j’ai dit que la responsabilité maintenant n’était plus la nôtre, elle était celle des lecteurs.
Il est très important, et s’adresse aux Rwandais aussi, dans le sens que l’un des risques de la situation actuelle, et bien sûr c’est la poursuite de l’idéologie génocidaire, y compris en République démocratique du Congo, mais il y a un risque majeur pour moi, et ça c’est une fois que la responsabilité des pays aura été dite, de dire, bon, c’est un génocide de plus.
Or, ce n’est pas seulement un génocide qui s’est additionné au génocide précédent, ce génocide apporte des connaissances neuves. Il apporte des connaissances neuves dans le processus génocidaire lui-même, et il apporte des connaissances neuves dans la capacité de refaire société après un génocide.
Donc cette idée de porter cette... C’est pour ça qu’il y a un très gros effort d’écriture, un très gros effort de retrouver, y compris, l’âme de la poésie rwandaise, pour que le message soit universel, effectivement.
Donc il y a une possibilité d’avancer au niveau international, pas sur tous les aspects du droit international, mais sur celui du génocide, il y a une possibilité de le faire. À condition qu’on prenne certaines mesures neuves dans la Convention de 48.
C’est pour ça que nous faisons des propositions de modifier la Convention de 48, qui n’a pas permis, contrairement à ce qu’on avait dit en 48, on avait dit plus jamais ça. Or, 50 ans après, il y a eu ça.
Donc il y a une possibilité d’avancer au niveau international, pas sur tous les aspects du droit international, mais sur celui du génocide, il y a une possibilité de le faire, à condition qu’on prenne certaines mesures neuves dans la Convention de 48.
C’est pour ça que nous faisons des propositions de modifier la Convention de 48, qui n’a pas permis, contrairement à ce qu’on avait dit en 48, on avait dit « plus jamais ça ». Or, 50 ans après, il y a eu ça. C’est donc que la Convention internationale n’est pas adaptée à la situation.
Il y a une possibilité de rassemblement de l’opinion internationale, pas sur l’ensemble des guerres actuelles, on le voit bien, elle est déchirée complètement, mais sur les aspects du génocide, c’est-à-dire sur quelque chose qui est prévisible, parce qu’un génocide est toujours prévisible.
C’est un long processus de préparation. Ce n’est pas le cas pour les crimes de guerre qui ne sont pas prévisibles. Les génocides sont prévisibles.
Donc il est possible de faire un petit pas d’amélioration du droit international, et on aurait très besoin d’un petit pas d’amélioration du droit international pour redonner espoir dans ce droit international qui aujourd’hui est complètement délité.
Donc oui, c’est un message que nous voulons porter avec des propositions très concrètes, y compris sur l’abandon du droit de veto en cas de processus génocidaire, puisqu’on s’est aperçu, y compris avec ce génocide, que pour qu’un génocide puisse se mener, il faut toujours des complicités d’autres États, et en particulier d’États qui ont le siège permanent au Conseil de sécurité.
Ça a été vrai du génocide arménien, ça a été vrai y compris du génocide des Juifs, et donc il faut que ce soit vrai pour bouger, y compris cette histoire du droit de veto. Moi j’ai espoir qu’avec ce livre, avec des relations internationales qui nous amènent à amplifier le mouvement, nous puissions déposer à l’ONU ces propositions.
Le génocide a pris fin, mais le négationnisme, le déni du génocide, n’a fait que commencer, causant encore des dommages aujourd’hui. Est-ce que cet aspect est apparu dans votre travail sur ce livre ? Je veux dire, dans quelle mesure ce négationnisme a-t-il affecté ces veuves, ces survivantes, ces femmes ? D’un côté, il y a ce négationnisme, surtout présent dans les pays étrangers et en Occident, et de l’autre, vous avez mentionné les procès où les femmes témoins ont été humiliées.
Comment cela a-t-il freiné le progrès de ces femmes au cours de ces 30 dernières années ? Comment ont-elles fait face à ce phénomène ?
Le négationnisme, évidemment, est combattu, mais je pense que ce livre ne peut pas aborder et régler tous les problèmes, évidemment. Et d’autres acteurs, on l’a vu lors du colloque international, on a vu beaucoup de livres sortir à la fin de ce 30e anniversaire.
Donc on s’est moins accroché au négationnisme, parce que les choses sont tellement évidentes sur ce problème qu’il faut combattre le négationnisme. C’est un délit maintenant, il faut le réprimer tout simplement.
Ce qu’on a plutôt mis en avant, c’est cette idée que dans le fond, ce génocide n’intéresserait que le Rwanda.
Or, c’est lui donner cette dimension universelle. Ce livre travaille cet aspect-là, et le travail y compris dans la langue. C’est un travail d’écriture, j’ai écrit ce livre à partir des témoignages, mais je l’ai écrit pour lui donner un peu le niveau d’écriture des grandes tragédies de nos ancêtres.
Parce qu’il faut toucher la population, il ne faut pas seulement décrire, il faut avoir des mots, des paroles, des images, une poésie même.
J’ai cité un philosophe allemand, Walter Benjamin, qui disait que tous les actes de culture ont été en même temps des actes de barbarie, qui mettaient en cause une vision un peu irénique de la culture. Vous savez bien qu’on peut aussi opposer les cultures, et ça peut être indéfermant aussi, de l’isolement de groupes humains.
Donc la culture, souvent, on lui donne un côté uniquement positif, or elle charrie aussi la barbarie. Il dit ça. Et ce livre tente d’inverser aussi la formule, et dire que tout acte de barbarie doit devenir aussi un acte de culture.
Elle doit permettre à l’humanité de se saisir des plus hautes façons d’être humain aujourd’hui.
Aujourd’hui, le monde entier a les yeux braqués sur la 30e commémoration du génocide contre les Tutsi. La France aussi porte son regard ici. Depuis quelques années, les présidents français reconnaissent les responsabilités de la France dans le génocide contre les Tutsi. Sarkozy a notamment beaucoup œuvré dans cette direction.
Beaucoup. Il a morcé, oui. Un peu. C’est bien dit. Un peu. C’est bien dit. N’exagérons pas.
Le président Macron a franchi une nouvelle étape. Il a déclaré que la France aurait pu arrêter le génocide, mais qu’elle n’en avait pas la volonté. Ces propos sont significatifs, surtout venant du président français.
Comment ces déclarations sont-elles perçues en France ? Je sais que vous êtes ici, mais en tant que Français, vous suivez certainement les événements qui se déroulent en France.
Oui. Vous savez, j’ai eu l’occasion d’ailleurs de dialoguer un peu à l’Institut français de Kigali avec Vincent Duclerc.
Il y a là des jeux politiques, mais bon, il n’échappe à personne que la France a été complice du génocide. Ce n’est pas vouloir faire de la polémique ou de vouloir mettre mon pays au bord de la société. Évidemment, il y a une complicité, évidemment.
Il n’y a même pas débat pour moi sur cette question. Donc voilà les petits pas. Non, en reconnaissant tout simplement ce qu’il y a. C’est moins important pour le passé, parce que malheureusement, le passé a été fait.
Voilà. C’est très important pour l’avenir, parce qu’encore une fois, tout génocide, qui est un crime d’État, le génocide est un crime d’État, aucune autre structure ne peut mener un génocide qu’un État, tout génocide peut se développer sur des dizaines d’années, le processus génocidaire peut se développer, à condition qu’il y ait des complicités d’autres États. C’est en cela que c’est important de relire les phénomènes de complicité, que ce soit de la France ou quelqu’un d’autre.
L’Allemagne a reconnu en 2016, ce n’est pas assez connu dans l’histoire, qu’elle a été complice du génocide arménien. Le président de la République allemande a déclaré que l’Allemagne était complice du génocide arménien. Si vous relisez le génocide des Juifs en Europe, vous vous apercevez que les alliés qui combattaient le régime nazi savaient depuis 1942 qu’il y avait le génocide des Juifs.
Ils n’ont pris aucune disposition pour bloquer le génocide des Juifs. Ils ont fait la guerre, bien sûr, ils ont libéré les pays, mais aucune disposition spécifique pour bloquer le génocide. La France, le rapport Muses le dit dans une formule simple, la France a rendu possible un génocide prévisible.
Je pense que c’est très clair. Les problèmes de complicité, pour moi, c’est moins de mettre la France en cause. Elle l’est, elle l’est, voilà.
C’est de bien comprendre qu’un génocide ne peut pas se dérouler s’il n’y a pas la complicité et la complicité d’États qui peuvent bloquer la communauté internationale.
D’où cette histoire du droit de veto, par exemple, en cas de massacre de masse ou de génocide. Le débat, il est là pour moi, et il est moins de se dire est-ce que la France a été complice ou pas ? Bien sûr qu’elle a été complice, tout le monde a compris.
Ce n’est pas ça le débat, c’est est-ce qu’on va créer, parce que les déclarations sont intéressantes, mais ce sont les actes qui comptent.
Je crois que beaucoup de personnes pensent que chaque citoyen français est coupable de ce crime. Avez-vous réfléchi à ce fait ? On pense souvent que chaque citoyen est impliqué. Ce sujet n’est pas suffisamment abordé, et on pourrait croire à une haine éternelle entre les citoyens des deux pays. Je ne pense pas que ce soit le cas. Vous avez fait un commentaire à ce sujet.
Non, ce n’est pas le cas, parce que premièrement, ici au Rwanda, on ne ressent aucune velléité de ce type. Même, moi je suis arrivé au Rwanda bien avant que la France reconnaisse ses responsabilités, et jamais je me suis senti visé, en tant qu’individu, en tant que français, par une acrimonie spécifique des Rwandais.
Je pense un peu à l’inverse, c’est-à-dire que les Rwandais font beaucoup la différence entre les décisions politiques et les citoyens. Moi, je suis moins... Je pense que les citoyens, donc je suis dedans, ont une responsabilité.
Certes, la politique française a été cachée pour une large partie aux citoyens français.
Elle a été menée dans des conditions tout à fait illégales, y compris du point de vue de la Constitution française. Là-dessus, le rapport Duclerc est très clair, et il détaille toutes les façons qu’a utilisées l’État français de l’époque pour cacher à la population, pour ne pas prendre les décisions sur les bases démocratiques, vis-à-vis du Parlement, etc. Ça, c’est vrai.
Mais je pense que les Français, là, je parle des citoyens, qui ont un lourd passé colonial, parce que ce n’est pas la seule entorse aux droits internationaux dont nous sommes coupables en France. Moi, j’ai milité contre la guerre d’Algérie quand j’avais 12 ans, 14 ans, 16 ans. Ça a été un massacre absolu.
Il y a eu un million de morts dans la guerre d’Algérie, un million d’Algériens qui ont été tués. Donc, je pense que les Français ont une responsabilité profonde que si leur pays peut renouveler sans cesse ce type d’intrusion, ils en sont aussi responsables. Ils n’ont pas le regard suffisamment curieux et affité sur ce que font leurs dirigeants.
Il n’y a pas une culture qui permet de sanctionner les politiques qui dérogent aux valeurs françaises d’égalité, de liberté, de fraternité. Donc, je pense qu’on ne peut pas seulement dire que c’est la faute de Mitterrand, évidemment. Mitterrand a une responsabilité terrible et s’en débarrasser comme ça.
Non, je pense que c’est toute une façon qu’à la France de se sentir au corps au-dessus des nations, cette espèce d’arrogance, comme si nous étions les champions de la démocratie, alors que les faits nous démontrent l’inverse. Toute notre histoire nous démontre l’inverse. Donc, les Français ont une responsabilité. Moi, j’ai une responsabilité. J’essaie de l’assumer.
J’ai honte d’avoir été dans ce pays qui a joué ce rôle au Rwanda, comme elle l’a joué en Algérie, comme elle l’a joué dans 45 interventions militaires françaises en Afrique depuis la dernière guerre mondiale.
J’ai ma part de responsabilité. J’essaie de l’assumer sous cette façon-là, mais j’appelle les Français à assumer leur propre part de responsabilité. On ne peut pas dire « je ne savais pas ». C’est un terme qui n’existe pas pour moi. Un citoyen ne peut pas se cacher derrière cette façon de vivre.
Rassurez-vous, aujourd’hui, vous êtes citoyen originaire de Mayunzwe, au plus profond du Rwanda.
Parlant de Mitterrand, je crois que c’est lui qui avait dit : « Un génocide dans ces pays, ça n’a pas la même importance. » Alors, en écrivant « Entendez-nous », vous vous adressez au monde entier.
Ne serait-il pas nécessaire d’avoir un « Entendez-nous » spécifiquement adressé aux pays africains, surtout ceux de la région ? Car ce devraient être eux les premiers à intervenir, ceux qui auraient dû intervenir.
C’est vrai. Ce que je dis sur le citoyen français est valable pour moi, pour le citoyen africain aussi. Je pense que cette histoire du génocide perpétré contre les Tutsi, les Africains ne se la sont pas appropriée.
Il y a beaucoup plus, aujourd’hui, d’articles, de reportages, de réflexions profondes en Europe qu’en Afrique. C’est un fait qui est dommageable pour l’Afrique, très certainement. Et donc oui, je pense que les Africains ont aussi une responsabilité, bien sûr. Ils ont une responsabilité, là, y compris de la poursuite de processus génocidaires à la frontière du Rwanda.
Ils ne peuvent pas, à mon avis, je ne suis pas un donneur d’ordre, mais ils ne peuvent pas faire comme s’il n’y avait pas ce génocide, comme si les Tutsi congolais ne subissaient pas des processus génocidaires, comme si l’idée du double génocide qui reflorait dans la bouche quand le président du Congo, aujourd’hui, dit, par exemple, qu’il y a eu 10 millions de morts au Congo suite au génocide au Rwanda, on ne peut pas laisser dire ça.
Donc oui, il y a un devoir de vigilance, il y a un devoir d’intervention, mais au sens citoyen du terme, sans se faire voiler par des processus qui sont des processus de haine. Oui, il y a une responsabilité africaine, bien sûr, et je pense qu’elle doit jouer son rôle.
Moi, je suis particulièrement heureux d’avoir entendu, par exemple, que les nouveaux dirigeants du Sénégal ont parlé de façon louangeuse du Rwanda, par exemple, dès leur première déclaration.
Moi, j’étais en France il y a un an et je me suis aperçu, en discutant avec les Africains de France, qui sont nombreux, surtout en région parisienne, à chaque fois que je parlais du Rwanda, il y avait une espèce d’espoir qui brillait.
Donc je pense que la population africaine, si elle ne s’est pas saisie de ses propres responsabilités sur le génocide perpétré contre les Tutsi, par contre, a un œil aiguisé, plus qu’intéressé à la façon dont le Rwanda émerge et est gouverné.
Il y a là l’idée que quelque chose d’important se joue sur leur continent. Donc le désintérêt porte plus sur le génocide que sur le Rwanda d’aujourd’hui. Mais pour bien comprendre, il faut faire la liaison, bien sûr.
Monsieur Le Scornet, vous avez écrit avec Charles Habonimana « Moi, le dernier Tutsi », et vous venez également d’écrire un livre avec une veuve d’AVEGA. Avez-vous d’autres projets de collaboration en cours pour écrire à propos du génocide contre les Tutsi ?
L’écriture est une chose personnelle. Elle permet justement de transcender les gens avec qui vous écrivez aussi.
Donc c’est un processus. Évidemment, je n’aurais pas pu écrire ce livre sans mes 13 veuves du génocide. J’ai toujours beaucoup écrit. Je suis intéressé par la littérature. Je pense que la littérature, c’est vrai du cinéma aussi, ce sont par les grandes œuvres que vous touchez des populations. Et ce n’est pas seulement en recueillant des témoignages.
Il faut ensuite les écrire. Leur donner le souffle du langage qui permet justement de... Et donc, oui, bien sûr, premièrement, nous avons créé une maison d’édition avec mon épouse.
Je salue mon épouse qui est directrice de cette maison d’édition parce que nous pensons que là encore, une des faiblesses en Afrique, c’est la faible présence du livre, la faible présence de maisons d’édition parce que pour que le livre vive, il faut qu’il y ait des éditeurs.
Et donc nous avons créé une maison d’édition, une petite maison d’édition ici à Kigali. Et premièrement, nous avons la chance d’éditer pour le 30e anniversaire le livre de Me Bernard MAINGIN avocat, que nous avons édité.
C’est un grand plaisir de l’avoir fait, qui relate donc toute l’histoire judiciaire qui s’est développée à partir de l’attentat sur le Falcon le 6 avril, c’est-à-dire il y a 30 ans aujourd’hui.
Donc ce livre est une création de la maison d’édition histoire et images. Il y a maintenant d’autres auteurs rwandais qui commencent à me proposer des manuscrits. C’est une petite maison, je n’ai pas de capitaux, je fais ça avec une certaine modestie économique.
Il faut que nos premiers livres marchent un peu pour qu’on puisse en tirer d’autres. J’ai un écrit qu’il faut que je retravaille, très certainement, toujours dans cette période du confinement. J’avais fait un écrit sur l’enfance du génocide.
Parce que si ce génocide était un génocide du féminin, c’était aussi un génocide de l’enfance. Et le génocide de l’enfance, il y a eu des témoignages. Encore une fois, je ne suis pas le seul à écrire. Il y a beaucoup de gens, et tant mieux, plus il y aura de gens qui écrivent.
Mais je pense que il faut trouver les mots, là encore, d’où l’importance de l’écriture, qui permettent aux jeunes rwandais en particulier, mais aux jeunes du monde entier, de saisir ce qu’est un processus génocidaire et comment ils peuvent non pas l’endosser comme un fardeau, mais surtout pour ceux qui certes pour les rescapés, mais aussi pour les enfants de génocideurs, pour qu’il ne soit pas un fardeau sur leur propre vie, mais qu’il soit un moyen à eux-mêmes de devenir des hommes et des femmes tels qu’on les voudrait. C’est plutôt dans ce sens-là que j’ai envie d’écrire.
Mais lorsque je vous interroge sur la manière dont vous, en tant qu’homme menant des recherches, cherchez à amener les femmes à parler de sujets très intimes, vous répondez que vous êtes aussi une veuve du génocide, que vous faites partie de ces veuves.
C’est cela, donc vous vous êtes intégré, je comprends. Mais quel a été le processus d’acceptation de la part de ces femmes pour qu’elles vous acceptent ? Ce fut un parcours, n’est-ce pas ?
Là, ça a été assez simple, ce sont elles qui sont venues me trouver. Ce n’est pas moi qui ai dit je veux écrire sur le génocide des féminins. Là, c’était pour moi assez simple. Et je pense que c’est une certaine confiance.
C’est vrai que le livre que j’ai écrit avec Charles, et je pense que dans les relations que nous avons créées avec leurs associations et avec les personnes elles-mêmes, c’est elles qui m’ont demandé. Elles n’ont pas demandé à une femme, mais elles l’ont demandé à moi.
Donc il y avait un sens y compris certainement pour elles. Ça serait plutôt à elles qui faudrait poser la question. Pourquoi avez-vous choisi un homme ? Mais ce sont elles qui m’ont choisi. Je ne suis pas un professionnel ni de l’écriture, je ne suis pas un scientifique.
Je n’ai pas dit je vais m’occuper comme le font, avec la juste raison des chercheurs qui disent le problème féminin, il faut que je le travaille, etc. Non, ce sont encore une fois les femmes qui sont venues me dire nous souhaiterions que vous écriviez sur notre fondation.
Je sais que vous travaillez étroitement avec votre épouse. Peut-être est-elle liée d’une manière ou d’une autre à cette situation. Avait-elle des amis au sein de l’association ?
Oui, elle est indéniablement pour quelque chose. Mais pas dans le choix qu’ont fait les femmes. Parce que les 13 femmes concernées, nous ne les connaissions pas réellement avant. Je pense que c’est plus par oui-dire, par la façon.
Mais je dois à mon épouse d’avoir vraiment, elle a une telle communion ensuite avec ses sœurs qu’évidemment elle a créé, vous savez quand on se rencontrait à la maison, parce qu’elles venaient à la maison, il y avait toujours une pâtisserie, il y avait toujours un lien féminin au sens fort du terme qui a beaucoup facilité bien sûr.
Mais ça n’a pas été déclencheur. Ce sont les femmes qui se sont tournées vers un homme et je pense que c’est à elles qu’il faut plutôt poser la question.
Oui, je ne m’en fais pas, je vais le faire. Nous sommes à la 30e commémoration du génocide contre les Tutsi et vous avez écrit « Entendez-nous », un livre qui se concentre principalement sur la période récemment terminée.
Mais aujourd’hui, si vous deviez écrire un autre livre, cette fois sur les réalisations plutôt que sur les horreurs vécues, sur quoi porterait-il ? De quoi parleriez-vous ?
Je vous ai dit sur les problèmes de l’enfance, mais bon, je ne sais pas, je suis vieux, le temps m’est compté. J’ai eu une vie, Dieu merci, très très riche. Et peu à peu, en remémorant, je trouve qu’il y a une certaine continuité dans le parcours qui est le mien.
Donc, je ne sais pas, je pense que bien comprendre, j’aimerais faire bien comprendre, parce que beaucoup d’amis français se sont très étonnés, et la famille plus encore, que nous décidions d’aller vivre au Rwanda. Et dans le fond, il reste pour eux un incompréhensible.
J’aimerais assez trouver la façon de montrer que dans le fond, c’est une continuité, que j’ai toujours pensé le Rwanda.
D’ailleurs, il y a une petite chose qui m’a toujours amusé, moi-même, c’est que lorsque j’étais gamin, j’étais à l’école comme tout le monde, pas longtemps, à l’école primaire au moins, et quand les professeurs de géographie ont donné ce nom Rwanda-Urundi, je ne sais pas pourquoi, ça m’a fait quelque chose.
Je ne connaissais rien du tout. Et longtemps, je ne me suis pas vraiment intéressé, je me suis plus intéressé à l’Algérie, au lieu où la France sévissait depuis tant d’années. Mais ce mot m’a toujours fait un peu rêver, et c’est assez amusant de le retrouver à la fin de ma vie de façon aussi puissante.

















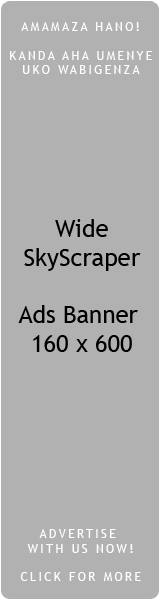
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!