En novembre 2022, le président Félix Tshisekedi, dans un contexte de tension exacerbée face au M23, appelait à la constitution de « groupes de vigilance contre les velléités expansionnistes ». Moins d’un an plus tard, le décret du 3 septembre 2023 venait légaliser la présence des milices Wazalendo aux côtés des FARDC. Cette décision, présentée comme un sursaut patriotique, s’est muée en aveu de faiblesse : l’État reconnaissait son incapacité à assurer seul la défense de la nation et recourait à des supplétifs incontrôlables.
Depuis, le terme Wazalendo s’est banalisé autant que la présence d’hommes armés en treillis, tandis que les combats se sont intensifiés à partir d’octobre 2023. Mais derrière cette apparente mobilisation populaire se cache une réalité plus sombre : la dilution de l’autorité militaire dans une nébuleuse de factions hybrides, incontrôlées et incontrôlables.
L’épisode d’Uvira, où ces mêmes milices ont défié l’autorité présidentielle en menaçant un officier supérieur, n’est pas une anomalie. Il est le symptôme d’une dérive anticipée, inscrite dès l’origine dans l’équation perverse qui consiste à substituer la rue armée à l’armée nationale.
Responsabilités politiques et faillite de l’État
La responsabilité du pouvoir en place est ici écrasante. En distribuant des armes à des civils sans formation technique ni encadrement idéologique, Kinshasa a créé les conditions d’une criminalité institutionnalisée. L’arme censée défendre la nation est devenue instrument d’intimidation et vecteur de revanche identitaire. La promesse d’un patriotisme populaire s’est muée en une culture de violence diffuse, où les slogans de haine et les menaces de mort tiennent lieu de programme politique.
La défaite n’est pas seulement militaire, elle est d’abord politique : le chef de l’État, en croyant instrumentaliser les milices contre le M23, a creusé la tombe de sa propre autorité. Les Wazalendo ne se conçoivent plus comme de simples auxiliaires, mais comme des acteurs autonomes, parfois supérieurs à l’armée régulière qu’ils prétendent épauler.
Les institutions congolaises, qui devraient incarner la suprématie de la loi et le socle inébranlable de la souveraineté nationale, se trouvent paradoxalement réduites à négocier leur propre survie avec des forces parallèles qu’elles ont elles-mêmes contribué à légitimer.
Au lieu d’imposer leur autorité, elles se résignent à composer avec une puissance centrifuge, insoumise par essence, qui s’arroge le droit de contester, de défier et, finalement, de délégitimer l’édifice républicain. L’État, en abdiquant son monopole régalien de la violence légitime, a offert à ces milices le terrain propice pour se muer en contre-pouvoirs de fait, dont l’agenda repose moins sur la défense de la nation que sur la satisfaction de logiques identitaires et de calculs prédateurs.
Ainsi, loin de consolider l’autorité qu’il prétendait affermir, le pouvoir en place a enfanté une créature hybride, sans loyauté véritable, animée par la brutalité et l’instinct de domination. Ce monstre, forgé dans la précipitation et l’aveuglement politique, échappe désormais au contrôle de son concepteur. Tshisekedi, en croyant susciter un élan patriotique, a engendré une entité qui ronge les fondations mêmes de l’État et menace d’en précipiter la dislocation.
Ce renversement tragique illustre la loi implacable des armes confiées à ceux qui n’obéissent à aucune discipline : elles finissent toujours par se retourner contre celui qui les a distribuées.
Perspectives et nécessité d’un sursaut stratégique
L’avenir immédiat est porteur de périls majeurs. En distribuant des armes sans contrôle, le pouvoir a semé les germes d’une conflagration qui pourrait embraser non seulement les FARDC, mais l’ensemble du tissu national. Les événements d’Uvira rappellent que les armes ne restent jamais silencieuses : tôt ou tard, elles se retournent contre celui qui les a mises en circulation. La menace n’est plus seulement celle de l’AFC/M23, mais celle d’une miliciarisation généralisée qui fragilise l’État jusqu’à son cœur.
Le sursaut passe par un choix clair : rétablir une armée professionnelle, disciplinée et unifiée, débarrassée de ces supplétifs dont la loyauté est conditionnelle et volatile. Il implique aussi de substituer à la rhétorique belliqueuse une stratégie politique réaliste, intégrant dialogue, réformes internes et cohésion sociale. Faute de quoi, la RDC demeurera prisonnière d’un cercle vicieux où l’État, croyant se défendre, se saborde lui-même.
En vérité, la République démocratique du Congo ne sera sauvée ni par les Wazalendo, ni par les slogans martiaux, mais par la restauration de l’autorité républicaine. Encore faut-il que le pouvoir accepte de reconnaître que son pari sécuritaire était une erreur tragique : car le monstre qu’il a enfanté s’avance déjà, menaçant, vers ses propres fondations.
















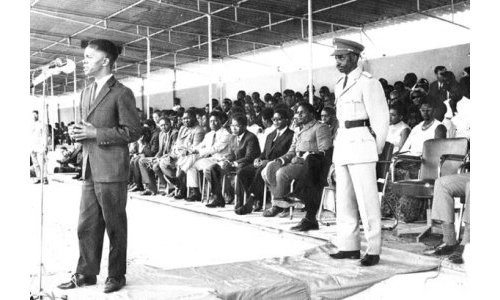


AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!