Comment décrire la douleur d’être né dans un monde qui vous rejette ? Comment expliquer le tourment de grandir dans un pays qui vous traite en étranger, alors que vos ancêtres y ont vécu des siècles durant ? Comment supporter cette certitude glaçante : qu’à tout moment, pour le seul crime d’exister, vous puissiez être battu, torturé, exilé ou assassiné ?
Pour les Tutsi du Rwanda, la souffrance n’a pas surgi brusquement : elle a été méthodique, enracinée, quotidienne. Elle s’inscrivait dans le tissu même de l’existence. L’État en avait fait une politique, la société en avait fait une norme. Leur persécution était légalisée, leur déshumanisation intériorisée. On les accablait de tous les torts, on les méprisait sans raison, et on les punissait pour ce qu’ils étaient.
Quelqu’un l’avait bien compris, lorsqu’il écrivit : « Être Tutsi demande un courage immense. »
C’était le titre d’un article publié dans Kiberinka, numéro 7, le 23 mars 1992 – un peu plus de deux ans avant le 7 avril 1994. Son auteur, Vincent Shabakaka, rédacteur en chef de cette revue, ne versait pas dans l’exagération. Car à l’époque où il couchait ces mots sur le papier, le génocide était déjà en cours à Bugesera, une région au sud de la capitale, Kigali.
Mais ses propos ne se limitait pas à Bugesera. Il parlait du Rwanda tout entier – d’un pays où, pendant des décennies, être Tutsi signifiait vivre sous le joug d’une persécution constante, d’une humiliation systématique, d’une souffrance jamais interrompue. Il dressait la liste, implacable, des violences et des injustices qu’un Tutsi pouvait endurer au Rwanda avant 1994. En voici quelques-unes, parmi tant d’autres :
- Être battu avec des ronces jusqu’à ce que la chair soit mise à vif.
- Être forcé de boire de la bouillie dans une chaussure souillée.
- Se faire transpercer les testicules avec des aiguilles, sous les rires des tortionnaires.
- Avoir une pierre attachée autour du cou, puis être précipité dans une rivière.
- Être roué de coups de bâton jusqu’à ce que les os se brisent.
- Voir son enfant égorgé, puis jeté dans une latrine comme un déchet.
- Regarder sa maison partir en flammes, et se voir interdire de lutter contre le feu.
- Souffrir de la faim, malgré les récoltes cultivées de ses propres mains.
- Être contraint de ramper comme un nourrisson devant des bourreaux moqueurs.
- Être déshabillé devant ses voisins, puis abandonné à une mort lente, dans l’humiliation la plus totale.
- Faire des cauchemars chaque nuit, pour se réveiller dans une réalité encore plus atroce.
- Vivre avec la certitude que son existence même constitue une offense.
Telle était la vie d’un Tutsi au Rwanda avant 1994. Et tel fut le chemin tracé vers le génocide.
Les propagandistes du génocide savaient manier les mots avec une précision meurtrière. Ils les choisissaient selon leur auditoire : pour attiser la haine chez les uns, on employait les termes les plus déshumanisants ; pour galvaniser les futurs bourreaux, on inventait un vocabulaire séducteur, habillé de fausse légitimité.
C’est dans cet esprit que Joseph Gitera, en septembre 1959, puis Hassan Ngeze, en décembre 1990, rédigèrent ce qu’ils appelèrent les « Dix Commandements du Hutu ».
Gitera, chrétien issu de la première paroisse catholique du Rwanda, et Ngeze, musulman, comprenaient parfaitement la puissance symbolique du mot « commandements » dans un pays profondément marqué par la tradition chrétienne. Ce choix n’avait rien d’innocent : il visait à sacraliser la haine, à la faire passer pour une obligation morale, presque divine.
Le Décalogue biblique !
Les commandements haineux de Joseph Gitera étaient précédés d’une déclaration glaçante : « La cohabitation entre Hutus et Tutsis est une plaie incurable, une sangsue dans le corps, un cancer de l’estomac ou une pneumonie. »
Gitera, fondateur de " l’APROSOMA " et futur président de l’Assemblée nationale, affirmait sans détour dans ses commandements :
« Le nom du Tutsi est haïssable », « Vivre en amitié avec un Tutsi, c’est porter un fardeau. ». Il allait jusqu’à préconiser que les Tutsi soient asservis, puis « bannis du Rwanda à jamais ! »
Ce discours n’avait rien de confidentiel : il fut prononcé publiquement, le 27 septembre 1959, à Ngoma, dans le sud du Rwanda. Ce jour-là, Gitera déversait sa haine devant une foule, avec la complicité tacite — voire le soutien manifeste — des autorités coloniales belges, qui administraient alors le Rwanda depuis plusieurs décennies.
Dès janvier 1962, le danger d’un génocide au Rwanda avait été clairement identifié. C’est à cette date que l’Organisation des Nations unies fut alertée par un rapport présenté par le professeur Majid Rahnema, universitaire et diplomate iranien. De retour d’une mission d’observation sur le terrain, il mettait en garde la communauté internationale : les signes avant-coureurs d’un génocide étaient déjà là.
Dans son rapport, Majid Rahnema affirmait que les « tensions sociales et politiques » au Rwanda étaient le symptôme d’une « situation explosive », susceptible de conduire à « l’extermination graduelle de la majorité de la population tutsie ».
Son avertissement fut tragiquement confirmé — d’abord par les massacres de Tutsi en 1963-1964, puis par le génocide de 1994, Car le génocide contre les Tutsi ne commence pas en avril 1994. Il prend racine des décennies plus tôt — dans les discours de haine, dans les lois discriminatoires, dans les massacres organisés et impunis, et dans le silence obstiné de la communauté internationale.
Il commence en 1959, à la Toussaint, lorsque les premières vagues de Tutsi sont traquées, leurs maisons incendiées, leurs familles brisées. Des milliers sont tués. D’autres, par milliers, prennent la fuite — enfants, femmes, vieillards — cherchant asile dans des terres étrangères, où ils vivront en exil pendant des générations.
Le processus se poursuit dans les années 1960 et 1970. Chaque nouveau régime s’emploie à maintenir les Tutsi en marge : indésirables, inacceptables, en insécurité permanente.
Ils sont exclus de l’enseignement supérieur, de la fonction publique, de l’armée, des opportunités économiques. Et lorsque la violence les frappe, l’État n’offre ni justice, ni secours, ni compassion.
Comme le décrivait Shabakaka, ils étaient des « morts vivants » – des êtres condamnés à errer sur cette terre, privés du droit à une existence digne. Mon ami Shabakaka ne survécut pas au génocide, et n’eût pas la chance de voir la véracité tragique de sa propre prophétie.
Dans les années 1990, la campagne de déshumanisation atteignit son paroxysme. Le magazine Kangura publia les infâmes « Dix Commandements du Bahutu », un manifeste de haine exhortant les Hutu à isoler, mépriser et, ultimement, anéantir les Tutsi. Le huitième commandement était sans équivoque : « N’ayez aucune pitié pour les Tutsi. »

Tom Ndahiro a souligné que se souvenir du génocide des Tutsi de 1994, c’est avant tout résister à l’indifférence, à la négation, à cet effacement cruel d’une douleur qui perdure encore aujourd’hui. En effet, il n’y eut en effet aucune pitié.
Les massacres des Bagogwe dans le nord-ouest du Rwanda en 1990-1991, les tueries de Bugesera en 1992, les assassinats à Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri — tous ces actes de violence furent des répétitions générales de ce qui allait suivre. Mais le monde a choisi de détourner le regard. Les tueurs comprirent qu’ils pouvaient agir en toute impunité. Ils découvrirent que la vie des Tutsi ne comptait tout simplement pas.
Puis vint le 6 avril 1994. L’assassinat du président Juvénal Habyarimana ne fut qu’un prétexte, une excuse. Le génocide avait été minutieusement préparé depuis bien longtemps. Les stations de radio incitaient à « les achever ». Les barrages surgissaient du jour au lendemain. On distribuait des machettes. Les voisins se retournaient les uns contre les autres. Des familles entières étaient anéanties. En l’espace de 100 jours, plus d’un million de Tutsi furent exterminés.
Et pourtant, aujourd’hui encore, certains osent nier ou justifier cette horreur, comme s’il ne s’agissait pas d’un génocide. Ils prétendent que ce fut un acte spontané, une réaction aveugle à la mort du président. Ils effacent ainsi l’histoire de la souffrance, les décennies d’avertissements ignorés, les cris des persécutés restés sans réponse.
Shabakaka écrivait sur la vie d’un Tutsi deux ans avant que le génocide ne parvienne à son point culminant. À cette époque, la souffrance était déjà devenue insupportable.
SE SOUVENIR, C’EST RÉSISTER
Plus de 31 ans se sont écoulés depuis 1994. Mais se souvenir ne se réduit pas à un simple acte historique – c’est un acte de résistance.
C’est une résistance contre l’indifférence, contre la négation, contre l’effacement cruel d’une douleur qui persiste encore aujourd’hui. Se souvenir, c’est rejeter l’idée que la souffrance puisse être réécrite, que les cris des victimes puissent être étouffés, que la justice puisse être oubliée.
Le génocide contre les Tutsi ne s’est pas arrêté en 1994. Ses cicatrices vivent dans les corps et les esprits des survivants. Il vit dans les os qui émergent encore des fosses, dans le silence lourd de ceux qui ont tout perdu, dans les yeux des mères qui ne tiendront plus jamais leurs enfants.
Le génocide vit dans les veuves qui se réveillent chaque matin dans des lits vides, dans les orphelins qui scrutent des photographies fanées à la recherche des visages disparus de leurs proches, dans les survivants, désormais trentenaires, qui ne savent même pas à quoi ressemblaient leurs parents, mais qui doivent pourtant continuer à vivre avec cette absence permanente.
Le génocide est une réalité vivante pour eux. Se souvenir, c’est porter la douleur de cette absence, et le poids d’une mémoire qui ne peut s’effacer.
Pour les survivants, se souvenir n’est pas un choix : c’est un fardeau inébranlable, une présence omniprésente dans leur existence. Chaque jour est marqué par des rappels poignants — l’absence d’une mère qui ne sera plus là, la chaise vide où un père s’assoyait autrefois, le silence là où devraient résonner des rires. Un mariage sans les parents. Un anniversaire qui ne porte plus le goût de la fête. Un nom que l’on chuchote, dans des murmures de souvenir, comme s’il appartenait à un autre temps.
Comment continuer à vivre lorsque toute sa famille a été decimée ? Lorsque la maison devient un cimetière, le village une ruine, l’enfance effacée dans un torrent de sang et de cris ? Les images ne s’effacent jamais — les yeux implorants d’un enfant avant que la machette ne s’abatte, les mains tremblantes d’une mère qui protège son bébé, alors qu’elle est traînée pour être exécutée.
Imaginez une mère, le corps meurtri par les coups, tenant son bébé dans ses bras, fuyant des hommes armés de machettes et de grenades. Elle n’a nulle part où se cacher. Elle court vers une église, ce lieu sacré où elle a été baptisée, cet endroit où elle a cru toute sa vie. Mais les portes sont closes. À l’intérieur, des prêtres et des religieuses refusent de les laisser entrer. Les tueurs arrivent, ricanants, ivres de pouvoir. Ils lui ordonnent de poser son enfant, de s’allonger. Elle sait ce qui l’attend. Elle supplie qu’on épargne son bébé. Mais ils ne l’écoutent pas.
Imaginez une jeune fille forcée de se déshabiller devant une foule d’hommes, son père battu et impuissant à ses côtés. Ils lacèrent sa peau avec des couteaux. Ils lui crachent dessus. Ils la dépouillent de sa dignité avant de lui ôter la vie. Son père, autrefois fort, est maintenant brisé. Il est contraint de regarder, impuissant, avant de mourir lui aussi.
Imaginez un enfant caché sous un tas de corps, l’odeur du sang pesant lourdement dans l’air, le poids des morts écrasant sa poitrine. Il ne peut pas pleurer. S’il pleure, ils l’entendront et n’auront aucune pitié. Il regarde à travers les interstices, observant sa mère se faire massacrer, sa sœur être emmenée. Il ne comprend pas pourquoi tout cela arrive. Il sait seulement qu’il ne doit pas bouger, ne pas respirer trop fort, ne pas exister.
Imaginez ce jeune homme qui a survécu, qui a échappé aux machettes, qui a trouvé un moyen de rester en vie. Mais il porte les cicatrices dans son corps, les cauchemars dans son esprit. Il voit le visage de sa mère dans ses rêves, entend les cris de ses voisins dès qu’il ferme les yeux. Il ne peut pas oublier. Il marche dans les rues du monde, se demandant comment les gens peuvent continuer comme si de rien n’était.
Et aujourd’hui, le monde continue.
Les corps ont été enterrés. Les os ont été placés dans des mémoriaux. Mais la haine qui a alimenté le génocide n’est pas morte. Elle vit dans les murmures, dans la propagande distillée sur les radios internationales et sur Internet, notamment sur YouTube et autres plateformes de médias sociaux. Elle vit dans la politique — ici, dans notre région, et au-delà. Elle vit en ceux qui nient l’existence du génocide, qui prétendent qu’il s’agissait de quelque chose d’autre, qui justifient encore aujourd’hui le meurtre des Tutsi.
Se souvenir n’est pas seulement un acte historique — c’est un acte de défi. C’est refuser que l’indifférence étouffe la vérité. C’est rejeter le silence qui a permis au génocide contre les Tutsi de se produire, et qui tolère aujourd’hui encore la persécution des Tutsi en République Démocratique du Congo.
Le génocide continue de vivre en République Démocratique du Congo, où les Tutsi et les Hema sont toujours pourchassés. Il se manifeste dans les milices qui les massacrent, dans les discours haineux qui appellent à leur extermination, dans le silence complice de ceux qui choisissent de détourner les yeux. Il vit dans les réfugiés, qui fuient d’un massacre à un autre, génération après génération, sans jamais connaître la paix.
Les Tutsi en RDC ne sont pas des fantômes du passé ; ce sont des êtres vivants, en chair et en os. Ce sont des enfants qui se réveillent au son des fusillades, des mères qui se demandent si leurs fils rentreront vivants, des pères qui savent que leur seule appartenance ethnique peut faire d’eux des cibles. Et pourtant, ils sont abandonnés. Leurs cris se heurtent à l’indifférence. Leur souffrance est ignorée.
Aujourd’hui encore, lorsque des Tutsi sont tués en RDC, le monde détourne le regard — comme il l’a fait avant 1994. Quand des extrémistes appellent à leur massacre, quand des enfants sont traqués en raison de leur ethnie, quand l’histoire se répète, le silence est assourdissant. La même indifférence qui a permis la mort d’un million de personnes au Rwanda permet aujourd’hui que d’autres, portant cette même identité, soient persécutés dans un pays voisin.
Se souvenir, c’est refuser ce silence.
Se souvenir, c’est s’opposer aux forces qui, encore aujourd’hui, cherchent à effacer la souffrance des Tutsi, à tordre l’histoire, à excuser l’inexcusable. C’est résister à l’engourdissement dans lequel le monde se plonge souvent face aux vérités dérangeantes.
Se souvenir, c’est exiger la justice — non seulement pour le passé, mais aussi pour le présent. C’est se dresser contre la haine persistante, dénoncer les mensonges de ceux qui nient le génocide, exiger des comptes de ceux qui, aujourd’hui encore, propagent l’idéologie empoisonnée qui a conduit aux massacres.
SE SOUVENIR, C’EST DIRE “PLUS JAMAIS ÇA” — ET LE PENSER VRAIMENT.
Pas seulement pour le Rwanda, mais pour chaque endroit où la menace génocidaire persiste. Pas seulement pour ceux qui ont été perdus, mais pour ceux qui, aujourd’hui encore, vivent sous l’ombre de cette même haine.
Nous nous souvenons des mères qui ont supplié pour la vie de leurs enfants.
Nous nous souvenons des enfants morts sans comprendre pourquoi.
Nous nous souvenons des hommes torturés, humiliés, avant d’être assassinés.
Nous nous souvenons des familles anéanties, des lignées effacées.
Nous nous souvenons de ceux qui ont survécu, mais ont tout perdu.
Nous nous souvenons de ceux qui attendent encore la justice.
Se souvenir, c’est refuser de les laisser mourir une seconde fois — la mort de l’oubli.
Nous ne pouvons pas effacer ce qui s’est passé. Nous ne pouvons pas ramener ceux qui ont été tués. Mais nous pouvons leur rendre hommage. Nous pouvons défendre la vérité. Nous pouvons nous battre pour ceux qui souffrent encore aujourd’hui. Nous pouvons être les voix que le monde a ignorées en 1994.
Le silence était complice du génocide à l’époque. Il ne doit plus jamais l’être.
Ce qui est le plus terrible, c’est de savoir que le monde a vu ce qui se passait et a détourné les yeux. Les gouvernements, détenteurs du pouvoir d’intervenir, se sont perdues dans des débats bureaucratiques pendant que des cadavres s’amoncelaient dans les rues. La communauté internationale, qui avait promis « plus jamais ça » après la Shoah, a abandonné le Rwanda à son sort. En 1994, le monde a détourné le regard, comme il détourne encore aujourd’hui son regard alors qu’un peuple, dans l’est de la RDC, fait face à la même haine, aux mêmes appels au meurtre, au même silence.

L’INDIFFÉRENCE EST UNE COMPLICITÉ
Justifier ou nier un génocide, c’est le commettre à nouveau dans la mémoire. Chaque fois qu’une journaliste comme la Canadienne Judi Rever ou un universitaire comme Alan Kuperman balaie le génocide contre les Tutsi d’un revers de main, le qualifiant de « conflit », ou affirmant qu’il fut la conséquence d’une guerre provoquée par un groupe rebelle tutsi, ils brandissent une autre forme de machette — une machette qui ne fait pas couler le sang, mais qui anéantit la vérité.
Chaque fois qu’un journaliste ou un politicien donne de la voix à ceux qui réécrivent l’histoire, chaque fois qu’un gouvernement offre asile aux génocidaires au lieu de rendre justice, chaque fois qu’une plateforme de médias sociaux laisse la haine proliférer sans retenue, le génocide perdure sous une forme insidieuse.
Se souvenir ne suffit pas. La simple réflexion ne protégera pas la prochaine génération des machettes et des balles. Les paroles de compassion ne mettront pas fin à la violence qui menace de refaire surface. L’histoire ne doit pas seulement être commémorée, elle doit être affrontée, confrontée et défendue.
La justice ne peut être sélective. Le monde ne peut prétendre lutter contre le génocide tout en fermant les yeux sur ceux qui l’ont commis, sur les génocidaires qui circulent librement, sur les États qui les abritent et les soutiennent, sur les dirigeants qui utilisent le même langage de haine qui a nourri les charniers de 1994. Ceux qui financent, défendent ou justifient l’idéologie génocidaire doivent être exposés et tenus responsables. Tant que l’impunité perdure, il ne peut y avoir de véritable « Plus jamais ça ».
L’éducation est l’arme la plus puissante contre la haine. Les mensonges des négationnistes prospèrent là où l’ignorance règne. Chaque école doit enseigner le génocide contre les Tutsi — non pas comme une tragédie distante, mais comme un avertissement urgent, une leçon sur ce qui se produit lorsque la haine prend le pouvoir, quand la violence est légitimée par l’idéologie. Chaque jeune doit apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs du discours génocidaire, à comprendre les dangers de la déshumanisation et à mesurer le prix du silence.
Le génocide contre les Tutsi ne s’est pas produit du jour au lendemain — il a été façonné par des décennies de propagande, d’exclusion et de violence institutionnalisée. Les mêmes forces sont à l’œuvre aujourd’hui en République Démocratique du Congo. Les signaux d’alerte sont clairs. Les mêmes insultes, la même diabolisation, les mêmes manipulations politiques. Le monde n’a plus aucune excuse.
Les échos de 1994 sont aujourd’hui incontestables, là où le langage de haine est de nouveau diffusé. Les appels à traquer et à tuer les Tutsi ne se contentent plus de murmurer dans l’ombre ; ils résonnent désormais dans les rues, sont proclamés dans des discours politiques et se propagent à une vitesse alarmante sur les réseaux sociaux. Une fois encore, on dit aux Tutsi qu’ils n’ont pas leur place, qu’ils doivent être effacés.
UNE FOIS DE PLUS, LE MONDE SE TAIT.
Il y a des tombes où personne ne vient pleurer. Il y a des noms qui n’ont jamais été inscrits dans les registres de l’histoire. Il y a des enfants dont les visages ne vivent plus que dans la mémoire de ceux qui les ont aimés, mais qui ne doivent pas être oubliés. Leur silence ne doit pas être leur dernier héritage.
À ceux qui ont péri, nous devons nos voix.
À ceux qui ont survécu, nous devons la justice.
À ceux qui subissent la persécution aujourd’hui, nous devons notre action.
Pour les Tutsi morts, pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui souffrent encore — le monde doit enfin entendre. Le silence a été complice du génocide. Il ne doit plus jamais l’être.
SE SOUVENIR, C’EST REFUSER QUE L’HISTOIRE SE RÉPÈTE.
SE SOUVENIR, C’EST RÉSISTER.
RÉSISTER, C’EST AGIR.
ET L’ACTION DOIT REMPLACER L’IMPUNITÉ ET LA COMPLAISANCE.
Allocution prononcée par Tom Ndahiro à l’occasion de Kwibuka31, le 7 avril 2025, à Brasília (Brésil).

















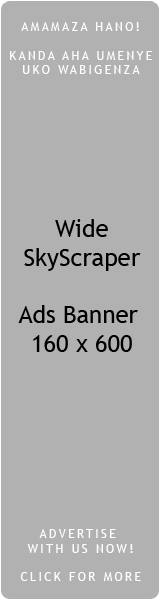
AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!