Dans une vidéo d’une rare franchise, Mme Josée Rashidy a osé formuler publiquement les interrogations que beaucoup murmurent tout bas, sans jamais trouver le courage de les énoncer à voix haute. Elle confesse, avec une inquiétude à peine voilée, redouter l’avenir du cercle présidentiel une fois que Tshisekedi aura quitté les ors du Palais de la Nation.
Elle dit craindre dans les replis de la rumeur populaire, s’insinuer la formule anxiogène du « pouvoir des Baluba », expression qu’elle cite avec prudence, comme pour mieux souligner l’enfermement tribal qui obscurcit l’horizon politique du pays.
Elle admet, avec une sobriété qui force l’attention, que « les choses ne vont pas bien ». Son diagnostic, pourtant formulé avec gravité, est d’une sévérité redoutable : plus d’une dizaine de généraux ont été arrêtés, parfois de manière spectaculaire, parfois dans une opacité totale.
Elle prévient que cette dynamique répressive, si elle n’est pas encadrée par une stratégie d’ensemble, constitue un péril majeur pour la stabilité même du chef de l’État. La purge tous azimuts, loin de renforcer l’autorité présidentielle, pourrait bien en fragiliser les fondements, car aucun pouvoir ne saurait durablement prospérer en se coupant simultanément de son appareil sécuritaire, de ses partenaires diplomatiques et de ses soutiens politiques internes.
Dans son discours lucide, Mme Rashidy pose en réalité la question centrale : elle s’interroge, avec une gravité non feinte, sur la manière dont on en est venu à assister à une telle déliquescence du lien de confiance entre le pouvoir civil et les forces armées, alors même que la Présidence concentre entre ses mains l’ensemble des leviers politiques, financiers et sécuritaires de l’État.
Cette rupture, loin d’être un épiphénomène, traduit un dysfonctionnement profond et systémique : un exécutif qui, au lieu d’asseoir son autorité par la cohérence stratégique, la prévisibilité décisionnelle et la loyauté institutionnelle, s’est progressivement isolé dans une gouvernance faite d’arbitraire, de soupçon et d’improvisation.
Ainsi se trouve minée la relation organique qui devrait unir le commandement politique au haut commandement militaire ; une relation qui, privée de confiance réciproque, se délite inexorablement dans une atmosphère saturée de méfiance, de rivalités internes et d’injonctions contradictoires, révélant l’effritement silencieux d’un régime qui détient pourtant, en théorie, tous les attributs de sa propre puissance.
Elle laisse planer l’idée qu’un vice structurel, « le ver dans le fruit », corrode les mécanismes décisionnels au sommet.
Car ce naufrage progressif n’est pas le produit du hasard mais celui, plus inquiétant encore, d’un cumul de dérives structurelles.
D’abord, l’absence criante de réflexion stratégique : le pouvoir, englué dans l’immédiateté, réagit au lieu d’anticiper, administre au lieu de gouverner, s’abandonne à la gesticulation plutôt qu’à la planification. L’on navigue à vue, sans doctrine sécuritaire claire, sans vision géopolitique assumée, sans grille de lecture cohérente des alliances internes et externes.
À cette défaillance intellectuelle s’ajoute l’enfermement dans un tribalisme revendiqué ou insinué, où l’affiliation clanique prime sur la compétence, la loyauté personnelle supplante l’expertise, et où le cercle rapproché se constitue non sur la qualité des conseillers mais sur l’appartenance à une matrice identitaire étroitement définie.
Ce rétrécissement du champ décisionnel produit mécaniquement une perte de finesse dans l’analyse, une incapacité à entendre les avertissements, et une marginalisation de toutes les voix discordantes.
S’y ajoute encore une paranoïa diffuse, devenue mode de gouvernement : suspicion généralisée, surveillance mutuelle, défiance envers les cadres de l’appareil sécuritaire, purges successives dans les forces armées, ruptures intempestives avec d’anciens alliés. Cette paranoïa, loin de protéger le pouvoir, l’isole, l’aveugle et le prive de relais essentiels.
Enfin, un amateurisme tenace dans la conduite des affaires de l’État achève d’épuiser des partenaires internationaux et régionaux déjà las de composer avec un pouvoir versatile, prompt aux revirements, adepte des alliances conjoncturelles et coutumier des engagements qui se délitent aussi vite qu’ils sont signés.
Dans cette atmosphère où compromissions, volte-face et trahisons se succèdent, il n’est guère surprenant que nombre de partenaires politiques, sécuritaires, diplomatiques se détournent progressivement du régime.
Mme Rashidy, en exposant publiquement ces interrogations, s’expose elle-même. Elle sait que sa parole dérange, qu’elle contrarie les réflexes défensifs d’un entourage présidentiel souvent imperméable à la critique.
Peut-être ne sera-t-elle pas entendue. Mais elle aura eu le mérite, rare en ces temps de verrouillage, de l’avoir dit ouvertement, sans travestir la gravité de la situation, en rappelant que l’on ne gouverne pas impunément un pays fracturé en se recroquevillant dans le clanisme, la méfiance et l’improvisation permanente.
Le piège, désormais refermé en haute mer, est clair : un pouvoir qui a perdu la confiance de ses généraux, l’estime de ses partenaires, l’adhésion de ses élites et l’écoute de ses propres communicants se retrouve irrémédiablement exposé à sa propre fragilité.
Mme Rashidy l’a compris. Reste à savoir si ceux qui entourent le Président Tshisekedi en auront, eux aussi, le courage.















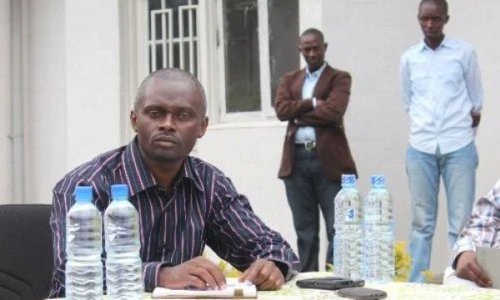
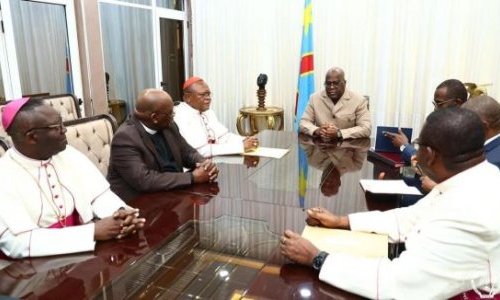


AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!