Alors que les envoyés de paix font la navette entre Kigali et Kinshasa, une absurdité fondamentale persiste : tout le monde parle de paix, mais personne ne tient le gouvernement congolais pour responsable de sa propagande belliciste, de sa répression intérieure et de son nationalisme ethnique toxique.
Commençons par une petite parabole. Imaginez quelqu’un qui accuse son voisin d’avoir incendié sa maison, et qui, debout au milieu des cendres, utilise cette accusation comme slogan de campagne.
Mais voici le hic : c’était lui l’incendiaire. Ce n’est pas une métaphore. C’est la politique congolaise sous le président Félix Tshisekedi.
Le 18 avril 2025, le média français France 24 a publié un article intitulé : « Washington exhorte le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer ses troupes de RDC ».
Cette déclaration de l’envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Massad Boulos, exhortant le Rwanda à « cesser tout soutien au M23 et à retirer les troupes des RDF », peut donner l’impression d’un progrès diplomatique.
En réalité, elle illustre une fois de plus la tendance de la communauté internationale à considérer Tshisekedi comme un partenaire crédible pour la paix, alors qu’il n’en est rien.
Cela intervient à peine une semaine après que Boulos, alors qu’il se trouvait sur le sol rwandais, avait esquivé les questions sur ce même sujet en déclarant : « Nous ne sommes pas impliqués dans ces détails. » À présent, cependant, les États-Unis n’étaient plus seulement impliqués, ils se présentaient soudain comme une boussole morale. Pour de bonnes raisons, certes.
On peut se demander : la diplomatie américaine est-elle guidée par une amnésie tournante ? La géopolitique dans la région des Grands Lacs est-elle réduite à une diplomatie de ping-pong ?
Y a-t-il eu une quelconque tentative de comprendre les causes profondes ou les dynamiques de pouvoir dans la région ? Nulle mention des génocidaires qui continuent de hanter l’est du Congo sous la bannière des FDLR.
Pourtant, cet appel passe sous silence la complexité des dynamiques régionales, les griefs historiques, et surtout la duplicité d’une direction congolaise qui a maîtrisé l’art du ventriloquisme politique.
De la survie “ethnique” à l’expression politique
Aucune mention non plus du fait que le M23, que Boulos souhaitait voir désarmé, protégeait en réalité les civils tutsis congolais contre des décennies de violences ciblées.
Le point de départ consiste à comprendre en profondeur la trame des troubles dans l’Est du Congo. Revenons en arrière.
L’instabilité dans l’est de la RDC et les menaces contre les Rwandophones congolais, en particulier les Tutsis, remontent aux années 1960. Bien avant l’arrivée des RDF ou du président Kagame.
Des télégrammes diplomatiques américains datant de 1963 à 1965 faisaient déjà état de violences systématiques contre les Tutsis congolais.
Donc non, le M23 n’a pas inventé cette crise. Ils ne sont que la conséquence d’un État qui a normalisé l’exclusion et l’extermination de ses propres citoyens.
Puis vint 1994. Les génocidaires qui avaient orchestré le génocide contre les Tutsi au Rwanda se sont réfugiés dans l’est du Congo.
Les régimes congolais successifs, y compris ceux de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, n’ont jamais fait d’efforts sérieux pour les neutraliser.
Au contraire, ils les ont armés, instrumentalisés politiquement, intégrés dans l’armée congolaise, et parfois même utilisés contre les civils tutsis congolais dans le cadre de milices dites de « défense locale ».
Mais voici ce qui rend la situation grotesque : les acteurs occidentaux s’indignent davantage du « prétendu » soutien du Rwanda au M23 que du soutien, lui bien documenté, historique et continu de Kinshasa aux FDLR et à leurs groupes dissidents, dont l’idéologie est ouvertement génocidaire.
N’est-ce pas là une forme de manipulation géopolitique digne d’un gaslighting ?
Le M23 est né comme un mouvement de résistance visant à protéger les communautés tutsies contre l’extermination et l’expulsion.
Avec le temps, cependant, ses rangs se sont élargis pour inclure des Congolais de divers horizons, désabusés par la gouvernance catastrophique de Kinshasa, le favoritisme tribal et l’exploitation brutale des groupes ethniques non Luba dans les régions du Kivu.
Aujourd’hui, l’AFC/M23 n’est plus seulement une insurrection tutsie. C’est une bannière sous laquelle se regroupent la contestation politique, la résistance aux abus de l’État et les appels à un véritable fédéralisme.
Même des individus issus du propre groupe ethnique du président Tshisekedi, les Baluba, ont rejoint le mouvement. Il est donc devenu un enjeu national – et non une conspiration rwandaise.
Et pourtant, au lieu d’engager un dialogue sincère, Kinshasa s’en prend à son propre reflet.
Une messagère sourde à la guerre
Le 2 mai 2025, la Première ministre congolaise Judith Suminwa est arrivée à l’aéroport de Ndjili, à Kinshasa, pour accueillir des soldats congolais qui étaient aux mains du M23 depuis janvier.
Ces soldats avaient été capturés puis traités avec dignité. Plutôt que de reconnaître ce geste humain du M23, Judith Suminwa a préféré adopter une rhétorique guerrière.
Elle n’a rien dit sur la réconciliation. À la place, elle a délivré un message glaçant de son supérieur, le président Tshisekedi : « La lutte continue contre l’ennemi et l’occupant. La bataille pour la libération totale du territoire est en cours. »
Une telle surdité politique prêterait à rire si elle n’était pas aussi dangereuse.
Dans n’importe quel autre contexte, une telle déclaration de la part d’une Première ministre serait interprétée comme un rejet formel de toute initiative de paix. Pourtant, la communauté internationale ne dit rien.
Parce que, apparemment, Suminwa est polie, instruite et francophone. Peu importe qu’elle parle couramment le langage du conflit.
La Première ministre a été secondée par le porte-parole militaire de l’agression.
Le 4 mai 2025, le colonel congolais Mak Hazukay, porte-parole de l’armée dans l’extrême nord, a intensifié la rhétorique belliqueuse.
« Nous nous réservons le droit de riposter sur tous les fronts si la menace des rebelles et de leurs alliés rwandais persiste. »
J’ai oublié de préciser qu’il a qualifié l’AFC/M23 de « terroristes », un terme que ses supérieurs évitaient jusque-là.
Il convient de noter que Hazukay représente la même armée qui a intégré des génocidaires dans ses rangs, la même armée qui a subi de multiples humiliations face au M23, et la même armée qui collabore régulièrement avec les FDLR sur le terrain.
L’entendre parler de « riposte » revient à voir un pyromane protester contre la chaleur.
Comme le souligne la spécialiste en discours politique Jennifer Mercieca : « Les acteurs de mauvaise foi utilisent les tactiques du démagogue : distorsion, diversion et division. »
Hazukay coche toutes les cases.
Et ce, avant même d’entrer dans un véritable cours magistral de mauvaise foi politique — ce qui nous amène à l’homme du moment : Félix Tshisekedi.
On pourrait écrire des volumes sur sa malhonnêteté politique, son double langage et sa volonté de sacrifier la paix régionale au profit d’un populisme à court terme. Mais concentrons-nous sur quelques points essentiels.
Tshisekedi est arrivé au pouvoir non pas par une révolution populaire ou une transition démocratique, mais grâce à un pacte secret avec son prédécesseur, Joseph Kabila.
Il doit sa présidence à un arrangement de coulisses — et non aux urnes. Et il a gouverné en conséquence : sans légitimité, sans feuille de route, et sans responsabilité.
Pour masquer cette fragilité, il s’en prend systématiquement au Rwanda. Comme l’explique la professeure Ruth Wodak, analyste du discours reconnue, « Les leaders populistes ont souvent recours à la politique du bouc émissaire pour unifier une base intérieure fragmentée. »
Maîtrisant parfaitement cette méthode, Tshisekedi a tellement fait du Rwanda son bouc émissaire que cela en est devenu le seul pilier de sa stratégie de sécurité nationale.
Mais voici la véritable motivation : il n’a aucun intérêt pour la paix. Car la guerre lui permet de gouverner sans résultats tout en accumulant des milliards de dollars.
Il peut suspendre les élections dans l’est du Congo. Il peut attribuer chaque échec national à des ingérences étrangères. Il peut se présenter en président en temps de guerre. Ce n’est pas un dysfonctionnement. C’est le principe même du système.
Interventions diplomatiques aux angles morts
Soyons clairs : les récents efforts diplomatiques des États-Unis et du Qatar — en particulier le cadre de Doha — méritent d’être salués. Pour la première fois, des puissances régionales et mondiales s’assoient à la même table pour discuter de solutions durables.
Mais soyons d’une honnêteté implacable : Washington et Doha sont des capitales politiquement bien trop proches de Kinshasa, et géographiquement (et mentalement) bien trop éloignées de Goma et Bukavu.
Tout cadre qui traite le M23 comme le problème, tout en ignorant les génocidaires des FDLR, les kleptocrates de Kinshasa et le système d’exclusion ethnique visant les Rwandophones, est voué à l’échec. On ne construit pas la paix sur des fantasmes.
Il existe un appétit illimité pour les minerais — créant ainsi un trou noir moral. N’ignorons pas l’éléphant dans la pièce : la malédiction des ressources.
Les puissances mondiales ne se soucient pas réellement du peuple congolais. Elles se soucient du cobalt. Elles veulent de l’or, du coltan et du tantale.
Elles veulent un accès bon marché aux minerais stratégiques pour leurs smartphones, véhicules électriques et économies vertes. La stabilité et la sécurité humaine, pour elles, ne sont qu’une note de bas de page — sauf si cela touche à l’exploitation minière.
Cela explique pourquoi tant de capitales occidentales émettent des menaces et des sanctions contre le Rwanda tout en ignorant la complicité du régime congolais dans l’hébergement des génocidaires. Ces derniers sont devenus des pillards et des prédateurs de leur propre peuple.
Apparemment, la stabilité des vies humaines est négociable. Mais le lithium, lui, est sacré.
Revenons à la question de négocier avec un acteur de mauvaise foi : une mission de bouc émissaire.
Dans son livre "Talking to the Enemy", le spécialiste en communication politique Michael L. Butterworth avertit :
« Négocier avec des acteurs de mauvaise foi qui opèrent en dehors des faits partagés n’est pas de la diplomatie — c’est de l’apaisement en slow motion. »
Tshisekedi n’est pas seulement un mauvais négociateur. C’est un acteur malhonnête. Il utilise les négociations pour gagner du temps, se réarmer, et mener une diplomatie sans substance.
Les processus de Luanda et de Nairobi n’ont pas été sapés par le Rwanda ou le M23, mais par le refus de Kinshasa de négocier, ses provocations militaires, et son refus de désarmer les FDLR.
Tshisekedi parle de « souveraineté » tout en invitant des mercenaires, des troupes étrangères et des génocidaires sur son sol.
Attendre la paix sous sa direction, c’est attendre de la pluie d’une pierre. C’est un théâtre politique du bizarre.
N’ayons pas peur des mots. Tshisekedi, Suminwa et Hazukay ne sont pas des gardiens de la paix. Ce sont des conservateurs du chaos.
Ils parlent de libération tout en collaborant avec des terroristes. Ils parlent de souveraineté tout en déléguant la gouvernance à des forces étrangères.
Ils condamnent les « occupants » tout en étant squattés par leurs propres mensonges.
Leur drame diplomatique n’a ni entracte, ni apogée, ni certitude.
Négocier avec le président Tshisekedi revient à jouer aux échecs avec un adversaire qui change les règles à chaque coup.
La rhétorique de son administration oscille entre des appels à la souveraineté et un soutien manifeste aux milices comme les FDLR, un groupe ayant des racines dans les auteurs du génocide contre les Tutsi de 1994 au Rwanda.
La spécialiste en discours politique, Dr Sarah Nouwen, souligne : « S’engager dans des négociations nécessite un minimum de respect mutuel et un engagement commun envers la vérité. Sans cela, les négociations deviennent performatives plutôt que transformantes. »
Dans le cas de la RDC, l’aspect performatif est flagrant, les pourparlers de paix servant davantage d’exercices de relations publiques que d’efforts sincères pour résoudre le conflit.
L’hypocrisie et la mort de la raison
Le plus révoltant dans tout cela est la facilité avec laquelle les puissances occidentales se laissent manipuler de manière aussi visible.
Washington exige que le M23 se désarme et se retire. Pourquoi ? Mais où ? Et sous quelles garanties ?
Qui protégera les Tutsis congolais de l’extermination par les FDLR ? Qui sécurisera les zones frontalières ?
Qui empêchera la remilitarisation des groupes génocidaires ?
Aucune réponse. Que des slogans.
Ce ne sont que des déclarations médiatiques creuses de responsables qui croient que trente ans de sang, de trahison et de promesses brisées peuvent être résolus par une conférence de presse.
Dans How Democracies Die, Steven Levitsky et Daniel Ziblatt soutiennent que « lorsque les institutions récompensent la mauvaise foi, l’ensemble du système se détériore. »
Si leur analyse est juste, alors la région des Grands Lacs ne se contente pas de se détériorer — elle est sabotée par ceux qui devraient savoir mieux.
L’engagement de la communauté internationale avec la RDC oscille souvent entre un zèle interventionniste et une apathie négligente.
Bien que les appels à ce que le Rwanda cesse de soutenir le M23 soient valides, pour des raisons de convenance, ils doivent être accompagnés d’un examen critique du rôle du gouvernement congolais dans le maintien de l’instabilité.
Dans l’arène de la politique congolaise, le président Tshisekedi joue plusieurs rôles, chacun adapté à son public — qu’il s’agisse de diplomates internationaux, de ses électeurs nationaux ou de ses alliés régionaux.
Pourtant, sous les costumes et les répliques scriptées se cache un thème constant : la priorité donnée au pouvoir et à la corruption plutôt qu’à la paix.
Engager des négociations avec un tel dirigeant nécessite plus que des avances diplomatiques ; cela exige une évaluation critique des intentions, des actions et du contexte plus large.
Comme le souligne la spécialiste du discours politique, Dr. Chantal Mouffe, « La politique démocratique ne consiste pas à parvenir à un consensus, mais à confronter et négocier les différences. »
Dans le cas de la RDC, cela signifie reconnaître les aspects performatifs de son leadership et rechercher de véritables voies de responsabilisation et de réforme.
D’ici là, les pourparlers de paix resteront une pantomime, les négociations une farce, et le peuple congolais le spectateur involontaire d’une tragicomédie sans fin.
Si cela était une pièce de théâtre, ce serait considéré comme un clownisme sombre. Tshisekedi, la star involontaire, délivre ses répliques avec un sérieux théâtral, Suminwa joue le rôle d’un chœur de cris de guerre, et Hazukay apporte le soulagement comique — si l’on trouve le déni du génocide drôle.
Mais ce n’est pas du théâtre. C’est réel.
Des gens réels meurent. Des communautés réelles sont déracinées. Des génocidaires réels errent toujours en toute liberté.
Alors appelons cela pour ce que c’est : une farce diplomatique.
Le monde doit cesser d’indulgérer le régime de Tshisekedi en tant que partenaire de paix légitime. Il ne l’est pas. C’est l’épicentre du problème.
Et tant que cette vérité ne sera pas acceptée, aucune résolution, aucune initiative, aucun envoyé — qu’ils viennent de Doha ou de Washington — ne pourra jamais apporter la paix.
On ne peut pas négocier avec la mauvaise foi. On ne peut que l’exposer.
Et en rire amèrement face à toute cette tragédie.









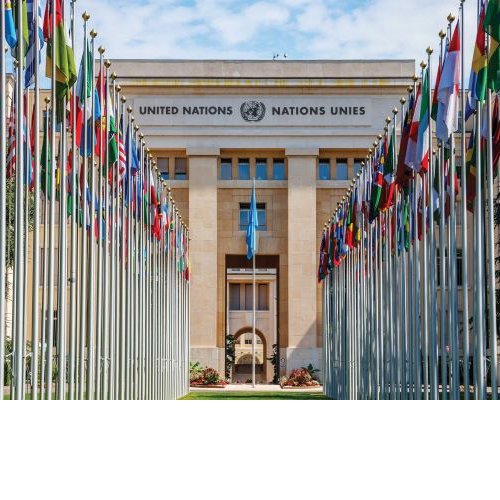









AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!