La franco rwandaise Annick Kayitesi Jozan, rescapée du génocide des Tutsi du Rwanda de 1994, a des blessures morales qui ne se referment pas. Le génocide des Tutsi perpétré par les voisins hutu sur toutes les collines du Rwanda.
Elle repensent à sa mère écrabouillée par des gourdins des Interahamwe. Qu’elle le veuille ou non, cette scène macabre la poursuit tyoujours. Elle ne le quitte pas. Elle est devenue son autre moi. Elle le raconte dans un livre qu’elle vient de publier La Danse des Fantômes .
En apparence, tout est normal : une jeune femme est assise dans un café parisien. Elle est jolie, enjouée, plutôt élégante. Rien ne la distingue vraiment des clients des tables voisines. Il y a pourtant ce jour-là des fantômes qui s’invitent eux aussi autour des tasses de café. Leurs ombres s’alourdissent alors que les souvenirs remontent. Une fois de plus.
« Quand je parle du meurtre de ma mère, les gens peuvent essayer d’imaginer ce qui s’est passé. Mais moi, je revois vraiment la scène. Et je serai toujours seule avec ses images-là », constate Annick Kayitesi-Jozan. Souvent, elle fait « semblant d’être dans la vie normale ».
Elle explique : « Je me lève, je prends mon petit déj, mais je ne suis pas tout à fait là. Une partie en moi s’y refuse. Il y aura toujours cette césure. Moi ici, et moi ailleurs. » « Ailleurs », c’est le royaume maudit d’un « passé qui ne passe pas » selon la formule consacrée : le génocide des Tutsis du Rwanda, qui a fait plus d’un million de morts en 1994. Annick Kayitesi-Jozan en a réchappé, avec cette marque indélébile gravée dans sa mémoire. Aujourd’hui, elle a 38 ans, « mais en avril, j’ai toujours 14 ans », écrit-elle dans le récit qu’elle publie cet automne.
Elle raconte, parfois avec malice, des moments légers, comme la rencontre avec son futur mari, Raphaël, un Français. Mais revient, fatalement, sur ce ténébreux mois d’avril 1994, lorsque l’horloge de la vie s’est soudain arrêtée. « Le 30 avril était un samedi, il faisait très beau. Le ciel de cette journée est gravé dans ma mémoire parce que son bleu immaculé jurait avec le regard noir, haineux, des miliciens qui nous extirpaient de notre cachette », écrit-elle.
La suite va la hanter pour toujours : elle assiste au meurtre de sa mère. « Ecrabouillée » à coups de gourdins. Puis elle voit partir dans un camion son petit frère Aimé, 9 ans, sa sœur Aline, 16 ans, ses deux cousines, âgées de 14 ans et 23 ans. On les conduira sur le site d’une fosse commune où ils seront « coupés » à la machette.
Seule Aline, laissée pour morte au milieu des cadavres, survivra. Pourquoi les miliciens n’ont-ils pas pris Annick ? Peut-être parce que les voisins, Alfred et Nicole, qui avaient toujours été si sympas avant de devenir complices des tueurs, ont alors décidé d’en faire leur « petite bonne ». Lui assignant immédiatement une première tâche « ménagère » : nettoyer, avec une éponge, le sang de sa mère assassinée.
Un jour, Nicole, de retour du marché se réjouit : elle y a vu, dit-elle, le corps de la mère d’Annick « dévorée par les chiens ».
A ce stade, les lecteurs auront probablement envie de détourner le regard : faut-il vraiment s’alourdir l’âme avec tant d’horreurs ? Il n’est pourtant jamais inutile de se confronter aux failles de ce si fragile vernis d’humanité qui cache parfois le pire. Exfiltrée en France dans des familles d’accueil, comme beaucoup, Annick s’y découvre « noire »,réduite trop souvent à cette étiquette.
« C’est intéressant d’être noir, tout le monde devrait en faire l’expérience un jour », s’exclame-t-elle avec une fausse ironie qui recouvre pudiquement les multiples petites humiliations subies dans son pays d’adoption. Surtout, elle sait où peut mener le racisme ordinaire : « Ça commence toujours par de petites choses auxquelles on s’habitue. Au Rwanda, les Tutsis avaient depuis trop longtemps accepté d’être traités de "cafards" avant d’être exterminés », souligne-t-elle.
C’est aussi en France qu’elle découvre le rôle joué par sa nouvelle terre d’accueil dans le génocide des Tutsis. Jusqu’au bout, Paris va soutenir les forces génocidaires. Au nom d’un calcul géopolitique insensé, de schémas coloniaux éculés. Et encore ? Bien des secrets restent enfouis dans la conscience des responsables politiques de l’époque ou dans les archives de l’Etat.
Justement, le Conseil constitutionnel a confirmé le verrouillage des archives de l’Elysée à l’époque de François Mitterrand.
Lesquelles continueront à être distillées selon le bon vouloir de Dominique Bertinotti, ex-ministre de François Hollande, choisie par François Mitterrand lui-même.
« Des documents d’ordre public restent aux mains d’une personne privée ? » s’indigne Annick Kayitesi-Jozan. Elle s’est battue pour conduire devant la justice la chaîne Canal + après la diffusion en 2013 d’un sketch censé faire rire en se moquant des enfants découpés à la machette pendant le génocide au Rwanda. La procédure judiciaire est toujours en cours mais, par effet de ricochet, a déjà conduit à amender la loi sur le délit de négationnisme. Depuis janvier, il s’applique également au génocide des Tutsis du Rwanda.
Quand elle est en colère, Annick Kayitesi-Jozan écrit. Toujours la nuit. C’est ainsi que s’est imposée l’idée d’un second livre. « Dans le premier, je racontais des faits. Entre les deux, je suis devenue mère, et j’ai dû répondre aux questions incessantes de mes deux enfants. Mais eux ne se contentent pas de faits. Pour eux, il a fallu que je revienne sur ce passé, en assumant cette solitude qui habite tous les rescapés », explique la jeune femme, consciente qu’elle aura bientôt 40 ans.
L’âge qu’avait sa mère au moment de son assassinat. Pour essayer de retrouver son corps, l’écrivaine, qui a obtenu la nationalité française, est retournée au Rwanda en 2005. Dans une scène saisissante, elle raconte son retour sur une colline où vivait une partie de sa famille massacrée.
Sur place, des paysannes lui souhaitent la bienvenue. Mais elle se glace en reconnaissant les robes de ses cousines, portées par ces femmes en apparence affables. Le Rwanda est le seul pays au monde qui, après avoir connu un génocide, voit cohabiter victimes et bourreaux.
Annick Kayitesi-Jozan, elle, finit par repartir en France. Sans avoir retrouvé le corps de sa mère, mais avec un bébé dans les bras, né d’un mariage éphémère. Installée à Reims chez sa sœur Aline, elle se rend parfois à Paris pour retrouver son ami l’essayiste Raphaël Glucksmann, fils du philosophe. Une famille qui lui a ouvert les portes de sa maison. Et c’est lui qui lui présente l’autre Raphaël, celui qui va devenir son second mari et le père de sa fille.
En 2015, ce dernier est nommé à la tête de l’Agence française de développement (AFD), en Ouzbékistan. C’est là qu’elle vit désormais. A Tachkent, où les Africains sont une curiosité exotique et « où les automobilistes refusent les ceintures de sécurité, jugées dangereuses ! » s’exclame-t-elle. Sa vie a connu bien des tournants inattendus. Mais elle ne pourra jamais s’empêcher de regarder dans le rétroviseur, vers ce mois d’avril où tout a basculé.
Peut-on partager le cauchemar d’un génocide ? « Je n’aime pas ce mot. C’est un mot qui sert à masquer des milliers d’histoires qu’on ne veut pas entendre », écrit Annick Kayitesi-Jozan. « Tu dis génocide, on te répond "ah oui, je vois." » En réalité, il n’y a qu’elle qui voit : la danse des fantômes qui continuent de la hanter.









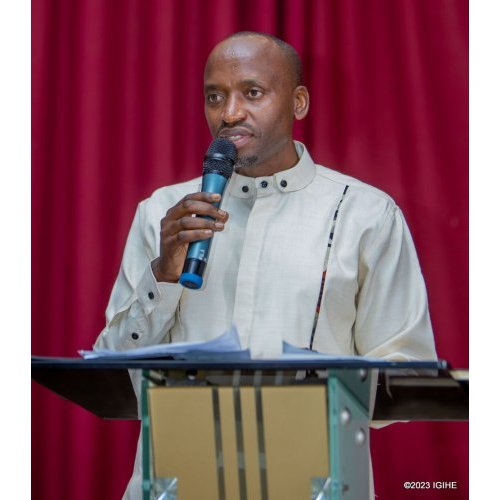







AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!