Selon Kevin Casas-Zamora, secrétaire général de ce groupe de réflexion établi à Stockholm, « l’état de la démocratie mondiale est aujourd’hui profondément préoccupant ».
Entre 2019 et 2024, plus de la moitié des pays du globe soit environ 54 % ont enregistré un recul significatif dans au moins un des indicateurs constitutifs de la démocratie. Mais c’est la liberté de la presse qui ressort comme la victime la plus emblématique et la plus exposée de ce déclin généralisé : elle aurait connu, au cours de cette période, sa plus brutale dégradation en cinquante années d’observation. Jamais, depuis que ces mesures existent, un indicateur aussi déterminant de la vitalité démocratique n’avait enregistré une telle chute.
Cette régression est loin d’être circonscrite à une aire géographique précise : quarante-trois États répartis sur tous les continents, dont quinze en Afrique et autant en Europe, sont concernés par ce recul. Loin de constituer un phénomène conjoncturel, cette atteinte à la liberté d’informer résulte d’un faisceau de facteurs convergents.
D’une part, l’héritage de la pandémie de Covid-19 a servi de prétexte à de nombreux gouvernements pour renforcer leur contrôle sur les flux d’information, invoquant la nécessité d’endiguer la désinformation sanitaire ou de maintenir l’ordre public en période d’incertitude.
De l’autre, l’argument sécuritaire tantôt face au terrorisme, tantôt face aux cybermenaces, tantôt encore face aux tensions géopolitiques est devenu l’instrument rhétorique privilégié pour légitimer une restriction accrue de l’espace médiatique.
À ce « mélange toxique », pour reprendre les termes de M. Casas-Zamora, s’ajoute le rôle ambivalent de la désinformation. Certes, la prolifération de fausses nouvelles et de manipulations numériques constitue un péril réel pour l’intégrité du débat public.
Mais le danger réside dans l’usage détourné qui en est fait par certains régimes : au nom de la lutte contre les contenus fallacieux, ils instaurent des dispositifs de censure, criminalisent la critique journalistique et réduisent au silence les voix dissidentes. Ainsi, la désinformation devient non seulement une menace intrinsèque, mais également une arme rhétorique permettant de justifier l’érosion méthodique des libertés fondamentales.
En outre, l’évolution structurelle des écosystèmes médiatiques accentue cette vulnérabilité. La concentration croissante des groupes de presse entre les mains d’intérêts économiques ou politiques réduit la pluralité des voix, tandis que la disparition progressive des médias locaux prive les sociétés d’espaces de proximité indispensables à l’ancrage du débat démocratique. Dans ce paysage en recomposition, la presse indépendante se voit marginalisée, quand elle n’est pas directement persécutée.
La dégradation actuelle de la liberté de la presse ne saurait donc être réduite à une simple contingence ; elle traduit un glissement profond, où la logique sécuritaire, la tentation autoritaire et les mutations technologiques s’entrelacent pour fragiliser l’un des piliers essentiels de la démocratie moderne.
En mettant en péril la capacité des citoyens à être informés de manière libre et pluraliste, c’est l’édifice tout entier de la gouvernance démocratique qui se trouve ébranlé, au risque d’installer durablement un état d’exception devenu norme.
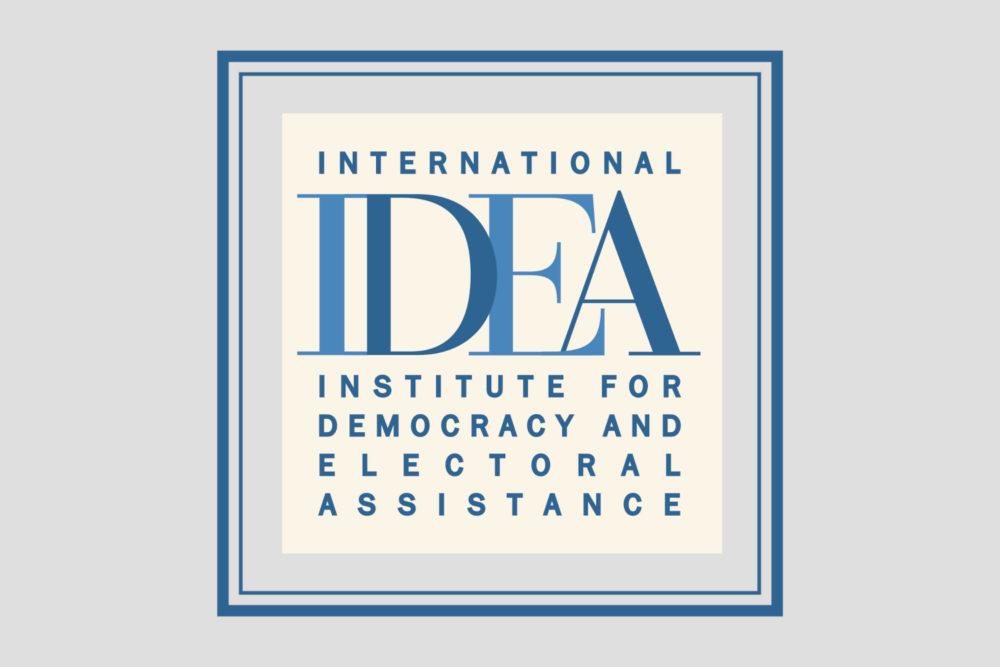


















AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!