La récente crise, déclenchée par les tensions autour de la nomination d’un officier de l’armée tutsi congolais, accusé de crime de facies, en raison de ses origines communautaires, met en lumière l’incapacité structurelle de l’État à exercer un contrôle rationnel et impartial sur son territoire.
Le départ de cet officier, certes salué par une partie de la société civile instrumentalisée et dopée au discours de haine, n’a été que le pâle substitut d’une véritable solution : un artifice destiné à calmer une clameur populaire, sans s’attaquer aux causes profondes de la désorganisation politique et sécuritaire.
La venue de la délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’Intérieur Jacquemain Shabani, et composée de figures ministérielles clés telles que Floribert Anzuluni, Aimé Boji et Eliezer Ntambwe, illustre cette démarche de façade.
Trois jours de réunions et de consultations sont prévus avec autorités locales et provinciales, forces armées, représentants de la société civile et milices Wazalendo. Mais derrière ce déploiement protocolaire se dessine la logique d’un pouvoir plus soucieux de contrôle et d’image que de réforme : la consultation devient ritualisation, la rencontre devient mascarade. L’État, en apparence attentif, se révèle surtout impuissant à engager une réflexion stratégique sur la sécurité, la cohésion sociale et la légitimité de ses forces armées.
La question des Wazalendo est symptomatique de cette dérive. Leur légalisation, opérée sans discernement, a produit l’effet inverse : elle a légitimé des acteurs armés aux allégeances flottantes, introduisant un facteur de déstabilisation supplémentaire, parfois même contre l’intérêt du pouvoir qui les a promus. Ce paradoxe, où les défenseurs d’hier deviennent aujourd’hui un problème d’État, souligne l’aveuglement et la précipitation des autorités dans la gestion de la sécurité et du politique.
En définitive, à Uvira, le réveil est amer, mais il ne s’accompagne d’aucune conscience morale ni d’une réforme véritable. Il s’agit d’une illusion de pacification, d’un simulacre de dialogue où le gouvernement se pare des atours de la responsabilité tout en perpétuant les erreurs qui ont conduit à la crise.
La tragédie réside dans cette répétition mécanique des mêmes errements : la population réclame justice et sécurité, mais elle se heurte à un pouvoir qui, tel un médecin après la mort, intervient trop tard et de manière inefficace, préférant masquer les symptômes plutôt que de traiter la maladie.
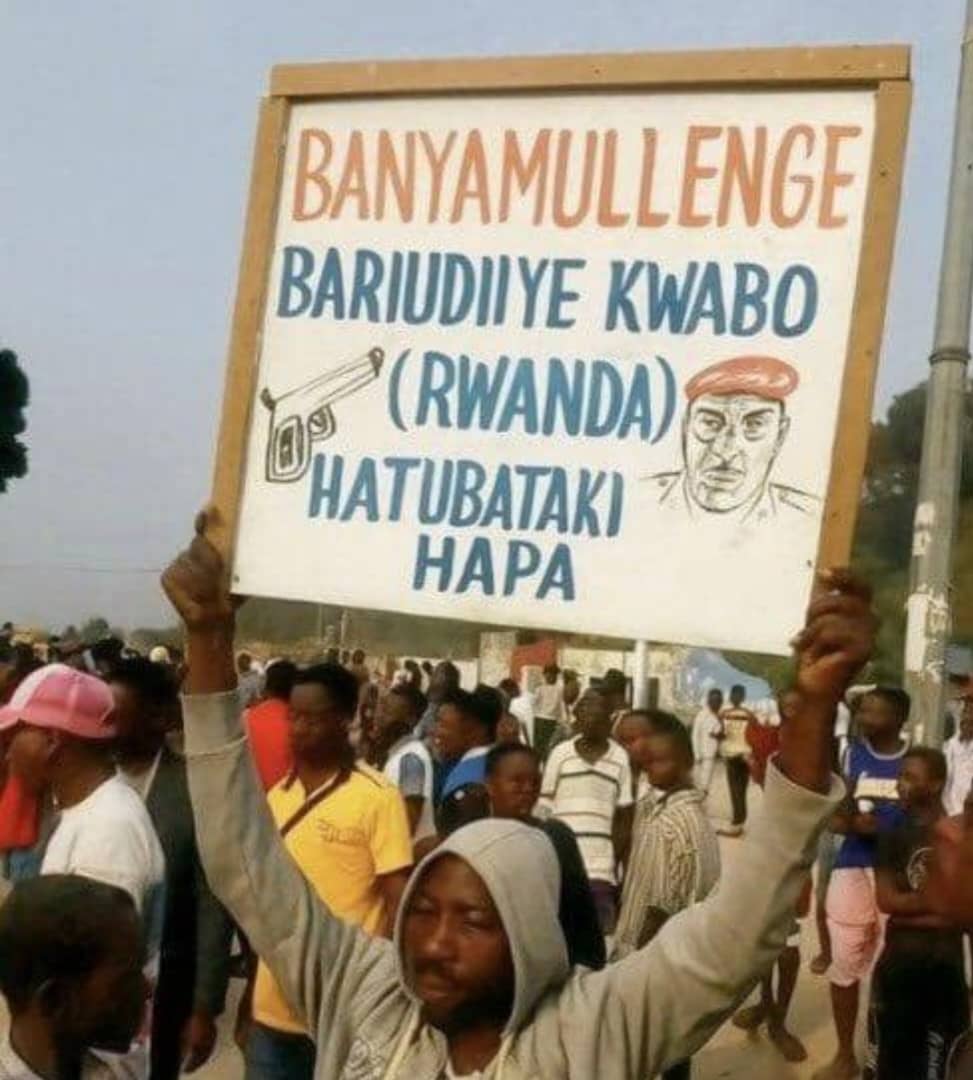


















AJOUTER UN COMMENTAIRE
REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM
Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.
Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!